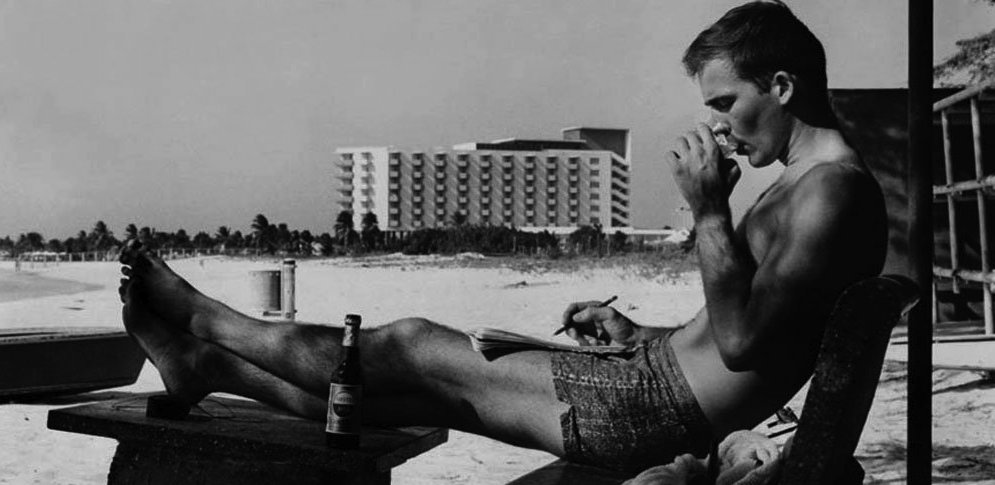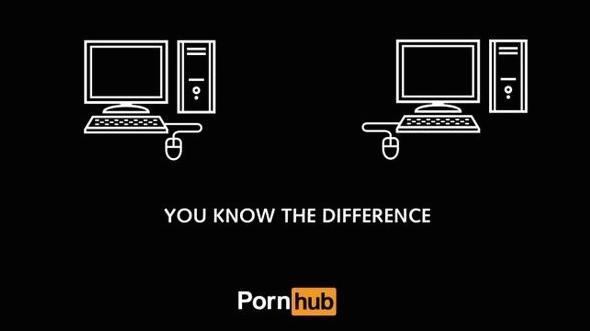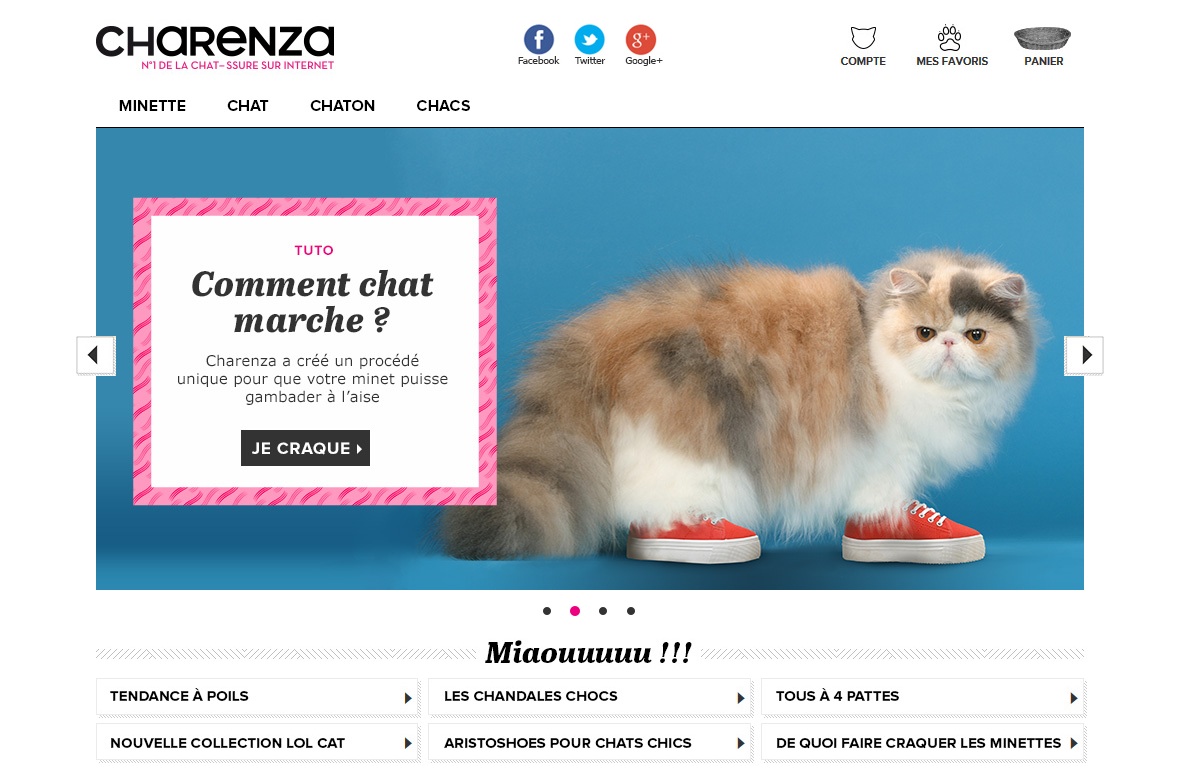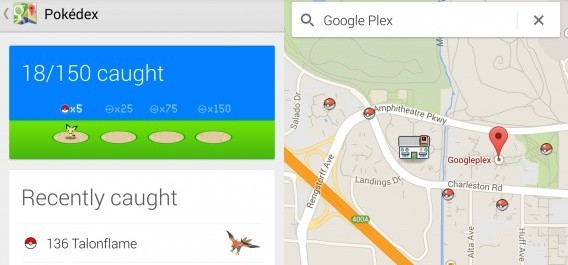Fillettes, devenez ingénieurs !
Qui offrirait un camion à une fillette de trois ans ? Personne sans doute … Pourtant, l’air du temps et la teneur des discours pourraient nous faire espérer le contraire. A l’heure où les médias nous serinent avec la parité à coup d’articles tels que « Les femmes face aux discriminations salariales » Les Echos 24/03/2014, « Municipales : pourquoi la parité a échoué » le Monde 3/04/2014 ou encore « la femme est un homme comme les autres » Elle 17/10/2007, n’aspirons nous pas à une plus grande égalité entre les sexes ? Or, celle-ci devrait commencer dès le plus jeune âge. En effet, dans Hommes, femmes : construction de la différence, Françoise Héritier montre que la socialisation des enfants est déterminante dans la construction des rôles sociaux. Les différences d’éducation entre garçons et filles sont au fondement des inégalités. Ainsi, les filles intériorisent très rapidement le rôle que la société leur a attribué. Calme, soigneuse et presque maniaque, la fillette est incitée à faire des coloriages, à ranger ses affaires et reçoit en cadeau des aspirateurs en plastique. Alors que l’hyperactivité, l’insouciance voire l’indiscipline sont valorisées chez les garçons. Leurs mères sont plus permissives et moins exigeantes. Quant à leurs cadeaux, ils sont davantage liés à l’univers du jeu qu’à celui de l’utilité. Le jeu est ainsi un vecteur privilégié de cette socialisation genrée.
Alors, dans ce contexte, comment les marques de jouets envisagent-elles les choses ? Bien que le marketing genré soit adopté par la majorité des marques, certaines résistent. Toutefois, Lego a pu en faire les frais : colorier sa célèbre brique en rose n’a pas suffi. En 1994, le lancement de Lego Belville se solde par un cuisant échec plongeant l’entreprise dans quatre ans de recherches intensives. Des études qualitatives ont été menées durant cette période afin de mieux cerner la psychologie et le comportement des petites filles. Finalement, la conclusion est sans appel. Les petites filles aiment les jeux de construction et de rôles, comme les garçons. Une nouvelle gamme respectant l’ADN de la marque tout en s’adaptant aux attentes de cette nouvelle cible est lancée en 2012. Ainsi, plutôt que de proposer une figurine top model, Lego use du storytelling pour amorcer l’histoire de cinq copines qui vivent des aventures trépidantes et laisse la possibilité aux fillettes d’inventer la suite. Grâce à une communication 360, créant un univers cohérent entre tous les supports, cette gamme devient rapidement un pilier de la marque. Au rayon des jouets pour filles, elle se classe troisième des meilleures ventes après l’indétrônable Barbie et la star montante Monster high introduit en France en 2011. En 2013, la gamme Lego Friends représente 13% des ventes et a encore une belle perspective de croissance devant elle.
A contrario, la start-up américaine GoldieBlox rejette cette approche genrée. La marque a bien évidemment été créée par une femme, Debbie Sterling, en 2012. Son objectif à long terme est d’ouvrir le marché des jeux intellectuellement stimulants aux petites filles. Révélée à plus de cent millions de spectateurs à l’occasion du Super Bowl, la marque a choisi un positionnement on ne peut plus différenciant et inédit, en affirmant sa volonté de former la prochaine génération d’ingénieurs. Sa dernière campagne de publicité vise donc à susciter des vocations chez les fillettes. Elle n’a pas fini de faire parler d’elle puisque le premier spot avait généré plus de huit millions de vues en une semaine. (https://www.youtube.com/watch?v=ZVCC83cDch0)
Alors la prochaine fois que vous vous planterez devant le rayon jouet, réfléchissez !
Miléna Sintic
Crédits photos :
The Pink Project – Songmi & Gayoung and Their Pink Things>
Light jet Print, 2007. – <The Blue Project – Cole and His Blue Things>
Light jet Print, 2006
LEGO® Friends 2012 TVC