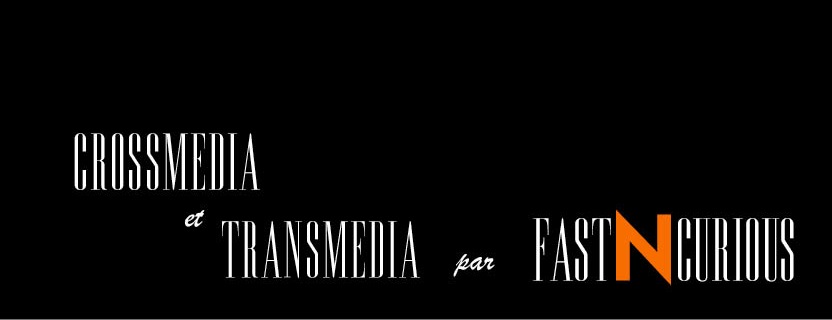
Cross-média et transmédia par FastNCurious
Introduction
Dans sa rubrique spéciale Dossiers, FastNCurious propose une troisième édition qui analysera les thèmes du cross-média et du transmédia sous différents angles d’approches spécifiques à l’enseignement du CELSA.
Notre consommation des médias aujourd’hui semble s’effectuer sur les modes de la convergence et de l’interactivité : dans quelle mesure médias traditionnels et nouveaux s’imbriquent-ils, se complètent-ils voire s’excluent-ils ?
Sommes-nous entrés dans une ère de consommation multi-écrans ? Les contenus s’additionnent, se superposent, s’imbriquent voire se délinéarisent sur des supports additionnels. Avec en guest stars, tablettes et Smartphones, des supports promus comme symboles d’une utilisation contemporaine des médias qui favoriserait une expérience interactive, voire immersive pour leurs utilisateurs.
C’est au travers des notions de cross-média et de transmédia que nous allons étudier la question de l’utilisation des médias, leur appropriation et les stratégies mises en place par les professionnels de la communication, qui manient au quotidien ces outils médiatiques.
D’emblée, on constate une récurrence des discours sur les pratiques liées au transmédia, qui aurait remplacé son ancêtre conceptuel, le cross-média. Il convient d’éclaircir ces deux notions, qui sont souvent confondues : tandis que le cross-média serait ce qui met en jeu la superposition de messages sur différents supports, le transmédia aurait davantage à voir avec une expérience immersive, un storytellling déployé sur ces différents supports. Le transmédia contiendrait une valeur ajoutée qui enrichirait le contenu médiatique – bref, il serait question de prolonger une expérience médiatique (cf. la campagne transmédiatique de Lost à travers « The Lost Experience », un jeu interactif conçu pour maintenir l’intérêt du public pendant l’intersaison de la série).
C’est cette « tendance » du transmédia qui va être analysée cette semaine par nos rédacteurs. Elle semble être l’une des dernières pratiques des éditeurs de contenu audiovisuel, et elle rejoint la question cross-médiatique de l’interactivité : interactivité des contenus médiatiques signifie-t-elle pour autant interaction et échange ?
Nos Curieux vont vous faire partager leurs analyses sur les questions de nos pratiques médiatiques qu’ils ont traitées de manière transversale. Lundi, nous analyserons sous l’angle marketing les stratégies cross-média et transmédia. Mardi, c’est via l’aspect symbolico-culturel que nous aborderons le thème du transmédia. Mercredi, nous verrons en détail les enjeux qui se cachent derrière les pratiques et les stratégies transmédiatiques. Jeudi, ce sera l’exemple Coca-Cola qui sera analysé à titre d’illustration. Enfin, vendredi, nous vous ferons part d’une analyse issue du travail de recherche de nos rédacteurs.
Bonne lecture !
Alexandra Ducrot
Pour La Rédaction









