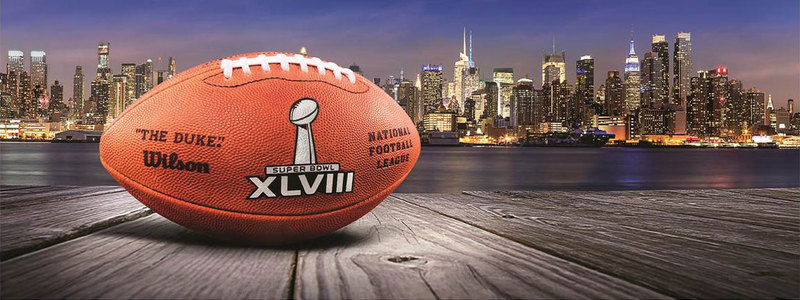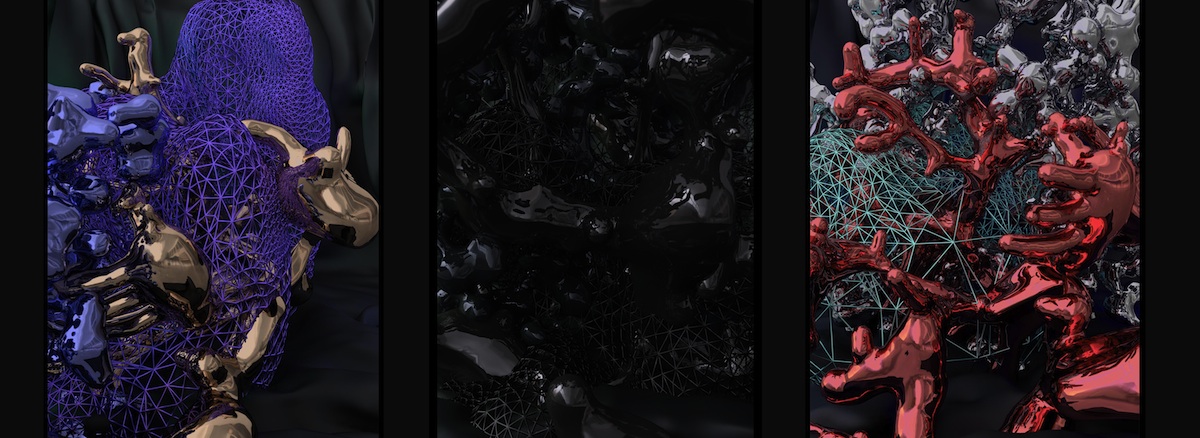Super Bowl 2014 : l'avènement de la conscientisation de la publicité virale
Véritable institution pour les passionnés de football américain aux Etats-Unis, le Super Bowl est aussi devenu au fil des ans un événement important pour les publicitaires et les annonceurs désireux de bénéficier d’un écran publicitaire inestimable en termes de visibilité. Ainsi, c’est à ceux qui auront eu les moyens de dépenser quatre millions d’euros pour quelques secondes de spot que reviendra l’honneur d’être diffusé lors du championnat. Et l’enjeu est de taille, puisque l’évènement retransmis à la télévision américaine réunit chaque année plus d’une centaine de millions de téléspectateurs et est aussi massivement commenté et relayé sur les réseaux sociaux. Un pic d’audience annuel dont les annonceurs ont tout intérêt à profiter !
Chaque année, les heureux élus conçoivent donc un spot spécialement pensé pour sa diffusion lors de l’évènement, rivalisant d’inventivité et de moyens. Les films publicitaires sont ainsi conçus et annoncés comme de véritables points d’orgues d’une campagne. Une guerre marketing qui pousse les marques à proposer des spots assurément efficaces et dans lesquels on retrouve des éléments récurrents : animaux parlants, bébés à l’humour décapant, actrices les plus connues…
C’est dans l’optique de se moquer de ces codes que Volkswagen a décidé de les rassembler dans le teaser du spot que la marque proposera durant l’évènement. Destiné à piquer la curiosité du public avant la diffusion du véritable film lors de la finale, il rassemble chiots, poneys, bébés, célébrités et sumos afin de tourner en dérision les spots habituellement présentés lors du Super Bowl. La marque de voiture allemande n’a pas été la seule à jouer avec cette recherche du viral à tout prix et sa conscientisation (1). Puisque la course à la diffusion virale est ici explicite et sciemment revendiquée par la marque, elle se retrouve donc face à un public prévenu et conscient de la stratégie qui est ici mise en œuvre. Mais le propre d’une stratégie publicitaire n’est-il pas que celle-ci ne soit pas décelée par le public ? Dès lors, il devient possible de se demander dans quelle mesure un tel paradoxe peut être mis au service de la stratégie des marques concernées.
Du partage spontané à l’incitation, une nouvelle forme de marketing viral ?
Rappelons que le marketing viral est un mode de promotion par lequel le public assure l’essentiel de la diffusion du message publicitaire en le recommandant spontanément à ses proches ou à un réseau de connaissances. L’effet de buzz sensé être produit par cette légère satire est donc paradoxalement une illustration de ce que tente de dénoncer Volkswagen. En effet, le film relayé par les aficionados sur les réseaux sociaux, a été pensé dans une stratégie de marketing viral, au même titre que les publicités qu’il dénonce. Et si l’ambivalence de ce spot soulève bien l’hypothèse que la conscientisation de la logique de marketing viral pourrait devenir une nouvelle stratégie, le film réalisé par la marque Sodastream nous permettrait de l’affirmer.
Cette dernière a en effet récemment signé un contrat avec l’actrice Scarlett Johansson qui devient donc sa première égérie, obtenant en prime une apparition remarquée dans le spot qui sera diffusé lors du SuperBowl 2014. Le film commence par une présentation pour le moins sérieuse du produit et de ses bénéfices par la belle blonde vêtue d’une blouse blanche, rappelant un simple discours de prescription. Mais même si l’image véhiculée par l’actrice est sans conteste plus vendeuse que celle de Mac Lesggy dans une publicité pour une célèbre marque de brosse à dents, la présentation du produit n’est en fait ici qu’un prétexte et le spot prend véritablement toute sa profondeur lorsque S. Johansson lance d’un air faussement candide : « If only I can make this message go viral… ». S’ensuit donc un show sexy sans réel rapport avec le produit où l’actrice met à profit tous ses atouts charme, avec en prime un petit message aux concurrents directs de la marque : « Sorry Coke and Pespi ».
Un spot plein d’autodérision où la conscientisation de la recherche du viral par la marque devient une stratégie à part entière. Un phénomène marketing nouveau puisque même si le principe d’une diffusion virale est déjà perçu par les annonceurs comme un moyen peu coûteux et avéré d’augmenter sa visibilité, il n’avait jusqu’ici jamais fait l’objet d’un détournement. Pour autant, cette stratégie semble pertinente au regard de la prise de conscience par les consommateurs des moyens mis en œuvre par les marques pour attirer leur attention. De plus, étant donné que les consommateurs sont aujourd’hui passés maîtres dans l’art de déjouer les codes publicitaires, le pari de la transparence peut sembler être une réponse judicieuse.
Pour autant, le fait d’aller à l’encontre du fonctionnement même du marketing viral en cherchant à pousser au partage ne pourrait-il pas créer un phénomène de rejet de la part du public ? En effet, rappelons que le principe du viral est basé sur le partage d’un contenu pour sa qualité, son originalité ou encore son caractère divertissant. Une propagation qui est donc bien sensée se faire d’elle-même et non sur la recommandation du créateur du contenu. Il s’agit ici d’un renversement du principe du viral qui voudrait que ce soit au public de juger si un contenu est assez bon pour être partagé. Le danger de l’utilisation du paradoxe entre la recherche du viral et sa conscientisation dans des spots comme celui de Sodastream pourrait donc bien être le fait que la marque décrète elle-même son film comme étant viral, et pousse en quelque sorte le spectateur à partager pour partager.
En conclusion, le tour de force des publicités les plus partagées durant les éditions précédentes du SuperBowl, à l’image de celles de Pepsi ou de Coca Cola, ne serait-il pas d’avoir réussi à susciter l’engouement nécessaire au partage par le public sans avoir à l’y inciter ?
Amandine Verdier
(1) Conscientisation : Ici, action de conscientiser, de faire prendre conscience de la stratégie de marketing viral qui a été mise en place.
Sources :
Forbes.com
Theguardian.com
Adweek.com
Crédits photos :
Businessinsider.com