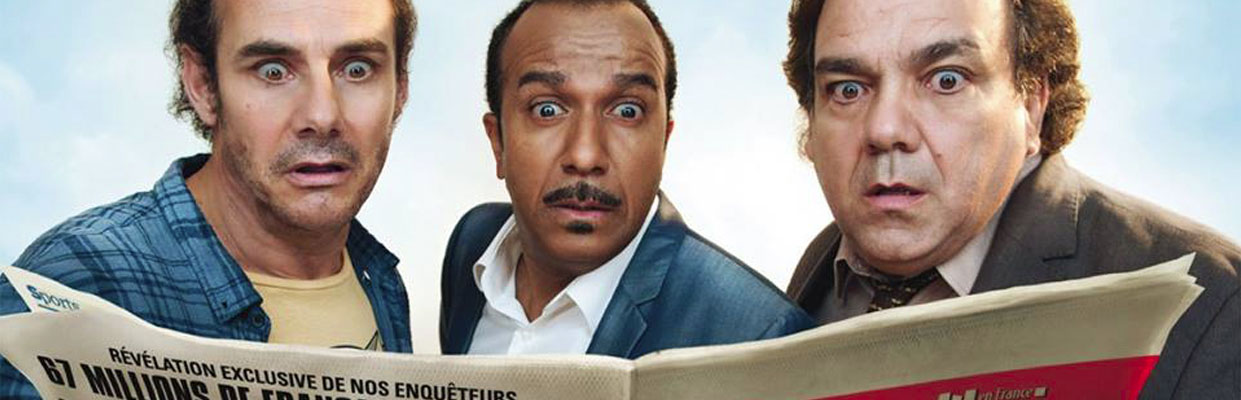De la téléréalité à la natalité
Voilà une nouvelle qui devrait enchanter les parents américains ! Si l’on en croit les résultats d’une enquête menée par deux économistes du NBER (National Bureau of Economic Research) de Chicago, la téléréalité n’aurait pas que des désavantages et serait même un excellent vecteur de sensibilisation.
Relayée par le très sérieux New York Times dans un article paru le 13 janvier dernier, cette étude établit une corrélation entre la réduction rapide et significative du nombre de grossesses précoces dans certaines régions des Etats-Unis et les records d’audimat réalisés par MTV dans ces mêmes régions. Depuis le lancement de sa série phare « 16 and pregnant » (16 ans et enceinte) en 2009, la chaîne la plus plébiscitée par les ados aurait permis d’éviter plus de 20 000 naissances non désirées par la seule influence de son programme.
Le pitch de cette émission qui attire plus de 3 millions de téléspectateurs par épisode? Une immersion si réaliste dans le quotidien de jeunes américaines tombées enceintes par accident qu’elle en deviendrait presque intrusive. Parents au bord de la crise de nerfs, petits-copains absents, manque de sommeil et problèmes financiers, rien n’est épargné à ces anciennes cheerleaders aujourd’hui dépitées par leurs vergetures. On s’émeut et surtout, l’on apprend des erreurs de la jolie Mackenzie. Elle qui refusait de prendre la pilule par peur de grossir est aujourd’hui surnommée « la baleine » par ses camarades de lycée. On s’insurge et plus encore, l’on compatit au tragique destin de ce pauvre Josh contraint d’arrêter le rodéo pour trouver un travail alimentaire alors même qu’il peine à retenir la date prévue pour l’accouchement de sa copine.
Si le contenu d’un tel programme peut prêter à sourire, il n’en est pas moins digne d’intérêt. Quoi qu’en disent les mauvaises langues, l’enregistrement des taux records de tweets et de recherches Google ayant trait à la contraception coïncide avec les horaires de diffusion du programme.
Interrogée sur la question, Sarah S. Brown, directrice générale du programme américain de prévention de la grossesse chez les adolescentes, s’enflamme et déclare « Les gens n’ont simplement pas conscience de l’impact qu’ont les médias d’influence sur les jeunes ! ».
Aux vues des vagues de fanatisme que suscitent certaines émissions, on est nécessairement tenté de lui donner raison…
Le plus étonnant dans cette histoire ? Le show, longtemps critiqué par les progressistes qui l’accusaient de prêcher la bonne parole républicaine à travers un discours censé diaboliser l’avortement et encenser la merveilleuse expérience de la maternité, fait désormais la joie… de ses principaux détracteurs !
S’il est vrai que les adolescentes ayant participé à l’émission sont devenues de véritables stars outre Atlantique, ce qui pourrait inciter les téléspectatrices à suivre leur exemple, elles ne font pas figures de modèles pour autant. Farrah Abraham, qui a connu la gloire le temps d’une sextape, suit désormais une « Thérapie de couple » dans une émission éponyme diffusée sur VH1. Janelle Evans fait davantage la Une des tabloïds que celle des grands magazines et la presse à scandale qui se délecte de ses problèmes d’addiction ne manque pas de médiatiser la moindre de ses arrestations. Quant à Kaylin Lowry, qui regrette de n’avoir jamais obtenu son baccalauréat, elle profite de ses apparitions publiques pour rappeler combien élever un enfant est difficile quand on n’en a ni la maturité, ni les moyens.
Loin d’encourager les jeunes américaines à devenir mère et avoir beaucoup d’enfants, « 16 and pregnant » fait davantage office de « cautionary tale » (avertissement) que de « fairytale » (conte de fées) pour reprendre une expression chère à nos amis anglo-saxons.
Quel meilleur moyen en effet de sensibiliser la jeunesse aux conséquences de rapports non protégés si ce n’est en leur montrant la réalité à laquelle d’autres ados ont été confrontés avant eux? « Ça pourrait très bien m’arriver » semblent se dire des milliers d’adolescents peu enthousiasmés à l’idée de devoir un jour assumer pareilles responsabilités. Même âge, même vie ; scotchés à leurs écrans, les téléspectateurs ne pourraient se sentir plus proches des personnages de leur show télévisé. Le processus d’identification fonctionne et va jusqu’à briser certains tabous, déliant les langues et incitant les jeunes à parler librement de contraception.
Offrir du divertissement aux ados pour les inciter à se protéger ? Encore fallait-il y penser !
Si les résultats de l’étude menée par les économistes de NBER sont à manipuler avec précaution, ils ont le mérite de poser la question de l’influence des médias sur notre quotidien. Les créateurs de « 16 and pregnant » n’avaient rien planifié et c’est sans doute la raison du succès de leur programme en matière de prévention. La morale de cette success story à l’américaine ? Le miroir de la réalité se révèle plus efficace qu’un discours moralisateur ou préfabriqué.
Faut-il pour autant envisager la téléréalité comme un nouveau moyen de communication à visée pédagogique ? A méditer.
Marine Bryszkowski
Sources
NYTimes
NBER
Grazia
Wikipédia