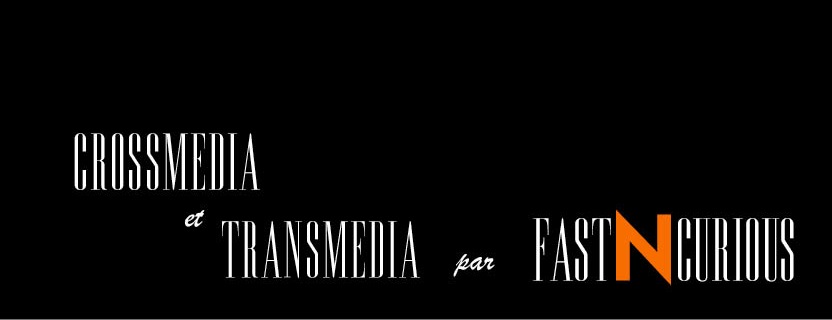L’expérience médiatique, hic et nunc
Notre rédactrice Margaux Putavy s’est livrée à une analyse des enjeux de l’expérience médiatique aujourd’hui, en nous éclairant sur l’aspect davantage transmédiatique que cross-médiatique – une réflexion sur nos écrans, à travers l’exemple du dispositif transmédiatique mis en place dans le cadre de l’émission Master Chef.
Avant, on regardait des émissions comme Master Chef, passivement, le mercredi soir. Et puis on attendait la semaine suivante, pour reprendre l’aventure là où on l’avait sagement laissée. Pour patienter, on pouvait, au mieux, revivre l’émission en replay, ou bien se découvrir une passion subite pour d’autres programmes dans la semaine. Mais ça, c’était avant.
En effet, les contenus médiatiques jusque là cantonnés aux médias traditionnels, et plus particulièrement la télévision, envahissent désormais tout notre univers quotidien. Rares sont aujourd’hui les émissions dont l’influence se limite aux 120 minutes de diffusion. Il est bien plus fréquent, et bien plus efficace, de concevoir des programmes susceptibles de se décliner en différents formats. En d’autres termes, on ne peut plus nier qu’il n’est absolument plus pertinent de penser les différents médias indépendamment les uns des autres. Mais alors pourquoi ? Ou, plus exactement, pour quoi ? Quelles sont les conséquences, pour les téléspectateurs et leur consommation des médias de telles approches transmédiatiques ?
Reprenons le cas de Master Chef qui, à plusieurs égards, s’avère être particulièrement emblématique de cette tendance. Le 28 août 2013, peu avant le lancement de la saison 4, le site MYTF1 dévoilait le « dispositif digital exceptionnel » mis en place autour de l’émission. Du livre à la tablette, en passant par la presse magazine, les mobiles, le site web, les IPTV, nombre de supports ont donc été mobilisés et mis en relation. Le site MYTF1, par exemple, proposait un « Défi Master Chef » qui, lors de chaque diffusion, récompensait quelques téléspectateurs chanceux et perspicaces ayant donné leur avis sur les créations culinaires ou ayant deviné quel candidat subirait le « test sous pression ». De la même manière, les pages Facebook et Twitter de l’émission, grâce au hashtag #MaSoiréeMasterChef, permettaient aux internautes d’organiser leurs propres soirées MasterChef en mettant à leur disposition une recette de l’émission en avant-première, une boite à outil composée d’ingrédients ludiques, des éléments pour habiller leur table, des grilles de Bingo et en leur donnant l’occasion d’échanger leurs astuces sur les réseaux sociaux. Enfin, les téléspectateurs ont également pu se procurer en kiosque le MasterChef Mag et en libraire cookbook de la nouvelle saison ainsi que le coffret MasterChef Pâtisserie.
L’idée est de proposer, bien plus qu’une simple émission de télévision, une véritable « expérience » MasterChef. Déjà lorsque le terme de transmédia est employé pour la première fois par Henry Jenkins en 2003, il s’agit d’associer plusieurs supports afin d’étendre un univers. Ainsi, en créant un contenu exclusif et original pour chaque support, l’on ne se contente plus d’adapter un même format pour divers écrans, comme c’était par exemple le cas avec le replay qui permet de revoir la même émission mais sur l’ordinateur. La télévision ne peut donc plus se contenter d’envisager le web et les autres médias comme des plateformes de rediffusion et de promotion. Il est maintenant nécessaire d’aller au-delà du cross-média puisque le transmédia, lui, génère une expérience qui se veut unique, enrichie et presque complète.
De cette manière, le contenu médiatique est fragmenté et devient ainsi accessible partout, tout le temps, de toutes les façons possibles. Ce fait est révélateur de la mutation que connaît aujourd’hui toute la culture numérique, au sens où l’entend Milad Doueihi dans son ouvrage Qu’est-ce que le numérique. Autrefois culture assise, culture « de la chaise » même selon Mauss, elle a su s’adapter à la mobilité qui caractérise nos sociétés occidentales. Les contenus médiatiques sont alors entièrement intégrés dans la quotidienneté et notre rapport au temps et à l’espace s’en trouve d’ailleurs modifié. Si le rendez-vous télévisuel hebdomadaire, vécu dans l’intimité du foyer, a pu représenter un rituel, on tend aujourd’hui à privilégier une certaine hybridation des repères spatiotemporels : l’espace numérique investit l’espace traditionnel et l’expérience médiatique se diffuse dans des temps plus inhabituels.
De la même façon, le digital donne implicitement au corps une place centrale dans l’expérience médiatique. Les tablettes et les Smartphones réintroduisent le toucher au sein même du numérique. Ainsi, le transmédia acquiert une valeur sensorielle et les programmes télévisuels prennent pour le téléspectateur une nouvelle dimension, ils se trouvent bel et bien enrichis et gagnent en relief. Cette prégnance du toucher prend une valeur toute particulière dans le cas des émissions culinaires. MYTF1 annonce « Du tablier à la tablette » ; on peut aller plus loin. La plupart des applications mises en place encouragent le téléspectateur à tester lui-même les créations gastronomiques montrées à l’écran ou conseillées par d’autres internautes. Dans un mouvement dialectique, il s’agit alors d’enfiler soi même un nouveau tablier, de dépasser et d’accomplir le contenu médiatique en lui conférant une application tangible et matérielle. Et c’est peut être à ce moment précis que la médiation remplirait à merveille son rôle : par écrans interposés, elle se contenterait de transmettre les gestes des professionnels et des candidats vers les téléspectateurs anonymes. Si le concept de télé-coaching misait déjà sur cette idée de mise en application de conseils pratiques, le transmédia resterait le meilleur moyen d’impliquer les téléspectateurs et d’insuffler aux médias traditionnels un véritable souffle de dynamisme.
Mais le transmédia ne concerne pas uniquement l’extension de l’expérience médiatique dans le temps et dans l’espace. Même pendant la diffusion des programmes, plusieurs facteurs concourent à complexifier l’expérience des téléspectateurs. Nombreux sont ceux qui s’évertuent à commenter, en direct, les émissions qu’ils visionnent sur les réseaux sociaux, les exemples les plus probants étant la diffusion du Super Bowl en 2012 qui a engendré plus de 30 millions d’interactions ou les épisodes de « The Voice » qui s’accompagnent d’environ 300 000 tweets chaque samedi. Ce genre de pratique devient un véritable enjeu pour les entreprises médiatiques. Une étude de 2012 révèle en effet que 65% des Français souhaitent que la télévision laisse plus de place aux téléspectateurs. De même, 41% des Français assurent qu’un commentaire posté pendant une émission peut leur donner envie de regarder ladite émission et cette proportion atteint 48% chez les 18-34 ans. Engager les téléspectateurs en temps réel devient alors une priorité, d’autant plus que la télévision, reconnue comme média particulièrement émotionnel, s’y prête à la perfection. Pour ce faire, la solution la plus efficace est de proposer à chacun une expérience unique, en d’autres termes de faire de chaque téléspectateur le co-créateur du contenu médiatique. C’est ainsi que Benoît Vidal, Chief Digital Officier chez MFG labs, distingue trois solutions pour personnaliser les expériences télévisuelles. Tout d’abord, il cite le Social Datatainment qui consiste à encourager les commentaires sur les réseaux sociaux à l’aide des hashtags. Ensuite, il s’attarde sur le Core Datatainment en insistant sur le second écran qui permet, à un moment précis, d’enrichir voire d’augmenter la narration. Enfin, la personnalisation atteint son paroxysme avec le Full Datatainment qui intègre le navigateur dans le téléviseur et transforme ainsi le second écran en télécommande intelligente. De cette manière, chaque téléspectateur lambda, devant son poste, devient un acteur essentiel et générateur de sens inédit. Cette autre expérience transmédiatique rend ainsi les programmes bien plus stimulants et attractifs.
Bien évidemment, certains programmes se prêtent plus à ces pratiques de « live tweets » que d’autres. Il s’agit de la téléréalité, des manifestations sportives et des shows du type « The Voice », dont le caractère spontané et propice aux rebondissements et coups de théâtre invite au commentaire. Mais alors, qu’en est-il de la fiction ? Les séries américaines diffusées à la télévision risquent bien de perdre peu à peu de leur pertinence dans la mesure où il est désormais tentant et très aisé de les visionner bien en avance sur Internet. La fiction à la télévision doit alors tout faire pour conserver son statut d’événement immanquable. Certaines expériences démontrent que la solution a peut être un nom et qu’elle s’appelle, une fois de plus, « transmédia ». La chaîne D8 par exemple a lancé en décembre 2013 la série What Ze Teuf dont l’intrigue était déterminée par les internautes sur Twitter. Après chaque diffusion, les téléspectateurs disposaient ainsi de quelques heures pour imaginer des péripéties que les acteurs s’efforçaient de tourner dès le lendemain mettant ainsi en place une stratégie originale et participative. Mais la télévision n’est pas la seule à s’emparer du transmédia. L’univers du jeu vidéo permet aussi de penser une « fiction totale », comme le suggère Eric Viennot, fondateur de Lexi-Numérique. Il présente sa création, In Memorium, de la façon suivante : « Les joueurs achetaient un CD-rom, puis devaient se connecter à Internet pour chercher des indices et contribuer à l’enquête de la police. Les internautes se retrouvaient sur des forums pour résoudre les énigmes du jeu. L’un des moments les plus trépidants survenait lorsque le joueur recevait en pleine nuit un message du tueur en série sur son téléphone portable. Réalité ? Fiction ? ». Un tel « jeu de réalité augmentée » allie savamment jeu vidéo, Internet, mobile et s’appuie plus que jamais sur une dimension communautaire.
Ces derniers exemples mettent ainsi en lumière l’exceptionnel potentiel des phénomènes transmédiatiques. Si les écrans sont encore bien présents et perceptibles, il est fort probable qu’à terme ils tendent à s’effacer au profit de nouvelles technologies telles que les Google Glasses. Toujours est-il que l’objectif reste le même, à savoir proposer des expériences sensorielles toujours plus abouties. Si ces expériences sont bien virtuelles, il faut maintenant plus que jamais souligner qu’elles n’en sont pas pour autant irréelles, seulement informatiquement simulées. En établissant cette distinction primordiale dans son ouvrage L’Etre et l’Ecran, Stéphane Vial nous invite à nous interroger sur le statut de telles expériences qui semblent, par leur caractère totalisant, se fondre dans notre réalité la plus banale. Finalement, la question du transmédia n’est-elle pas plus large qu’elle n’y paraît ? N’est-elle pas autant une réflexion sur les écrans et les médias qu’une méditation sur ce que nous appelons encore notre réalité ?
Par Margaux Putavy
Sources
Éric Viennot et Xavier de la Vega « Entretien avec Éric Viennot : « Vers une fiction totale » », Les Grands Dossiers des Sciences Humaines 3/ 2012 (N° 26) p. 39-39
FranceCulture