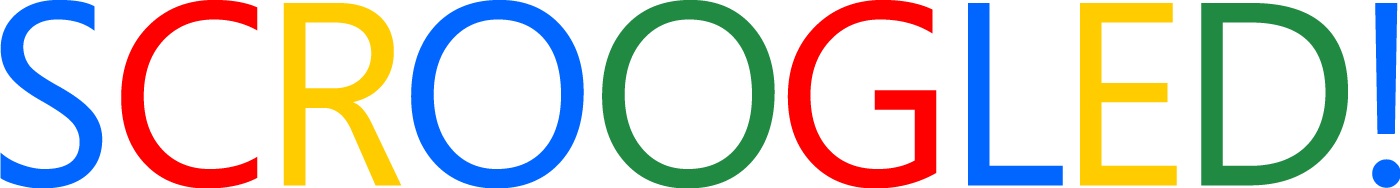Ne nous soumets pas à la tentation
Inciter à croquer la pomme sur l’arbre d’à côté ne semble pas plaire à tout le monde. Au début du mois de février les réseaux de transports Transdev et Keolis ont retiré des publicités du site de rencontres adultérines, Gleeden, à l’arrière de leurs bus qui sillonnent plusieurs communes des Yvelines. Ce retrait fait suite à la pétition d’un groupe catholique conservateur qui a récolté plus de 20 000 signatures.
Les réseaux sociaux ne sont pas en reste. La campagne publicitaire a vu poindre des commentaires outragés dans plusieurs villes d’Ile-de-France.
« Incitation au non-respect du droit civil »
C’est en ces termes que le maire UMP Marc Robert a qualifié la campagne publicitaire de la marque. Les Associations Familiales Catholiques vont plus loin dans la contestation et assignent en justice la société éditrice Black Divine, l’accusant de promouvoir l’infidélité en violation de l’article 212 du Code Civil. Rappelons par ailleurs que l’infidélité n’est plus considérée comme un délit pénal depuis 1975.
Le site quant à lui crie à la censure et à « une atteinte à la liberté d’affichage ». Il explique par ailleurs que ses publicités ont été validées par le Jury de déontologie publicitaire et Média transports, une régie publicitaire des transports. En 2013, des plaintes de même nature ont déjà été déposées auprès de l’instance indépendante mais n’ont pas donné suite, étant qualifiées de « non fondées ».
Fidèle à sa communication sulfureuse
Gleeden, créé en 2009, s’appuie sur une communication sulfureuse et provocatrice. Il est d’ailleurs fait mention sur le site qu’une de ses missions est d’«aller à l’encontre de l’hypocrisie générale et [de] faire tomber le tabou de l’infidélité. » Ce qui ne convient pas à tout le monde. « Ces publicités posaient un certain nombre de problèmes à une partie de la population, notamment des catholiques pratiquants les plus attachés aux valeurs familiales », avance la municipalité de Versailles.
Outrage encore plus prononcé du fait des références bibliques utilisées par la marque pour construire sa communication publicitaire. Tout d‘abord, l’utilisation des termes constitutifs du nom de la marque « Gleeden » : « glee », jubilation en anglais, et « eden » signifiant le paradis terrestre, le lieu de délices. Puis la pomme croquée, qui est présente sur chaque affiche publicitaire, symbole iconique de la tentation dans laquelle est tombée Eve, le péché de chair.
Toutefois il n’y a aucune représentation, aucune exposition des corps. L’insolence des propos s’appuie, comme l’explique Olivier Aïm, maître de Conférences au Celsa, sur « une mauvaise foi » non feinte. Les messages publicitaires prennent la forme de maximes faussement sages, donnant l’illusion d’arrières pensées portant vers un désir défendu dont Gleeden s’octroie le rôle d’en soulever le voile. Il est ici question de « jouissance intellectuelle ». « Il s’agit de viser la tête du passant, pour réimprimer à chaque fois le choc cognitif d’une logique paradoxale. »
L’infidélité en public
Afin d’expliquer la manifestation physique contre les affiches de Gleeden, M. Aïm avançait par ici, la première hypothèse d’une saturation du modèle énonciatif. Les concurrents directs du site ainsi que des annonceurs divers réemploient la construction « purement verbal » de son message publicitaire au profit de leur propre communication.
De plus, les messages publicitaires de la marque s’affichent aux yeux de tous : les abribus, les quais de métro, sur les arrières de bus. L’immoral fait alors son entrée dans l’espace public.
Fait plus marquant, samedi 31 janvier Gleeden, jouant toujours sur la provocation promotionnelle, a créé la surprise en dévoilant sa présence au Salon du Mariage. Les avis ont été très controversés. Pour les plus hostiles, il s’agit d’une intrusion dans un espace symbolique. Gleeden, en restant fidèle à ses utilisateurs, a trompé le Salon du Mariage, accomplissant ainsi un sacrilège.
Gleeden fera sans doute encore parler de lui. En attendant il est cocasse de noter que Versailles, l’une des villes qui a fait retirer ces affiches publicitaires, est également l’une des « villes qui trompent le plus », d’après le nombre d’inscrits. Elle se trouve en effet en cinquième position du classement.
Hélène Hudry
Sources :
lemonde.fr
fastncurious.fr
metronews.fr
gleedentemoignages.com
jdp-pub.org
Crédits photos :
rtl.fr
gentside.com
gleeden.com