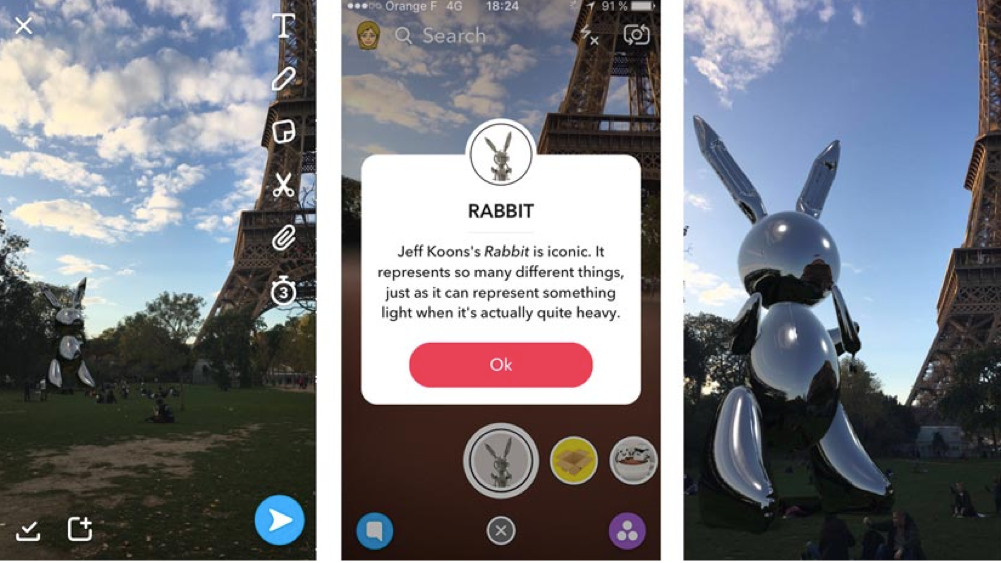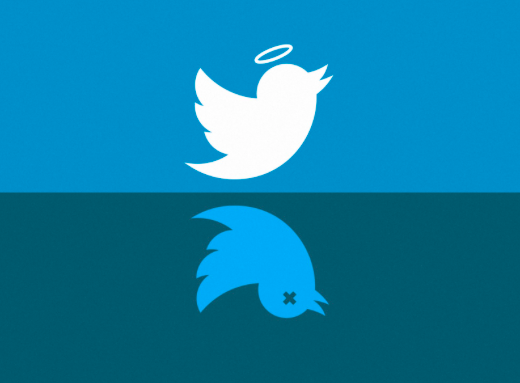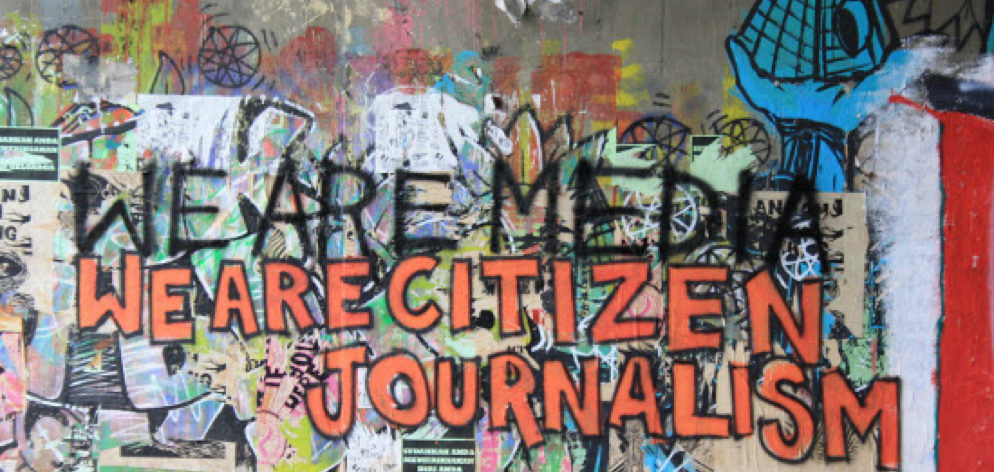WeChat VS Facebook : duel au sommet
Difficile pour nous aujourd’hui d’imaginer notre vie sans nos applis. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Uber, Messenger et bien d’autres rythment notre quotidien. Pourtant, en Chine, vous ne trouverez aucune de ses applis. La censure du gouvernement oblige les Chinois à créer leurs propres apps.
Un certain nombre d’acteurs ont ainsi commencé à copier les réseaux occidentaux pour fournir aux Chinois leur éventail d’applications. Mais en quelques années, un réseau s’est imposé comme la « super app » et pourrait bien avoir des conséquences sur nos réseaux occidentaux.
WeChat, la « super app » chinoise
En 2011, le groupe Tencent crée WeChat, qui n’est à l’origine, rien de plus qu’une application de messagerie, au même titre que WhatsApp ou Messenger. En à peine plus d’un an, 150 millions d’internautes se ruent sur l’application. Très vite, WeChat évolue et offre de plus en plus de services. Aujourd’hui, l’application réunit plus de 950 millions d’abonnés et a complètement bouleversé le quotidien de ses utilisateurs. En une seule application, WeChat concentre un nombre incalculable de services. Vous pouvez envoyer un message à un ami pour lui proposer de sortir, lui envoyer la photo d’un restaurant que vous aimeriez tester, réserver une table dans ce restaurant, payer la note à la fin du repas, noter la qualité du restaurant… et votre ami pourra même vous rembourser par message le lendemain, pendant que vous travaillerez avec vos collègues, toujours depuis l’application. En bref, vous pouvez tout faire !
Plus besoin d’un Facebook, d’un Amazon, d’un Instagram, d’un Paypal, d’un Slack ou d’un TripAdvisor quand vous avez WeChat. Le réseau social est conçu pour rendre ses usagers captifs : ils n’ont plus besoin de quitter l’application, que ce soit pour leur loisir ou pour leur vie professionnelle.
Pour mieux comprendre WeChat, nous vous proposons cette vidéo du NY Times, récapitulant très bien l’impact de l’application sur la vie des chinois.
Vers une « WeChatisation » occidentale ?
Arrivé dernièrement sur le marché européen, WeChat promet de faire bouger les lignes. Dans un premier temps, WeChat en Europe sera surtout destiné aux touristes chinois ayant pris l’habitude de payer leurs achats depuis l’application, ce qui implique que les banques et les commerçants acceptent le partenariat avec WeChat Pay. WeChat n’est pas le premier à s’implanter sur le marché européen en proposant son système de paiement. Alipay, le service proposé par le géant chinois Alibaba, a fait son apparition en France, permettant à 450 millions de Chinois de faire leurs achats depuis l’application. Avec WeChat Pay, ce sont plus de 150 millions de Chinois supplémentaires qui bénéficieront de ces avantages.
Cette adaptation des commerçants aux usages chinois pourrait bien amener les européens à reprendre le même modèle. Plus besoin d’argent liquide ou de carte bleue si tous les commerçants proposent de payer via une application permettant de tout faire. WeChat compte déjà plus de 200 millions d’utilisateurs étrangers, principalement en Asie du sud-est, mais pas seulement. Les occidentaux travaillant avec des partenaires chinois se rendent vite compte qu’il est plus facile de communiquer par WeChat, très répandu dans le domaine professionnel, que par E-mail, peu utilisé en Chine. L’essor de l’application chinoise en Amérique et en Europe pourrait donc se faire par la sphère professionnelle et le développement commercial lié au tourisme.
Facebook fait de la résistance
Nous étions habitués à voir le marché chinois copier le marché occidental, mais aujourd’hui, l’inverse pourrait bien se produire. Difficile d’imaginer que Facebook laissera WeChat lui prendre des parts de marché sans réagir. En témoignent les nouvelles fonctionnalités développées notamment sur Messenger. Il est désormais possible d’envoyer de l’argent directement depuis la messagerie de Facebook, ce qui n’est pas sans rappeler le système des « enveloppes rouges » du géant chinois. De même, Facebook a ouvert sa marketplace permettant de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de différents produits, sans pour autant permettre la transaction depuis la plateforme.
Facebook tente de rendre son public de plus en plus captif en lui proposant toujours plus de services. D’autant plus que Facebook a annoncé que son système publicitaire était arrivé à saturation : intégré plus de liens sponsorisés nuirait à l’expérience utilisateur et risquerait de leur faire perdre des internautes. Pour continuer à se développer, le réseau de Mark Zuckerberg doit trouver de nouveaux relais (98% des revenus de Facebook viennent de la pub). L’exemple de WeChat, dont le modèle économique repose principalement sur les commissions lors de transactions et la monétisation de leurs jeux (seuls 18% des revenus viennent de la pub) pourrait fortement inspirer Facebook.
Ces « super apps » posent toutefois un problème majeur, celui de l’utilisation des données. Une application dont on est captif et qui subvient à tous nos besoins récolte un nombre incalculable de données sur chaque utilisateur. On sait déjà que le gouvernement chinois profite des datas de WeChat pour surveiller sa population. Ainsi, les thèses de Michel Foucault dans son ouvrage Surveiller et Punir semblent trouver un sens nouveau. D’un régime disciplinaire, on passe à une surveillance plus discrète. Pour autant, chacun se sait sous surveillance en permanence. De quoi s’interroger quant aux effets d’une sorte de panoptisme digital.
Nicolas Morteau
Twitter : @N_Morteau
LinkedIn : Nicolas Morteau
Sources :
Davan-Soulas Melinda, WeChat, le réseau social multifonctions qui gère la vie des Chinois débarque en France, LCI, publié le 09/07/2017, consulté le 23/10/2017.
Fabrion Maxence, Proche des 2 milliards d’utilisateurs, Facebook voit son chiffre d’affaires augmenter de 49% au 1er trimestre, Frenchweb, publié le 04/05/2017, consulté le 23/10/2017.
How WeChat Became China’s App For Everything, Fast Company, publié le 01/02/2017, consulté le 24/10/2017.
Noisette Thierry, WeChat : « Notre stratégie pour nous développer en Europe », L’Obs, publié le 07/04/2016, consulté le 24/10/2017.
Crédits :
Crédit vidéo : The New York Times, How China Is Changing Your Internet | The New York Times, publié le 09/08/2016
Crédit photo : www.thedrum.com