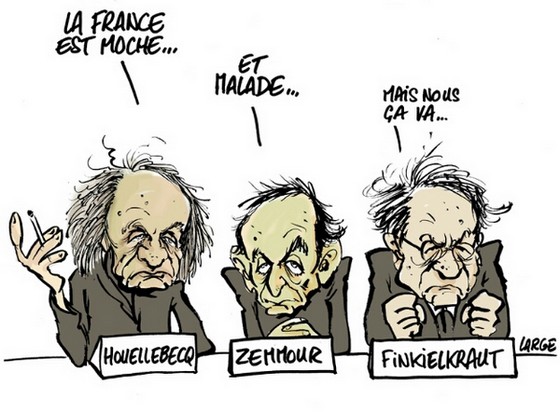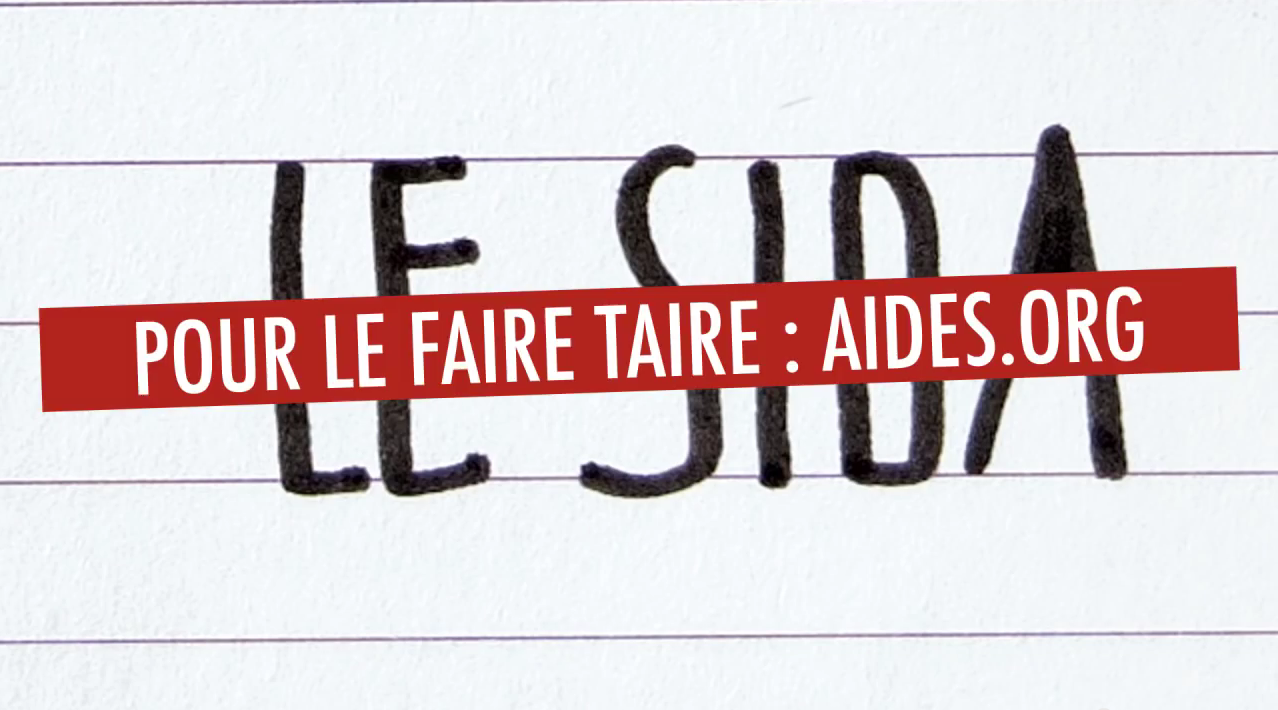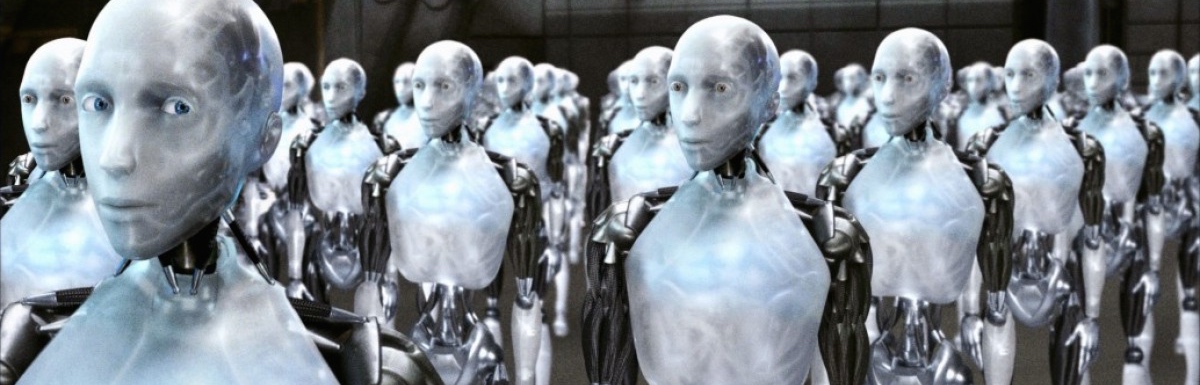The Trump show
Magnat de l’immobilier, star et producteur d’une émission de téléréalité et aujourd’hui, candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump est plus qu’un simple homme d’affaires. C’est un phénomène médiatique et politique.
A quatorze mois des élections, les sondages le donnent largement gagnant pour la primaire Républicaine. Trump écrase ses adversaires avec au moins 30% d’opinions favorables. Des chiffres surprenants face au comportement médiatique du candidat, avant tout connu pour ses propos misogynes et racistes. Pourquoi ce qui devrait lui porter préjudice lui donne-t-il un statut de favori au sein de cette primaire républicaine?
Un discours populiste à la rhétorique bien huilée
Son discours d’annonce, prononcé symboliquement dans la Trump Tower, abordait les principaux thèmes de sa campagne. Des thèmes articulés autour d’un nationalisme assumé qui pointe notamment du doigt la Chine comme un danger économique et diplomatique pour les Etats-Unis (« There are no jobs, because China has our jobs »). Un discours démagogique comme première arme pour toucher le cœur des électeurs.
Sa conclusion est éloquente : les Etats-Unis ont besoin d’un leader, d’un homme providentiel. Et cet homme n’est autre que lui-même. Le discours est percutant, les phrases courtes, imaginées comme des slogans dont on retient l’essentiel : Donald Trump « is going to make the America Great again ». Le schéma est simple : « eux », les politiciens, le gouvernement, les médias, ne sont pas capables de rendre aux Etats-Unis leur statut de leader mondial. « Eux », les pays étrangers, les immigrés illégaux « nous » mettent en danger. Ce sont « eux » contre « nous », le vrai peuple. Mais « moi », Donald Trump, je peux assumer ce rôle et c’est pourquoi je me présente. La rhétorique est efficace, en témoignent les sondages mais aussi son omniprésence dans les médias.
Une stratégie du scandale et du buzz médiatique
Cette rhétorique est couplée à une autre stratégie de communication : celle de faire le buzz. En effet, dès le lancement de sa campagne, Donald Trump a su créer la polémique. Sa déclaration sur les immigrés mexicains, les taxant de « violeurs », a été diffusée en continu sur les chaînes de télévision américaines, octroyant une place de choix à sa campagne sur la scène médiatique et dans les esprits des électeurs. Parallèlement, soulignant une fois de plus le paradoxe de sa montée dans les sondages, elle a également provoqué (à dessein) l’indignation de toute une communauté ainsi que des autres candidats républicains.
Sa popularité dans les sondages surfe également sur sa notoriété de star de la télé réalité. Cette identification des deux personnages créés – le showman et l’homme politique – repose sur la similitude de sa campagne avec un grand spectacle dans lequel le personnage de Donald Trump se met en scène dans le costume d’un homme politique. Il exerce une fascination liée à une attirance naturelle du spectateur pour tout ce qui est spectaculaire, divertissant, choquant. Un statut de vedette des médias que Barack Obama résume en ces termes « He knows how to get attention. He is the classic reality TV character ».
Enfin, comme l’explique le journaliste Howard Fineman dans le Huffington Post, son succès reflète un désenchantement politique. Il utilise une lassitude générale des hommes politiques classiques et surtout une érosion de la confiance populaire en la capacité de ces hommes à améliorer leur situation matérielle pour mettre en avant sa différence : c’est un homme d’affaires. Les Américains ne veulent plus d’un homme politique, ils veulent un gestionnaire efficace.
Le scandale permet donc d’attirer l’attention : l’électeur est plus attentif dès lors qu’un discours provoque en lui une réaction guidée par l’affect. Ainsi, sa campagne est avant tout articulée autour d’un constat qu’il fait du monde contemporain : les Etats-Unis vont mal, socialement, économiquement, et sur le plan militaire. Il instille ainsi la peur, celle de l’étranger, de la concurrence, de la destruction du système américain dans la conscience américaine : les Etats-Unis ne sont plus ce qu’ils étaient.
Un buzz dont l’efficacité est mesurable dans les sondages mais aussi sur les médias sociaux.
L’homme se finance seul : une image du rêve américain, celle du « self-made-man », et un argument pour revêtir ce costume d’homme qui dit la vérité, qui dit non au politiquement correct parce qu’il n’est pas manipulé par les différents lobbies. Pas de campagne de publicité à la télévision ou sur YouTube donc. Un compte facebook, un compte Twitter et un site internet. Mais près de quatre millions de likes sur Facebook et 4.38 millions de followers sur Twitter. A titre de comparaison, Hillary Clinton totalise « seulement » 1.5 millions de likes sur Facebook et Ben Carson, « seulement » 719 000 followers sur Twitter. Donald Trump n’est pas seulement un invité régulier des médias : il est une star sur internet. Donald Trump est en effet le nom le plus recherché sur Google parmi tous les candidats à la présidentielle. Sa personnalité outrancière exerce une véritable fascination sur les électeurs américains, qui le retrouvent sur les réseaux sociaux pour suivre ses clashs par tweets interposés et ses commentaires de l’actualité. Une fascination entretenue mutuellement par les médias et par le public, par le biais des sondages d’une part et de la couverture de l’actualité de l’autre.
How many trumps has he now ? (« Combien d’atouts a-t-il encore ? »)
Le personnage de Donald Trump ne s’est pas construit politiquement, sur un programme ou des idées fortes, mais sur des icônes, un slogan et sa personnalité. Son comportement heurte les fidélités partisanes : par ses propos insultants et haineux, mais aussi par sa vantardise omniprésente (« I beat China all the time »). Il entraîne une inertie du débat politique et neutralise ses adversaires. Il est ainsi perçu comme un danger par ses adversaires républicains : il est l’homme à abattre.
Cependant, sa stratégie ne tient qu’à un fil : l’attention que lui portent les médias et le public. Sera-t-elle toujours récompensée dans les sondages dans les 14 mois de campagne restants ?
Julie Andréotti
Sources :
https://www.donaldjtrump.com/
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_Republican_Party_2016_presidential_primaries
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/27/donald-trump-sondages-election-presidentielle-americaine-2016_n_7881178.html
http://www.rollingstone.com/politics/news/obama-on-trump-i-dont-think-hell-end-up-being-president-20151012
Crédits photos :
Daily News