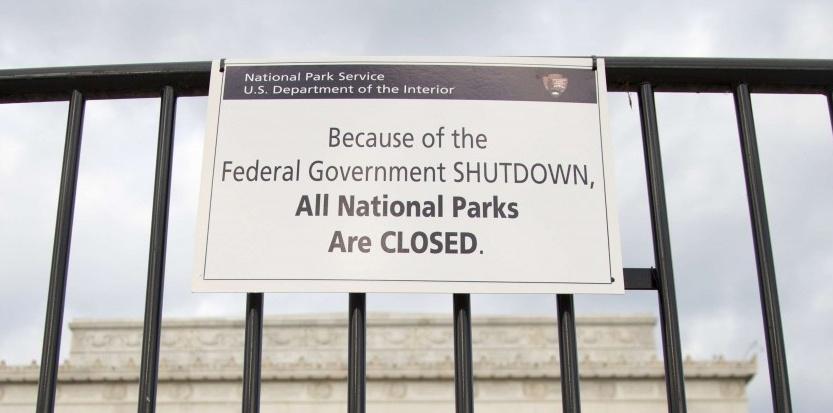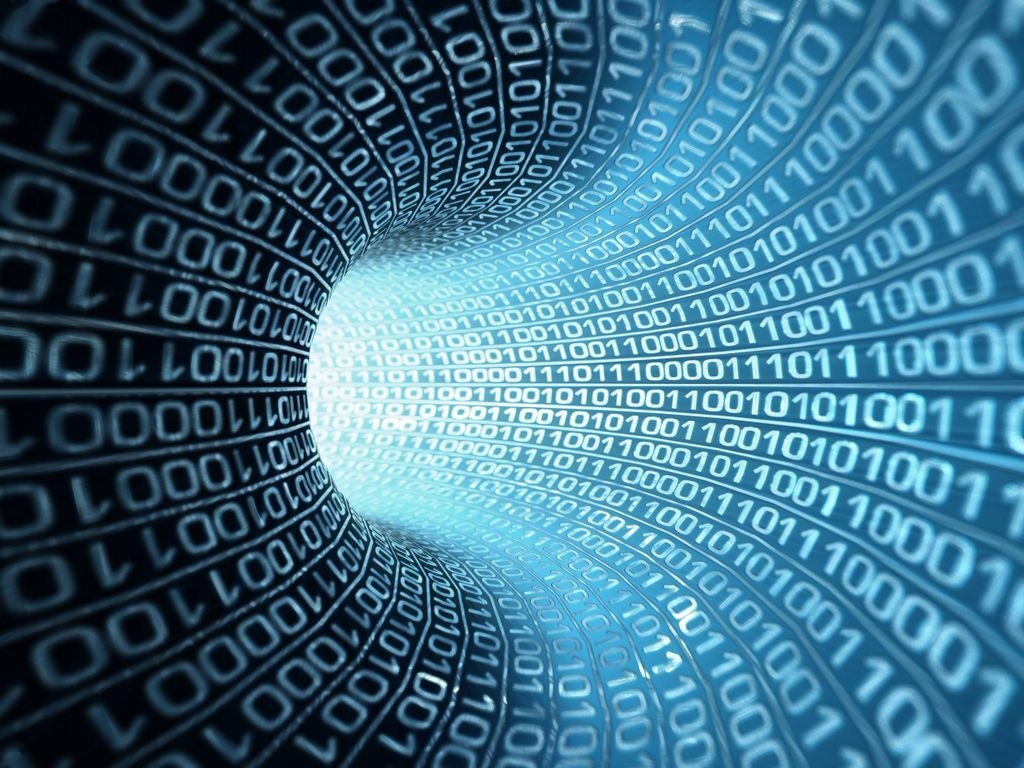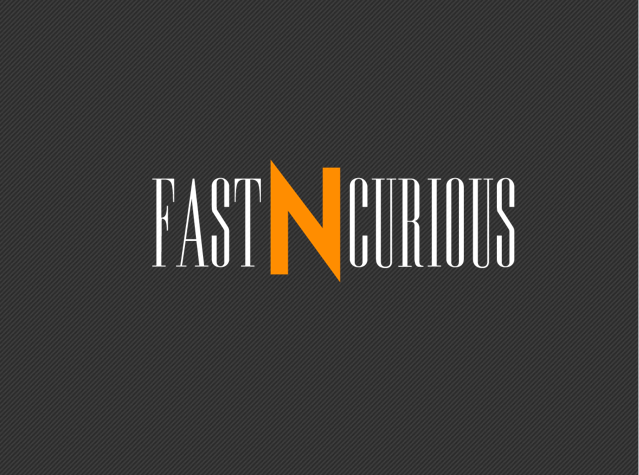ou le jeu de mots subtil entre « stripteaseuse » et « performeuse burlesque »
Aujourd’hui, laissons la place à Marta Brodzinska, spécialiste du Burlesque, qui nous éclaire sur l’enjeu des différentes représentations médiatiques et sociales de ce mouvement artistique, dont on a pas fini d’entendre parler.
Avril 2012, Milan, Italie : Silvio Berlusconi est inculpé pour avoir payé une jeune femme mineure pour des services sexuels et abusé du pouvoir de sa fonction en exigeant de la police de la libérer, après avoir été accusée de vol. Durant le procès, l’opinion publique découvre que l’ex premier ministre organisait des soirées privées dans une de ses résidences, impliquant la présence de nombreuses stripteaseuses et possiblement de prostituées déguisées notamment en bonnes sœurs, ou encore portant des masques représentant des joueurs de football célèbres. Les médias appellent l’affaire « Bunga Bunga » et le scandale provoque l’indignation et le dégoût de l’opinion publique. Mais l’hédoniste numéro un de l’époque rejette toutes les accusations. Quand on l’interroge sur la présence de jeunes femmes déguisées lors de ses soirées privées, il admet qu’il organisait simplement des « jeux de burlesque ». Pourquoi a-t-il choisi cet argument parmi un tas d’autres pour défendre sa cause, comme s’il espérait qu’une représentation d’une forme d’érotisme légitime était socialement partagée et pouvait par extension lui « sauver la face » ? Et s’il avait raison, si celle-ci existait réellement, pourquoi la société considérerait-elle le « striptease pur » comme quelque chose de « bas », donc illicite, quelque chose que l’on cache des autres, et placer le burlesque de l’autre côté, comme quelque chose de « haut », permis, voir digne de montrer aux autres, et conforme à une norme, qui vaut le coup d’être définie. Enfin, comment une « effeuilleuse burlesque » se différencie-t-elle d’une stripteaseuse ?
Depuis le début des années 1990, on peut observer un retour phénoménal d’un ancien genre du show-business américain, adapté par l’Europe et très vite par les autres parties du monde, appelé burlesque. Après avoir défini un genre littéraire et cinématographique, le mot « burlesque » appartient désormais à une forme de spectacle qui naît à la fin du XIXème siècle et qui connaît un fort succès jusqu’aux années 1950. Aujourd’hui, le « nouveau burlesque » a su reprendre les codes de l’ « ancien » représentant une danse légère, sensuelle et glamour ou la danseuse finit par enlever son costume pour dévoiler son corps. Mais pour donner sa forme moderne, le burlesque a du s’imprégner aussi des idéologies post féministes qui lui donnent une toute nouvelle allure. Ainsi se créent deux formes actuelles du burlesque – distinction contestable car suggérée par certains « performeurs » alors qu’elle est considérée comme infondée pour d’autres : le burlesque classique, reprenant tous les codes de la forme ancienne et le « new burlesque », parfois appelé aussi le « neo burlesque » qui est sa version déjantée et souvent comique, où les codes de la sexualité comme de la sensualité sont fréquemment détournés. Aujourd’hui le phénomène « burlesque » touche tous les pays occidentaux et est devenu une véritable mode. En France, chaque grande ville compte au moins une association chargée d’organiser des cours et des spectacles de burlesque. Son public grandit très vite, souvent proportionnellement à l’intérêt que les médias y portent, intérêt qui est très important depuis le début des années 2000. Aujourd’hui, la plupart des métropoles occidentales comme New York, Toronto, Berlin et Paris, compte son festival international du burlesque. Jacki Willson explique le caractère et donne une définition à ce phénomène dans son livre The Happy Stripper (2010), où elle rappelle la naissance de la Jo King’s London School of Striptease, la première école de striptease en Europe, dédiée aux étudiantes âgées de 18 à 76 ans :
King (Jo) a fondé cette école parce qu’elle voulait que les femmes aient confiance en elles-mêmes et en leurs corps. Le phénomène du burlesque est connecté à cette mode du striptease et « pole/lap dance » par son affirmation de l’expression sexuelle des femmes. Mais contrairement au striptease pur, le burlesque a une pique. C’est un genre parodique et érotique fondé sur le second degré et le décalage. La performeuse burlesque se retourne vers son public, elle sourit et à travers son sourire, elle interroge son audience, autant qu’elle interroge sa propre performance. Performance qui est comique, excentrique, coquine et provocatrice mélangée à une esthétique du vintage. Le burlesque c’est le « bas » envahissant le « haut ». Le burlesque intègre d’une manière provocante et insolite la culture de masse en adoptant ses formes-le théâtre, le cabaret, le spectacle vivant, la comédie, le crique, la danse moderne, sans jamais en prendre l’une de ces formes trop au sérieux.
Si l’on revient aux accusations de Berlusconi, ses explications peuvent paraître spontanément ridicules, mais la construction de son argumentaire relève d’une tentative de légitimation plutôt réfléchie. Car si le burlesque n’est pas censé être pris trop au sérieux, les « jeux de burlesque » contrairement aux « orgies » imaginées par l’opinion publique ne devraient pas l’être non plus. Le Burlesque ne se donne pas à voir, ni l’est d’ailleurs par les médias, comme le striptease « traditionnel », étiqueté comme un geste sexiste, immoral, voir impur. Le burlesque est en fait une forme d’art et se définit comme le prolongement des mouvements post féministes valorisants la femme et l’expression de sa sexualité. L’ex premier ministre italien peut donc librement considérer que rien n’est mal dans l’organisation des « jeux du burlesque », bien au contraire. Il aurait pu organiser « La France a un incroyable talent » dans sa cave, la gravité des faits aurait été du même poids.
La comparaison avec un talent show n’est pas uniquement ironique. En réalité, la société italienne a brillamment intégré la mode de l’art du burlesque au sein de ses médias. L’Italie a été le premier pays du monde à créer une version burlesque des talent shows comme « The Voice », ou « American Idol » appellé « Lady Burlesque ». Il s’agit d’un programme ou un jury spécialement constitué pour l’occasion se déplace dans tout le pays pour trouver la meilleure performeuse de l’Italie. Silvio Berlusconi, si bien connu pour sa relation intime avec les médias aurait simplement su suivre la vogue, entre les murs de sa résidence privée. Mais comment le monde du burlesque lui-même réagit-il à cette confusion, cette frontière incertaine, entre le burlesque et le striptease ? Est-ce que les performeuses se décrivent toutes comme des « stripteaseuses heureuses » pour reprendre le terme utilisé par Willson ?
La réponse varie énormément selon quel performeur, quel média, ou encore quel public choisit-on d’interroger, mais surtout selon la culture du pays où ce nouvel-ancien genre de l’industrie du spectacle se développe depuis la « folie burlesque » que l’on peut identifier dès les années 2000. Jo Weldon, performeuse mondialement célèbre, directrice de la New York School of Burlesque et auteure du premier manuel du burlesque, affirme sans gène ces origines dans le striptease « traditionnel ». Jacki Willson de son côté assume fermement le terme « striptease burlesque ». Dita Von Tease, celle qui a sans doute le plus médiatisé le burlesque de nos jours à l’échelle mondiale, consacre une page de son livre Burlesque and the art of tease à toute une liste de synonymes plus adaptés que le mot « stripteaseuse », en même temps rappelant que Gypsy Rose Lee, l’icône du burlesque à l’ancienne a en fait préféré le mot « stripteaseuse ». Juliette Dragon, la directrice de l’Ecole des Filles de Joie, dit parfois à ses étudiantes, qu’elle ne devraient pas vouloir à tout prix fuir le mot « striptease », et montre par ses cours que leur striptease a elles est quelque chose de tout à fait digne et socialement désirable. Ce qui importe n’est pas le fait d’enlever ses vêtements ou pas, mais la manière dont on le fait et l’intention qu’on y donne. Ses propos, souvent rappelés durant les spectacles de l’école, donne à voir une approche post féministe du mouvement. Le nouveau burlesque a ses propres codes concernant l’effeuillage. Par exemple, on ne peut jamais montrer ses tétons sans les couvrir de « nippies ». Certaines performeuses refuseront de montrer leurs jambes sans collants résilles pour des raisons tantôt idéologiques, tantôt esthétiques. La « stripteaseuse burlesque » décide avant tout elle-même si elle veut s’effeuiller et si c’est le cas, ce qu’elle a envie de montrer à son public. Beaucoup de performeurs diront que dans le burlesque on a droit de ne pas le faire du tout ou bien d’enlever seulement un gant, si selon l’artiste cela est suffisant pour sa visée artistique du spectacle. Il existe également des normes assez universelles que l’on peut remarquer lors des spectacles du burlesque en France. J’ai pu voir des spectacles, ou, si un homme se met à crier « à poil » lors de l’effeuillage d’une des artistes, son numéro est interrompu immédiatement pour laisser la place à l’homme en question, qui sera demandé de s’effeuiller à son tour, sur scène, devant le même public, sinon il est invité à quitter la salle.
Certains médias diffusent des programmes qui se servent du mot « burlesque » en excluant entièrement de son contexte le geste d’effeuillage. J’ai récemment regardé un épisode de The best : le meilleur artiste, un nouveau talent show sur TF1 où l’on pouvait entendre l’animateur décrire comme « cabaret burlesque » le numéro de l’artiste de cirque Polina Volchek. Si elle a présenté un numéro bel et bien impressionnant de hoola-hop, elle n’a toutefois ôté aucun de ses vêtements. Ce qui a été présenté au public comme « cabaret burlesque » était en fait une expression de l’esthétique du numéro : l’artiste portait un corset et dansait sur la musique du film « Moulin Rouge ». Il a suffit d’inclure ces deux références qui font appel à l’imaginaire commun du burlesque pour que le numéro puisse être classifié comme tel. L’expression « burlesque », adjectif qui décrit une esthétique plutôt qu’il ne désigne une mise à nu, a été repris par l’industrie de la mode, où l’on a classifié comme « burlesque » le défilé de la créatrice Betsey Johnson pour sa collection printemps/été 2012. Mais l’exemple le plus frappant du burlesque « puritain » est le film Burlesque, réalisé par Steve Antin en 2010, où à aucun moment on ne fait intervenir de l’effeuillage. Le réalisateur a décrit visuellement, et donc donné à voir aux spectateurs du film le genre « burlesque » comme « cabaret burlesque », donc sans nudité, par opposition au « striptease burlesque » . De l’autre côté de l’océan, Mathieu Amalric propose la même année le film Tournée, qui met en scène une troupe de burlesque américain, le Cabaret New Burlesque. En engageant dans son film de vraies performeuses qui pendant le film jouent les mêmes numéros que dans la vraie vie, Amalric propose une vision beaucoup plus réaliste de ce qu’est le genre aux Etats-Unis, en y incluant naturellement la nudité avec tous ses aspects, artistiques, comme idéologiques. Pourtant les deux films, proposant une vision très différente du burlesque sont aujourd’hui souvent cités à la même échelle comme ceux qui ont participé à la médiatisation du burlesque moderne.
En France de nombreux articles, et formes télévisuelles présentent des femmes, bonnes mères de famille, femmes au foyer, ou travailleuses qui performent le burlesque dans leur temps libre dans le but d’accepter leur corps, de stimuler leur féminité ou simplement pour le « fun ». Le burlesque est mis alors en scène comme une thérapie. Mais en Pologne, en 2012, les médias révèlent un scandale : une école d’enseignement supérieur organise un concours de beauté lors duquel les candidates se promènent sur scène en lingerie avec une gestuelle à connotation sexuelle forte. L’école parle d’une « performance burlesque », mais l’opinion publique en décide autrement. Les médias décrivent l’événement comme un dérapage, mais impossible de savoir à quel moment la limite entre la vulgarité et le burlesque « noble », donc post féministe a été transcendée. La Pologne n’a pas su supporter l’hyper sexualisation de cette compétition, car une miss ne peut pas évoquer une « stripteaseuse » rappelant toute une symbolique de la domination masculine, dont la miss moderne, dotée elle aussi d’une lourde histoire, doit à tout prix se distinguer.
Le phénomène burlesque souligne la tension dans notre société entre le « bas » et le « haut » de la sexualité, et inspire de nombreuses questions sur la libération sexuelle des femmes. Les médias participent sans doute grandement au phénomène de « mainstreamisation » de la sexualité, mais quelle sexualité est en réalité socialement acceptable et légitime ? L’ « attitude burlesque » est mise en scène comme « assumer sa sexualité de femme », « aimer son corps », ou encore « être maitresse de soi-même». Mais le mot « striptease » est parfois dissimulé par les médias pour souligner le jeu de mots subtil entre « stripteaseuse », mot du stigmate, et « performeuse burlesque », mot d’artiste.
Marta Brodzinska
Sources :
Jacki Willson, “Tha Happy Stripper: Pleasures and Politics of the New Burlesque”(I.B Tauris, 2007)
Lady Burlesque: su Sky Uno il talent show… si svela!
Jo Weldon, “ The Burlesque Handbook” (It Books, 2010)
http://www.theatredurondpoint.fr/saison/fiche_spectacle.cfm/153557-cabaret-new-burlesque.html
« Tournée », Mathieu Amalric (2010)
Ditta Von tease, “Burlesque and the art of tease” (It books, 2006)
http://www.telleestmatele.com/article-video-the-best-le-meilleur-artiste-23-aout-2013—numero-de-hula-hoop-avec-polina-volchek-119676530.html
http://www.dailymotion.com/video/xl2s06_betsey-johnson-s-burlesque-show_news
http://plejada.onet.pl/mam-talent
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,13806044,SGGW_przeprasza_za_polnagie_wybory__Naganne_zachowania.html
Crédits photos :
Photo 1: Performeuses du cabaret Burlesque Babylone lors du spectacle Babylone Circus http://www.burlesque-babylone.com; photo : © Hervé Photograff
Photo 2: Performeurs Seb Zulle et La Môme Patchouile, au Pretty Propaganda de Louise de Ville ; photo : © Gilles Rammant http://www.gillesrammant.com