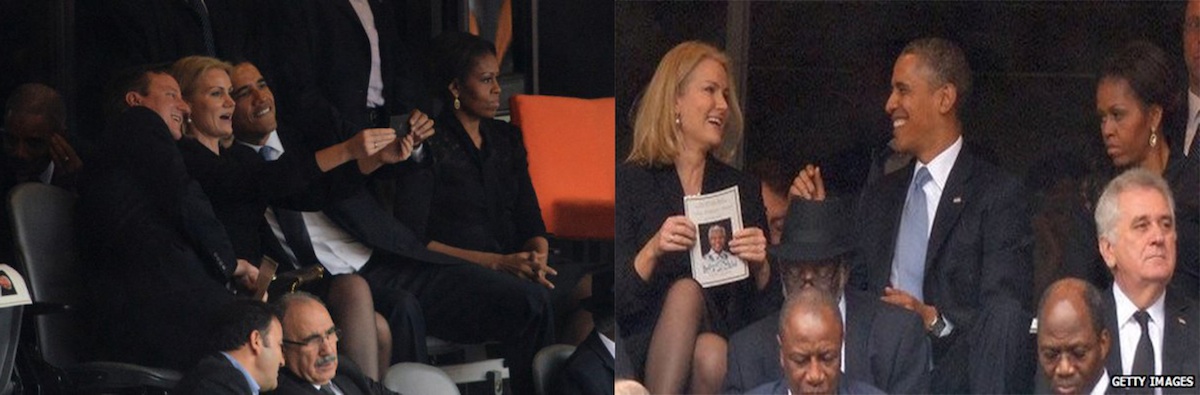Communication de recrutement : à la recherche du candidat idéal
Nous le savons, poursuivre des études est moins un moyen de se réaliser qu’un enjeu stratégique : c’est un investissement sur l’avenir. Accumulation des stages, évitement de certains cursus qui n’auraient pas assez de débouchés professionnels, allongement des années d’études… Avant même d’y entrer, le marché de l’emploi semble être une jungle hostile où l’offre doit rivaliser d’ingéniosité pour avoir le Curriculum Vitae le plus original, le plus fourni, le plus international, afin de séduire une demande toujours plus exigeante.
Face à cette morosité ambiante, le nouveau bureau de FastNCurious a voulu analyser la question du recrutement sous un autre angle : les entreprises, elles aussi, adoptent de véritables stratégies de communication afin de recruter le candidat idéal. A l’occasion du 9ème Forum des Entreprises organisé par le CELSA le 3 décembre dernier, nous sommes allés à la rencontre des exposants professionnels afin de bénéficier de leur expertise dans le domaine des ressources humaines. 64 entreprises s’étaient spécialement déplacées pour rencontrer les étudiants du CELSA.
Rappelons que le recrutement est, pour l’entreprise, la base d’un fonctionnement interne optimal. Il est même essentiel en ce qu’il représente une perte d’argent et de temps considérable en cas d’incompatibilités entre la personne engagée et les objectifs de l’entreprise. La communication de recrutement sert donc à attirer les profils les plus adaptés à ses métiers et ses valeurs, mais aussi à valoriser et à positionner l’entreprise comme un futur employeur de choix auprès de sa cible : les étudiants et les jeunes diplômés.
On pourrait penser que la communication de recrutement se scinderait en deux types d’approches : l’une massive élaborée par les grandes entreprises et institutions déjà bien connues du grand public, et une autre négligée par les PME ayant peu de moyens à lui consacrer. Pourtant, les choses sont bien plus complexes.
Les vecteurs d’attractivité des entreprises
Créer un lien à la source
Dans certains cas, la communication de recrutement permet d’engager une relation « gagnant-gagnant » entre les employeurs et les futurs candidats. La plupart des entreprises sélectionnent des écoles cibles dont elles connaissent la qualité de l’enseignement et l’efficacité des étudiants. Puisque ces derniers sont très convoités au sortir de leur formation, il s’agit de communiquer et de créer du lien avec eux très rapidement, à la source si possible. Ainsi, les étudiants des écoles reconnues dans leur domaine peuvent être amenés à rencontrer tout au long de leur cursus des salariés, devenus ambassadeurs de leur entreprise. Ces rencontres peuvent être pédagogiques avec l’organisation de sessions de simulation d’entretiens ou encore la réalisation d’un plan de communication. Ceci permet aux étudiants d’appliquer leurs connaissances à des problématiques réelles et à l’entreprise de bénéficier d’un nouveau regard gratuitement.
Les Forums Entreprises : le choix d’un recrutement qualitatif
La solution la moins chronophage pour aller à la rencontre des étudiants et qui reste avantageuse pour les deux parties, c’est une présence sur un Forum Entreprises organisé par une école. Cet espace spécifiquement dédié au recrutement facilite la procédure de recrutement grâce à un contact direct avec l’étudiant-candidat et permet de cibler les profils spécifiques recherchés par l’entreprise. C’est le choix du qualitatif face au quantitatif. A l’image de TNS Sofres qui reçoit des centaines de candidatures sans grand renfort de campagnes de recrutement, il lui est cependant essentiel de participer aux Forums des grandes écoles pour dénicher les profils véritablement en adéquation avec les postes proposés.
De la même manière, l’agence de communication WordAppeal, a adopté une stratégie de recrutement ciblée sur ce qu’elle désigne comme étant les 5 grandes écoles françaises : HEC, l’ESCP, l’ESSEC, Sciences Po et le CELSA.
Chaque entreprise présente sur le Forum des entreprises du CELSA avait ses problématiques propres. Ainsi, la Banque Postale et la Société Générale voient dans la communication de recrutement un moyen de compenser la faible attractivité du secteur bancaire et financier auprès des étudiants des écoles de communication. Ces derniers ne pensent pas spontanément à effectuer leur stage dans une banque alors que de nombreuses offres existent. Plus qu’un objectif de visibilité, les banques ont la volonté de communiquer sur leurs métiers et les opportunités qu’elles peuvent offrir à ce public étudiant.
Pourtant, participer au Forum d’une grande école n’est pas la solution miracle à toutes les problématiques de recrutement. Cela reste un investissement qui ne s’avère rentable que si l’entreprise a un nombre suffisant d’offres à proposer.
Qu’en est-il du recrutement 2.0 ?
Pour l’ensemble des annonceurs et agences interrogés, investir dans des actions de communication de recrutement est une stratégie payante notamment en termes de gain de temps. Las de recevoir en entretien des candidats peu ou pas informés sur les spécificités de leurs métiers ou de leur cœur d’activité, beaucoup préfèrent opter pour une présence en ligne sur les « jobboards ». Ainsi, en plus de leur site institutionnel, il est devenu courant de retrouver des fiches métiers ou des témoignages d’employés sur des sites tels que Studyrama ou JobTeaser.
Il est intéressant de noter que, même pour les structures les plus importantes, le recrutement sur les réseaux sociaux n’en est qu’au stade du balbutiement. Interrogées à ce sujet, entreprises et agences avancent l’explication suivante : investir le Web demande beaucoup de temps et donc une personne qui maîtrise ces questions. De plus, utiliser Viadeo, LinkedIn ou les réseaux sociaux traditionnels pour valoriser sa marque-employeur nécessite d’être continuellement à jour, au risque d’être inefficace. Enfin, cette présence sur les réseaux sociaux professionnels doit répondre à une véritable stratégie, et toutes les structures n’ont pas vocation à les intégrer dans leur communication de recrutement.
Les nouveaux acteurs et enjeux de la communication de recrutement
Les jobboards
De nouveaux acteurs du marché de l’emploi comme Studyrama ou JobTeaser ont compris l’enjeu stratégique de la communication de recrutement et ont investi le secteur, proposant leurs services aux entreprises qui ont pris conscience de l’importance de leur communication de recrutement.
Le dynamisme de JobTeaser représente bien cette tendance, principalement en ligne. Depuis sa création en 2008, il ne cesse d’élargir son offre afin de répondre aux nouveaux enjeux dans le recrutement des étudiants. Là où il se distingue des autres jobboards, c’est par son implantation directe dans les grandes écoles, via l’intranet et la constitution d’ambassadeurs, afin de proposer aux entreprises d’être au plus près de leur public cible.
Les labels employeurs comme plus-value
La communication de recrutement s’adresse en priorité à de potentiels futurs collaborateurs mais aussi à ses actuels et anciens employés qui en sont les premiers représentants en dehors de l’entreprise. Alors, comment valoriser leur expérience ? Les classements et labels « meilleur employeur » se multiplient et constituent une véritable plus-value pour les entreprises qui y figurent. A titre d’exemple, Le « Label Stage Advisor » de JobTeaser plébiscite les employeurs les plus appréciés par les stagiaires tandis que le classement Universum désigne les entreprises qui font le plus rêver les étudiants. Ainsi, grâce à ces nombreux sondages, il devient possible d’évaluer l’efficacité d’une stratégie de communication de recrutement ainsi que son potentiel de marque-employeur.
Même si l’éventail des actions de communication de recrutement semble large, il faut noter que les politiques engagées par les grandes entreprises s’adressent à un public cible restreint et hautement qualifié. De nos multiples entretiens, il en ressort que CELSA reste une valeur sûre lorsqu’une entreprise recherche des profils d’étudiants en communication. Une conviction fondée sur les classements et la réputation historique de l’école, mais aussi et surtout sur un retour d’expérience des stages des Celsiens, qui « se passent en général très bien ».
Alexandra Ducrot et Camille Primard