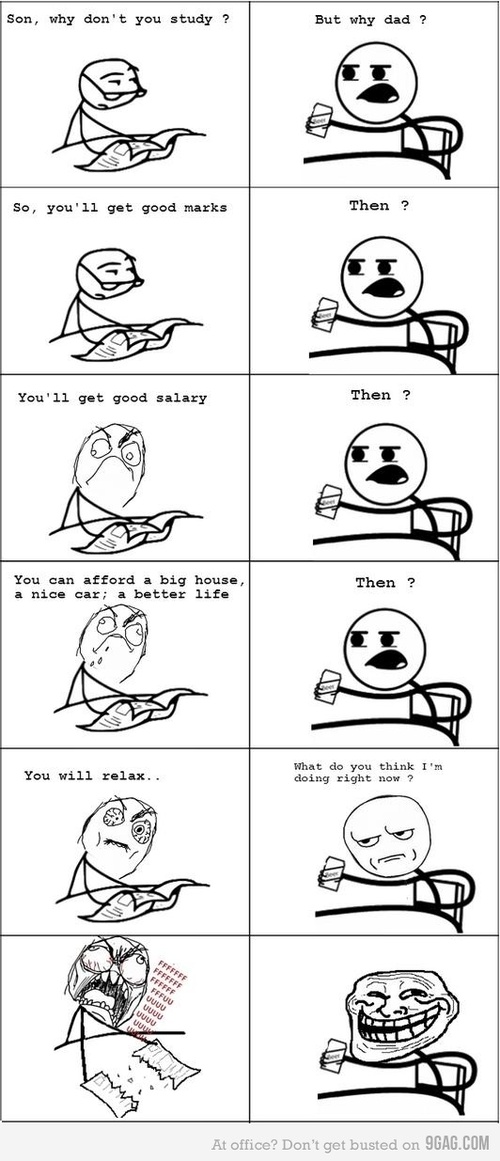The Mistaken Identity
On le sait tous, enfin tous ceux qui ont vu le chef d’œuvre cinématographique The Social Network, Facebook est né d’une envie de vengeance et de valeurs peu catholiques. Alors quoi de plus étonnant que l’usage parfois « détourné » que l’on en fait maintenant ? Dans une vision du monde toute rose, Facebook ne serait qu’un réseau destiné à nous réunir en toute convivialité pour un pur moment d’amitié bien ordonnée. Seulement, une fois les lunettes de soleil hyper kitsh ôtées du pif on se rend vite compte qu’il n’en est rien. Sans tomber dans l’extrême malveillance, il me semblait intéressant de vous faire part d’une récente expérience.
Je ne vous apprends rien en vous disant que Facebook est la plateforme rêvée pour lancer des rumeurs en tout genre. Les statuts apparaissent depuis longtemps sur un fil d’actualité visible par tous les contacts (et parfois plus) mais cela ne fait que quelques mois que les statuts jugés les plus intéressants restent en haut de l’affiche afin d’être vus et revus par tous ceux qui auraient eu la malchance de ne pas les lire dès leurs postages. Les photos prennent de plus en plus d’importance. Celui qui a dit qu’une image valait un millier de mots devait être un fan des Motivational Pictures : ces fameuses photos que les gens se postent sur leurs wall respectifs entourées d’un cadre noir avec un message parfois moqueur, parfois blagueur.
J’aurais adoré que l’on m’explique le rapport entre le nom qui leur a été attribué – Motivational – et l’actuelle photo visible sur mon fil d’actualité d’une femme au fessier important se tenant devant une voiture conduite par un chien…
Enfin, je divague, mon but n’étant pas du tout de vous parler d’un chien très doué mais d’une simple expérience. Hier matin, la filière Marketing, Publicité, Communication du Celsa a été conviée à une conférence des plus intéressantes sur le Branding par le Groupe Medinge. Ce groupe, basé en Suède, est un Think-Tank ou laboratoire d’idées qui décerne chaque année les prix « Brands with a Conscience »*. Tout ça pour dire que nous étions entourés de têtes pensantes dont une qui a particulièrement attirée notre attention. Sur la base d’un quiproquo, une femme du nom de Brigitte Stepputis a été confondue avec Vivienne Westwood. Il semblerait que cette femme travaille pour la marque mais n’ayant été présentée que sous le nom de celle-ci, vous comprenez bien que nous ayons eu un doute. Sans compter que la ressemblance physique (de dos) était trompeuse. D’un élan enthousiaste, mes doigts font leur chemin sur le clavier pour partager au mieux cette information :
En quelques minutes seulement, mon statut a été liké plus de fois que mes derniers statuts mis ensemble (vous me direz, je suis pas bien populaire non plus). Alors que les likes augmentaient, le fait que personne ne remette en question la véracité de cette information me taraudait. En effet, il m’est apparu que de plus en plus de gens tendaient à croire naïvement ce qu’ils lisent sur Facebook. En dehors de la première dimension gossip du site – qui ne nous leurrons pas est aussi la raison de notre présence accrue – on peut également trouver celle de l’actualité, mais pas n’importe laquelle. L’internaute se plaçant en médiateur n’est pourtant jamais incité à prouver la véracité de ses propos. Bien au contraire, il a tendance à être instantanément cru car qu’en retirerait-il ? Surtout que dans un objectif de m’as-tu-vu, légitimé par le site, il serait bien mal venu de sa part de propager une information dite d’actualité qui soit fausse.
Ou bien, on peut se demander s’il est véritablement important que celle-ci soit véridique ou non, tant qu’elle alimente les débats… On en revient donc à la bonne vieille rumeur et à toutes les conséquences dévastatrices qu’elle peut engendrer. Sans tomber dans l’exagération, il faut reconnaître que la plupart restent gentillettes.
Il me fallait tout de même vous le dire, mon statut était faux !
Brigitte pardonne nous notre ignorance…
Marion Mons
Crédits photo : ©Le Bon Marché / Agence : Les Ouvriers du Paradis