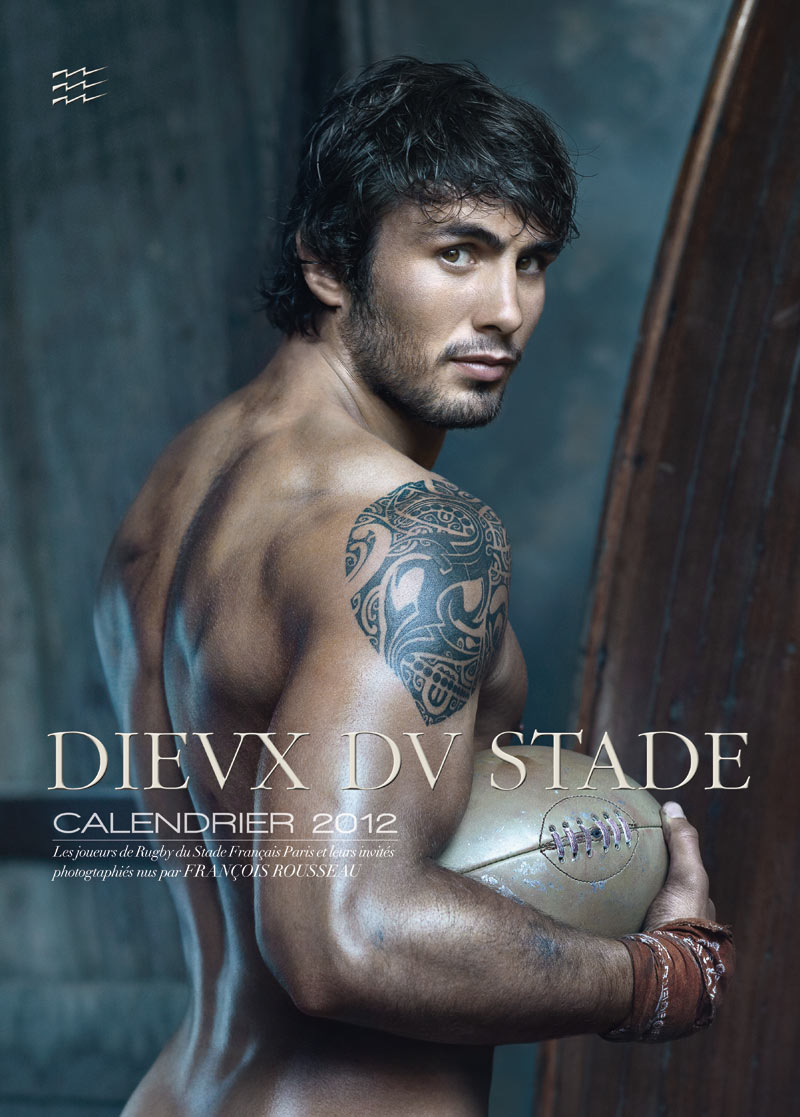« Je crois que bon… »
6 juillet 2010. Boulevard de Grenelle, siège de la Fédération Française de Football.
Les journalistes sportifs rapatriés de Johannesbourg sont là pour assister à la première conférence de Laurent Blanc en tant que boss des Bleus. L’ex-Bordelais pénètre dans la salle de presse avec son combo chemisette bleue ciel et pull Lacoste noué autour du cou. La dégaine d’un premier communiant. Forcément on est obligé de se taper un retour ému sur les événements de Knysna et l’épisode du bus. Lolo sue beaucoup et lit clairement ses fiches pour éviter tout raté sur le sujet chaud du moment. Bon… ça commence bien. On a connu entrée en matière plus charismatique.
À l’époque, Blanc traine la figure du sauveur, avec pour seule mission, celle de faire aimer à nouveau ce foutu maillot frappé du coq. Challenge accepted. Il était de toute façon entendu qu’il ne pourrait pas être plus mauvais que son prédécesseur aux gros sourcils. Donc si défi il y a, il est clairement à sa portée.
Pourtant l’état de grâce ne va pas durer bien longtemps ; guère plus que celui du père Mitterrand en 1981. En effet à la mi-avril, Mediapart veut se faire son petit WikiLeaks à la française — toute proportions gardées donc. D’après le journal en ligne, Blanc et ses copains de la FFF voulaient se lancer dans une refonte « bleue Marine » de la formation des jeunes footballeurs. Il était question de privilégier la technique au physique, discriminant de fait, selon la logique toute singulière de Blanc, les « Blacks » qui seraient « grands, costauds, puissants » selon les mots du sélectionneur des Bleus. Ouïe, premier caillou dans les crampons du « Président ».
Ainsi, il va s’avérer difficile de faire aimer une équipe dont les responsables refuseraient des gosses de 13 ans — les Bleus de demain — sous prétexte qu’ils sont « trop costauds » autrement dit « trop colorés ». Finalement Mister White s’en sort blanc comme neige après la double commission d’enquête commandée par le Ministère des Sports, où on avait sans doute un peu peur de perdre l’homme dit « providentiel ». Allez trouver un entraineur pour reprendre l’Equipe de France à un an de l’Euro…
Le deuxième coup de trique va se jouer à la fin de l’été 2011. Se trouve alors mis en cause Jean-Pierre Bernès, agent de Laurent Blanc et d’une dizaine d’internationaux français. Au cours d’un rassemblement à Clairefontaine, Florent Malouda — qui ne fait pas partie de l’écurie Bernès — se serait plaint de l’omnipotence de l’agent, dénonçant un hypothétique favoritisme de Blanc envers les poulains de JPB. Les premiers suspects sont vite identifiés: Rami et Menez — clients de Bernès — trustent les places de titulaires bien que les deux postes ne manquent pas de concurrence. Lorsque l’on connait la valeur financière de l’étiquette « international français » pour un joueur, on est en droit de s’interroger sur les intentions de l’attelage Bernès-Blanc. Rappelons que Wanderlei Luxemburgo — ex-sélectionneur du Brésil — avait touché des pots de vin d’agents de joueurs contre la distribution de capes internationales.
Alors certes, tout n’est pas noir pour Laurent Blanc. L’EdF va à l’Euro en Polo-Ukraine sans passer par la case « barrages », l’équipe est invaincue depuis 17 matchs — comme celle de Domenech entre 2004 et 2005 d’ailleurs. Mais alors que sa mission était de faire oublier le camouflet sud-africain — symbole d’un foot business individualiste —, Blanc a fait planer les soupçons du racisme et du copinage sur cette même équipe, et sur la Fédération. Au fil des casseroles, le « Président » a fermé sa communication comme Domenech avait pu le faire et semble ainsi perdre son pari de rendre cette équipe accessible et aimée.
PAL