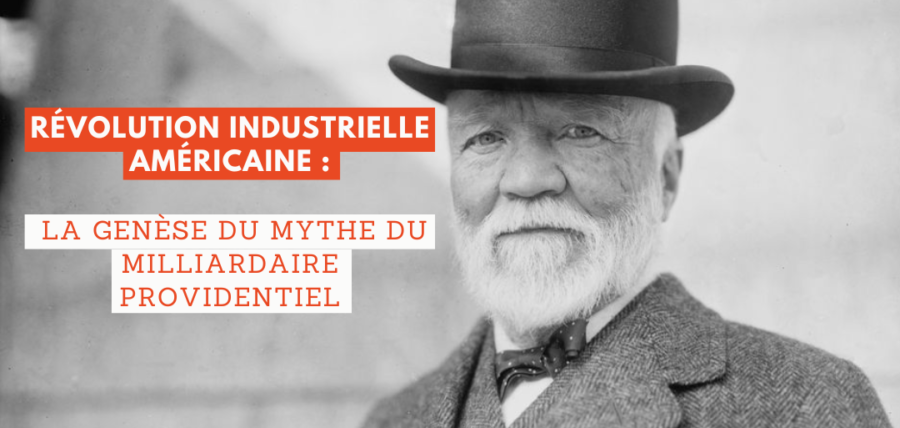
Révolution industrielle américaine : la genèse du mythe du milliardaire providentiel
Les États-Unis, au crépuscule du XIXe siècle, s’affirment comme un géant économique en pleine ascension. Cette période expose autant les vertus que les dérives de l’ultralibéralisme. Le capitalisme, dans sa forme la plus brute, enfante des magnats dont la domination s’étend bien au-delà de l’économie. Les monopoles qui naissent alors concentrent richesses et influence entre les mains d’une poignée d’oligarques, leur pouvoir s’avérant parfois supérieur à celui du gouvernement, dictant ainsi un nouvel ordre socio-économique où l’économie privée supplante progressivement l’autorité publique.
Les acteurs clés
Dans cette ébullition socio-économique, trois figures s’imposent. John D. Rockefeller, à la tête de la Standard Oil Company, tisse un monopole impénétrable, phagocytant ses rivaux et modelant les prix du marché pétrolier à sa guise. Andrew Carnegie, maître de la sidérurgie, fait de la
Carnegie Steel Company un colosse de l’industrie de l’acier, révolutionnant la production grâce à des procédés innovants et à une rationalisation du travail. Enfin, J.P. Morgan, stratège financier, orchestre la consolidation industrielle en créant, en 1901, l’United States Steel Corporation, premier empire sidérurgique intégré verticalement aux États-Unis, établissant ainsi une mainmise inédite sur l’industrie américaine. Mais leur emprise ne s’arrête pas à l’économie. Ces milliardaires, loin d’être de simples hommes d’affaires, s’immiscent dans la sphère politique, orientant les décisions et bridant l’intervention de l’État, tout en modelant à leur avantage les structures légales et fiscales du pays.
Déviance de l’État par la philanthropie
La philanthropie, du grec philos (amour) et anthropos (homme), désigne l’ensemble des actions menées volontairement pour le bien public, généralement par le biais de dons financiers ou d’initiatives sociales. Elle se veut l’expression d’un altruisme désintéressé, mais dans le contexte du capitalisme américain, elle se mue en instrument d’influence et de préservation des privilèges. Aux États-Unis, elle devient un levier de pouvoir. Refusant l’idée d’un État providence, ces industriels préfèrent investir directement dans des initiatives sociales, contournant ainsi les institutions publiques et imposant leur vision du progrès. Andrew Carnegie, dans son essai La Richesse, théorise la redistribution éclairée des fortunes, préférant l’action privée à l’impôt. Toutefois, cette générosité est loin d’être désintéressée. Au-delà des avantages fiscaux, elle permet à ces bienfaiteurs autoproclamés de façonner la société à leur image, influençant l’éducation et les valeurs collectives. Ils ne se contentent pas de donner : ils orientent, ils modèlent, ils pérennisent leur suprématie en s’assurant que la vision qu’ils défendent se perpétue au fil des générations. Derrière cet élan apparent de générosité se cache une stratégie savamment orchestrée. Les philanthropes, en finançant des institutions académiques et culturelles, assurent la transmission de leur idéologie et maintiennent un pouvoir intellectuel sur les générations futures. Ce contrôle discret, ce dispositif, renforce un ordre établi où les ultrariches conservent leur position dominante, en instillant un modèle de société conforme à leurs propres intérêts.
Ainsi, la philanthropie ne se limite pas à une simple redistribution des richesses, elle est une architecture complexe servant une finalité bien précise : garantir la pérennité d’une aristocratie financière sous couvert d’humanité et de bienfaisance. En façonnant l’éducation, en dictant les codes culturels et en influençant la recherche scientifique, ces mécènes modernes perpétuent un système où la charité se substitue insidieusement à la justice sociale.
Un héritage contemporain
Cette défiance à l’égard de l’intervention étatique perdure aujourd’hui. Les États-Unis restent une terre de milliardaires omnipotents, où les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) s’inscrivent dans la lignée des tycoons du XIXe siècle. Leur influence ne se limite pas l’économie numérique ; elle s’étend à la politique, aux médias et à l’éducation, façonnant insidieusement l’avenir. Comme Rockefeller et Carnegie avant eux, certains prônent un libéralisme exacerbé, une vision politique, à l’image d’Elon Musk, tandis que d’autres s’emploient à construire un empire philanthropique, à l’instar de Bill Gates. Si les formes évoluent, le principe demeure : une mainmise économique habilement enveloppée dans un discours salutaire, justifiant et perpétuant l’ordre établi.
Rousseau et la critique de la philanthropie
Jean-Jacques Rousseau fustige la philanthropie dans Discours sur les Richesses, dénonçant l’illusion d’une générosité qui ne sert qu’à masquer l’oppression économique : « Quelle étrange route, pour aller au bien, que de commencer par mal faire, et de tendre à la vertu par tous les vices qui la détruisent. » Pour lui, seule la main visible de l’État peut réguler les inégalités, car elle s’affranchit des intérêts particuliers, a priori. Si l’action philanthropique est tributaire des valeurs et des ambitions de ses bienfaiteurs, elle demeure une stratégie plutôt qu’un réel engagement démocratique. En revanche, une politique publique structurée tend à réduire les inégalités sans privilégier une caste au détriment du reste de la société (dans une vision pure du Contrat social)*1.
Ainsi, sous ses atours de vertu, la philanthropie s’inscrit comme un mécanisme de conservation des privilèges plutôt que comme une remise en cause du système inégalitaire qu’elle prétend combattre, ancrant ainsi l’ordre établi dans une narration habilement élaborée.
1* : En l’espèce, l’espace politique démocratique est lui aussi constitué d’intérêts propres, de déterminismes sociologiques favorisant une certaine classe et d’influences externes ou privées.
Fabien Vernat
