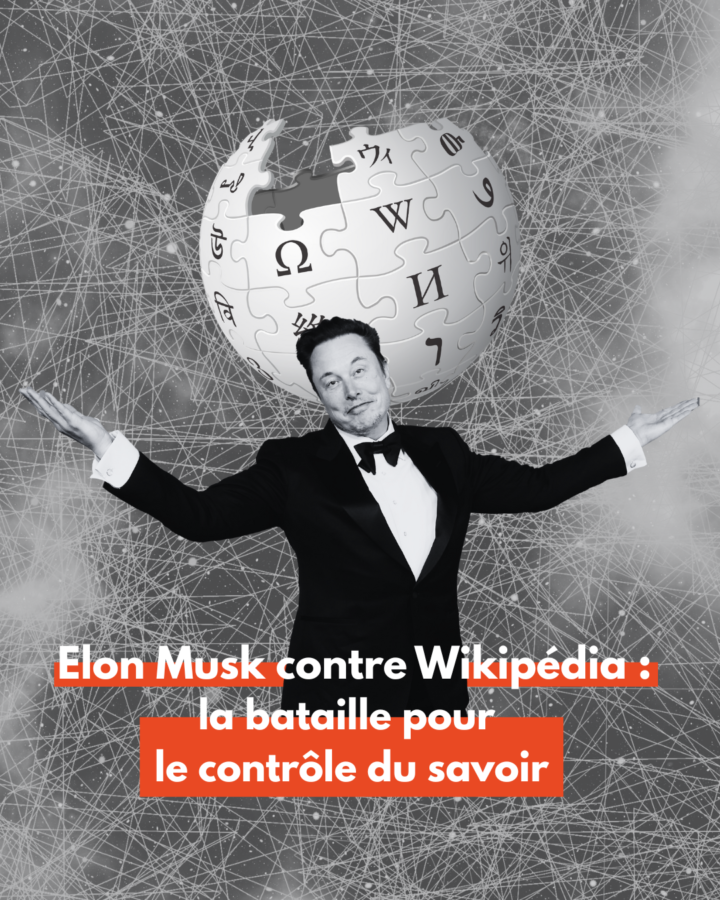
Elon Musk contre Wikipédia : la bataille pour le contrôle du savoir
Article Rédigé par Ambroise Perbost
Wikipédia est dans le collimateur des conservateurs américains. Depuis quelques années, la plateforme collaborative est accusée d’être devenue un outil de propagande progressiste, qui trahit son idéal de neutralité. Ces attaques ne sont pas restées sans suite. Elon Musk en a fait son cheval de bataille et promet désormais une alternative « objective », intégralement générée par intelligence artificielle.
Derrière cette querelle se joue un enjeu autrement plus fondamental : qui décide de ce qui est vrai ? Qui a le pouvoir de définir le savoir commun ? En filigrane, c’est le contrôle de la vérité qui est en jeu.
Le savoir comme champ de bataille
Dans les milieux conservateurs américains, le diagnostic est sans appel : Wikipédia serait tombée aux mains d’une idéologie woke décidée à réécrire l’histoire. En s’appuyant sur les grands médias et la recherche universitaire, elle ne ferait que reproduire un consensus qui écarte d’emblée toute lecture réactionnaire des faits.
Wikipédia n’est pas exempte de biais, c’est indéniable. Les chercheurs les documentent depuis des années : contributeurs majoritairement masculins, forte présence de diplômés, déséquilibres thématiques. Mais la polémique actuelle cible autre chose : les pages sur des sujets brûlants, les mouvements sociaux, les figures politiques controversées, ou les débats de société. Sur ces terrains minés, la neutralité est un exercice périlleux parce que le consensus académique lui-même est disputé. Toujours est-il que, par sa logique collaborative, Wikipédia rend ces tensions visibles et négociables.
Là où les choses se gâtent, c’est que l’offensive quitte le terrain des idées pour viser directement les contributeurs du site. L’hebdomadaire Le Point, par exemple, qui qualifie Wikipédia de « machine à calomnier », a menacé de révéler l’identité de plusieurs éditeurs du site. Or, Wikipédia tient grâce à un tissu fragile de bénévoles et de médiations. Intimider celles et ceux qui s’y investissent, c’est tenter de désarticuler un modèle éditorial fondé sur une participation volontaire. Et c’est dans ce climat délétère de suspicion qu’émerge le projet ambitieux de remplacer Wikipédia par une infrastructure concurrente, non pas pour corriger ses biais, mais pour leur substituer un autre récit.
Grokipedia ou l’illusion de neutralité
Dans cette guerre sainte contre Wikipédia, Elon Musk caracole en tête. Depuis des années, il vilipende l’encyclopédie libre et jure d’en « purger la propagande ». Sa promesse tient en quelques mots : remplacer le travail humain des contributeurs par celui d’une intelligence artificielle soi-disant neutre et parvenir ainsi à un savoir pur de toute controverse. Après le rachat de Twitter en 2022, Musk entend désormais annexer la production du savoir. Se réclamant de « la vérité, toute la vérité, rien que la vérité », il lance le 27 octobre 2025 Grokipedia, une encyclopédie dite « objective », générée par son propre modèle d’IA.
Il suffit cependant de gratter un peu le vernis publicitaire pour que l’édifice se fissure. Plusieurs analyses ont examiné les sources utilisées et ont mis en évidence des biais structurels qui sautent aux yeux. Contrairement à la neutralité affichée, Grokipedia repose sur un corpus de sources clairement orienté, qui mélange sans distinction des médias d’extrême droite et des plateformes conspirationnistes comme InfoWars.
Ces glissements ne sont pas des accidents de parcours, ils irriguent le contenu même des articles les plus sensibles. La page dédiée à Adolf Hitler s’ouvre sur les réformes économiques du Troisième Reich, la construction d’autoroutes et le recul du chômage, avant d’évoquer, au troisième paragraphe seulement, les politiques d’extermination raciale du régime. Grokipedia présente aussi l’esclavage américain avec les arguments qu’on utilisait autrefois pour le justifier, et décrit l’assaut du Capitole avec une certaine complaisance envers les émeutiers. Son objectif est limpide : réhabiliter ce qui a été condamné par l’histoire.
Mais le cœur du problème est ailleurs : Grokipedia opère en boîte noire. Impossible d’y trouver un historique des modifications, un espace pour débattre, ou même les critères qui ont guidé le choix des sources. Là où Wikipédia expose au grand jour ses querelles intestines, Grokipedia efface soigneusement toutes les traces de fabrication.
Si le mécanisme produit beaucoup, et vite, avalant le million d’articles en quelques semaines, il se heurte à une impasse structurelle. Le système repose sur un enchaînement simple et circulaire : l’IA génère des articles qui deviennent ensuite la matière première du corpus sur lequel la même IA est entraînée pour produire d’autres articles.
Piégée dans un système en circuit fermé, la machine ingurgite ses propres productions, régurgite sans cesse les mêmes tournures, et finit par s’embourber. Chaque erreur est reprise, amplifiée, recyclée en matière première pour de nouveaux textes. Grokipedia érige ses approximations en vérités et tourne en rond dans un savoir qui ne se nourrit que de lui-même. Elle produit une connaissance circulaire et autoréférentielle. Ce risque théorique deviendrait concret dès lors qu’il n’existe aucun mécanisme de correction externe. Or, c’est précisément la direction que semble vouloir prendre Musk, où seul compte l’alignement avec sa vision du monde.
En se posant en rivale de Wikipédia, Grokipedia supprime précisément ce qui en fait la force : la construction collective du savoir et la confrontation des points de vue. Elle déroule un récit sans aspérités, verrouillé, qui reflète avant tout celui qui l’a conçue.
La tentation d’un savoir sans personnes
Grokipedia ne sort pas de nulle part. Son émergence s’inscrit dans un mouvement plus large : le retour en force d’un anti-intellectualisme assumé, qui brandit le « bon sens » contre l’expertise universitaire et traite les chercheurs en simples idéologues. L’historien américain Richard Hofstadter en avait déjà décrit les rouages il y a soixante ans. Mais aujourd’hui, le phénomène a explosé, porté par quelques personnalités influentes et par la viralité des réseaux.
Aux États-Unis, sous l’administration Trump, des pans entiers de la recherche sur le climat, la santé publique, ou la lutte contre les discriminations ont été liquidés. En Argentine, Javier Milei taxe gaiement les universités de « nids de gauchistes » et brandit la menace sur leurs financements. Ces offensives obéissent à la même partition : les institutions du savoir seraient infiltrées de part en part par une idéologie progressiste qui travestirait la vérité. Lorsqu’il accuse Wikipédia d’être « contrôlée par des activistes d’extrême gauche », Musk ne fait que ressasser ce vieux refrain déjà éculé.
Aujourd’hui, Wikipédia tient presque lieu de rempart, elle perpétue la promesse d’un Web coopératif, transparent, qui échappe aux logiques marchandes. Elle n’est certes pas exempte de défauts, mais elle défend un principe élémentaire : le savoir se forge dans la confrontation des points de vue, et ce processus de fabrication doit demeurer transparent. C’est justement ce modèle ouvert qui révulse les partisans d’une vérité monolithique.
Grokipedia promet tout autre chose : un savoir direct, qui tombe tout cuit. Son succès symbolique tient à un pari risqué selon lequel la machine serait plus fiable que la communauté des experts et des citoyens. Or, les modèles d’IA ne produisent aucune neutralité ontologique ; ils ne font que reproduire les biais, les obsessions et les angles morts des données qui les ont nourris. Gavez-les de sources conspirationnistes, ils vous serviront du complotisme en boîte. Gorgez-les de préjugés, ils les érigeront en dogmes.
Ce basculement ne relève pas du simple choix technique, il charrie une autre idée du politique. Le philosophe Jacques Rancière, dans ses travaux sur la démocratie, défendait l’idée que celle-ci repose sur un postulat fondamental : l’égalité des intelligences, c’est-à-dire la capacité de tout individu à comprendre, débattre et participer à l’élaboration d’un savoir commun. Le projet d’Elon Musk part de l’hypothèse contraire : celle d’un utilisateur impatient, pour qui la compréhension des mécanismes de vérité est superflue. Il suffirait de s’en remettre à la machine pour toucher une vérité lavée de toute controverse.
L’histoire des encyclopédies dessine une trajectoire émancipatrice, celle d’un savoir qui, siècle après siècle, s’arrache aux mains de quelques-uns pour se donner au plus grand nombre. Diderot et d’Alembert l’ont arraché aux clercs. Wikipédia en a fait un chantier ouvert à tous, désordonné mais bien vivant.
Grokipedia rompt avec cette histoire. Elle enferme le savoir dans une machinerie opaque, propriété d’un seul, imperméable à la contradiction. Sous ses airs de neutralité algorithmique, elle organise méthodiquement l’atrophie de notre esprit critique.
