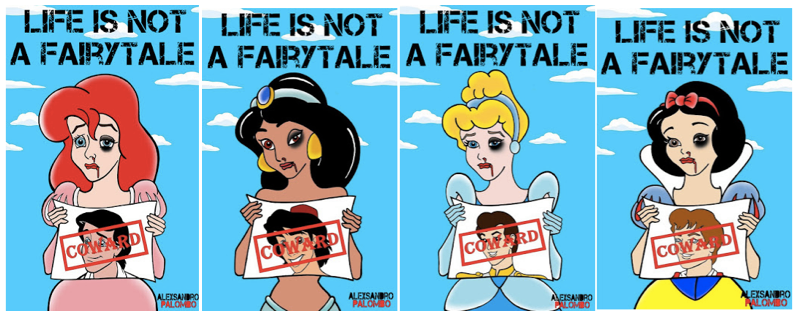Le biopic Dalida, ou comment raconter la vie d'un autre
Le 11 janvier sortait le premier film biographique sur Dalida. Ce long-métrage réalisé par Lisa Azuelos a fait couler bien de l’encre avant sa sortie en salle, notamment lorsque Catherine Morisse a dénoncé le portrait peu fidèle et très négatif de son père, premier mari de Dalida. Ce « grosso scandalo », pour reprendre l’un des titres de la chanteuse, n’est pas sans rappeler tout l’enjeu d’un biopic : capturer une vie sans la réécrire.
Lisa Azuelos est certes la réalisatrice du long-métrage Dalida, mais le projet est d’abord porté par Orlando, frère et manager de la chanteuse. Orlando a voulu promouvoir la carrière posthume de Dalida en sortant des albums et des inédits. Le biopic est une autre occasion de préserver la mémoire de sa sœur. Par ailleurs, en 2005, un premier téléfilm biographique avait été réalisé par Joyce Buñuel.
Le film biographique Dalida ne se concentre pas sur le suicide de la chanteuse, précisément parce que « sa vie et sa mort sont les deux faces d’une même pièce. Pour la comprendre, on ne peut pas en faire l’économie. Et toutes les phases de sa vie artistique et amoureuse sont intéressantes… ç’aurait été un crève-cœur d’en laisser de côté ! » (Azuelos)
Orlando a eu le contrôle sur le scénario et sur le choix des acteurs incarnant sa sœur et lui-même. Le frère-manager a également partagé ses archives personnelles afin que Sveva Alviti puisse incarner au mieux le rôle principal. Alors, gages de véracité ?
Reconstituer des vies
Le biopic Dalida est donc le fruit de la collaboration entre la réalisatrice Azuelos et Orlando, tous deux animés par le désir de raconter la vie de l’icône. Azuelos a voulu expliquer le parcours de Dalida, de son enfance à sa mort. Et son suicide est précisément une autre des raisons pour lesquelles Dalida tient autant à cœur à la réalisatrice. La vie de Yolanda Gigliotti n’a pas été un long fleuve tranquille, et pourtant, les nombreux drames qu’elle a vécu n’ont pas obscurci l’éclatante carrière de celle qui se faisait appeler Dalida. Le long-métrage a un objectif précis : qu’on la comprenne et « que l’on excuse son geste final », affirme Azuelos.
En 2017, beaucoup de films biographiques se partageront l’affiche, comme par exemple Jackie et Neruda, tous deux réalisés par Pablo Larraín. Si Dalida retrace l’ensemble du parcours de la chanteuse éponyme, en général, les biopics isolent quelques moments clefs. C’est effectivement le cas de Jackie, qui nous fait découvrir la première dame des États-Unis après l’assassinat de son mari JFK.
Quitte à les réécrire
Réaliser un biopic, c’est tenter de capturer une vie sur un écran. Le recul est nécessaire, autrement le danger de l’image trop lisse, de la reconstitution bancale, de l’histoire fantasmée guette… Et justement, certains ont reproché à Dalida de ne pas être assez objectif. Catherine Morisse, fille du premier mari de Dalida, s’est indignée de l’image négative que renvoie le film à propos de son père. Lucien Morisse serait représenté comme financièrement dépendant de la chanteuse et comme – beaucoup – plus âgé. Le Lucien de vingt-sept ans est joué par un acteur qui en a cinquante. Or un des autres enjeux d’un biopic est que l’acteur ressemble à la personne dont on retrace le parcours : si pour certains l’un des critères d’un biopic est la ressemblance physique, ici, le personnage de Lucien n’est même pas reconnaissable par sa personnalité. Catherine Morisse reproche à l’équipe du film le manque de mention de possibles dérives dans la représentation de Lucien. Elle regrette aussi ne jamais avoir été consultée pour vérifier quelque information.
Un autre enjeu majeur dans la réalisation d’un biopic : comment compacter l’essence d’une vie en deux heures ? Pablo Larraín voit cela comme impossible, et présente Neruda comme un anti film biographique. Dans une entrevue accordée à Trois Couleurs, il dit du poète et homme politique chilien qu’il était bien plus que cela : « Il avait une vie si multiple… Comment faire rentrer cet homme dans un film ? Impossible. C’est donc un anti biopic. »
Une fin heureuse
Le film biographique présente quelques avantages. Tout d’abord, la notoriété de la célébrité que l’on porte à l’écran assure aux producteurs un minimum de rentabilité. Julien Rappeneau, scénariste du film biographique Cloclo, considère que ce genre « est plus facile à vendre et à promouvoir qu’une histoire originale, car le personnage est déjà connu. Un biopic, c’est un peu comme une marque. » De cette assurance vient le budget, comme l’illustre le long-métrage Yves Saint Laurent de Jalil Lespert puisque celui-ci a bénéficié de douze millions d’euros. Un autre critère intervient dans le financement : celui de la star dont on réalise la biographie. Neruda a été financé par Participant Media, société de production américaine qui veut promouvoir des films aux visées sociales et développer le cinéma de pays émergents.
De l’autre côté de la caméra aussi des avantages subsistent. En effet, le film autobiographique peut lancer une carrière. Les cas Jamie Foxx dans Ray, ou encore Marion Cotillard, qui s’est affirmée à l’international en interprétant La Môme, en sont la preuve, bien que cela ne soit pas universalisable.
Le biopic pour développer une image de marque
Réaliser un film biographique apparaît comme le moyen de remettre une personnalité au goût du jour (Dalida) mais aussi d’affirmer une légende. C’est le cas des deux biopics The Social Network et Jobs, dont les réalisateurs ont décidé d’isoler l’épisode où l’homme est devenu légende. Le but du premier est de présenter le début de Facebook et Mark Zuckerberg. Quant au second, il veut nous présenter l’individu derrière l’icône. Le biopic Jobs profite bien au culte d’Apple, marque mondialement connue.
Si l’on a reproché à Jobs son manque d’objectivité, il rend évident une chose : un biopic fait parler de son héros, qu’il l’idéalise ou le diabolise. Le genre du film biographique ne délivre donc pas de manière objective toute la vie de son personnage mais en offre plutôt une vision particulière. Et surtout, il nous fait (re)découvrir une histoire.
Victoria Parent-Laurent
Sources :
• BENEY Chris, « Quand les films tirés de faits réels déplaisent aux principaux concernés » Vodkaster.com, publié 23/01/2015, consulté 10/01/2017
• Allociné.fr
• MOSER Léo, « Un biopic sur Pablo Neruda avec Gael Garcia Bernal en préparation » Les Inrocks, publié 24/07/2015, consulté 08/01/17 et le 10/01/2017
• BLANC-GRAS Julien, « Il y a un biopic après la vie » Le Monde, publié 09/03/2016 consulté 10/01/2017
• BOSQUE Clément, « Jobs, le film : les cinq ingrédients indispensables pour faire un bon biopic » Atlantico, publié 21/08/2017, conulté 09/01/2017
• 20 Minutes, « ‘Dalida’ : a fille du premier mari de la chanteuse dénonce le biopic de Lisa Azuelos » 20 Minutes, publié 20/12/2016 (mis à jour 06/01/2017) consulté 08/01/2017
Crédits :
• Image extraite du film Dalida de Lisa Azuelos, crédits photos Luc ROUX
• Photo tuxboard.com
• Luis Gnecco en Pablo Neruda dans le film Neruda. Crédits photos Orchard