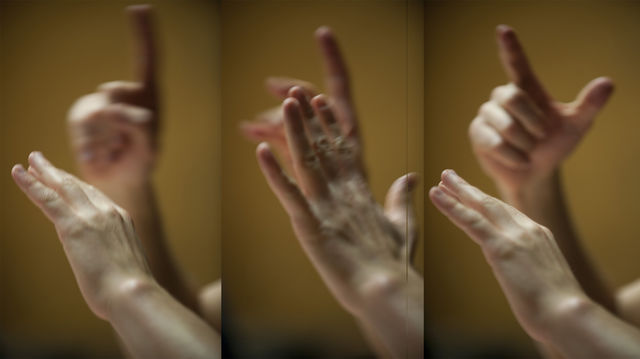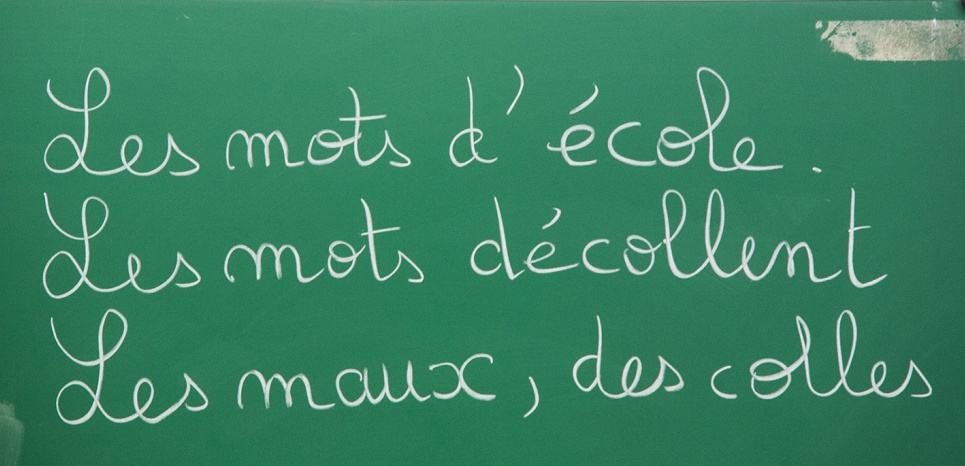Peut-être avez vous déjà entendu parler de Chris ß ? Aussi connu sous le nom de « Digital Jesus », cet ancien directeur du service informatique d’une grande société est à ce jour l’homme le plus connecté de l’histoire de l’humanité. Il ne dispose en effet de pas moins de 700 systèmes qui enregistrent quasiment tout de sa vie : pression artérielle, déplacement, activité physique, posture de son dos. Son histoire fascinante, aux airs de science-fiction, débute en 2007 lorsqu’il entend parler d’un mouvement alors tout récent : le quantified self.
Si cette histoire est extrême, elle en dit long sur notre rapport à la data et sur les fantasmes qu’elle entretient. Zoom sur cette obsession de l’auto-surveillance numérique.
Le teaser de Chris Dancy, réalisé par lui même.
Le quantified Self, c’est quoi?
Cette appellation futuriste désigne un ensemble de moyens technologiques et logiciels – comme les objets connectés ou les smartphones – conçus pour collecter et mesurer différentes données liées à notre corps. Ce mouvement a été baptisé du nom de « quantified self » en 2007 par Wolf et Kevin Kelly, deux éditeurs du magazine Wired, dédié aux nouvelles technologies. La distance parcourue par un individu, ses temps de sommeil, son poids et sa géolocalisation sont les mesures les plus répandues.
L’objectif principal du quantified self est d’inciter l’utilisateur à mieux gérer sa vie personnelle, que ce soit au niveau de sa santé, de sa productivité et/ou de son bien être, le plaçant ainsi comme entrepreneur de sa propre vie avec tous les fantasmes d’émancipations qui y sont liés.
Cet ensembles d’actions exercées sur soi – actions par lesquelles on se prend en charge et on se transforme – remontent à l’ Antiquité, à en croire Foucault. Ce qu’il qualifiait de « technique de soi » tend cependant à prendre des proportions de plus en plus extrêmes au fil des années.
Chris Dancy a poussé cette logique encore plus loin, en l’appliquant à des domaines ne faisant jusque là pas l’objet d’appréhensions comptables (sommeil, humeur, addictions, sexualité, etc.)
Pendant un an, il a gardé des traces de tout ce qu’il faisait et de tout les paramètres de son environnement grâce à des programmes qu’il a écrit pour l’occasion. Il a ensuite traité ses données et a commencé à changer certaines de ses habitudes (heure de sommeil, de déjeuner…) pour voir comment il réagissait . Petit à petit, il s’est créé un système entièrement personnalisé qui permettrait de gérer sa vie grâce à la data. « J’ai créé un GPS pour ma vie », dit-il lui-même.
Au bout d’un an et demi seulement, la transformation est radicale : il perd du poids, arrête de fumer, est moins impulsif et décroche même de la drogue.
De « Monsieur tout le monde » il est devenu un héros de la tech mondiale, invité partout pour partager son expérience et gagnant désormais environ un demi-million de dollars par an.
Si ce récit a des allures de success story, on ne peut pas s’empêcher de penser à la théorie célèbre de McLuhan ( « the medium is the message ») selon laquelle la forme du message est plus important que son contenu, dans la mesure où celle-ci façonne notre perception.
Si les hommes sont fascinés par ce pouvoir de prolonger son corps dans des outils à notre image, il n’en reste pas moins que « voir, percevoir ou utiliser un prolongement de soi-même sous une forme technologique, c’est nécessairement s’y soumettre » *.
« Connais toi toi-même » : la recette du bonheur ?
« N’est-il pas évident, cher Xénophon, que les hommes ne sont jamais plus heureux que lorsqu’ils se connaissent eux-mêmes, ni plus malheureux que lorsqu’ils se trompent sur leur propre compte ? » disait Socrate à l’un de ses interlocuteurs.
Pourtant, cette obsession de l’auto-surveillance a conduit Chris Dancy à une véritable fissure de son identité.
« Je commençais à manger des plats que je n’avais jamais aimés, à m’entendre avec des gens avec qui normalement le courant ne passait pas, à écouter de la musique que je n’avais jamais écoutée… Tout devenait différent. Je ne savais pas pourquoi, ni d’où ça venait. »
Entre toutes les versions de lui-même, alimentés par tous ses logiciels destinés à l’améliorer, Chris Dancy ne sait plus qui il est, son unité psychique se fissure. Il devient de plus en plus angoissé et commence à créer des programme afin de prévenir et empêcher, sinon contrôler, ses émotions les plus dérangeantes.
Cela prouve que si les activités sont liées au Quantified Self sont réflexives, c’est-à-dire qu’elles nous renvoient à nous-mêmes, elles ne permettent pas une meilleure connaissance de soi. On croit mieux connaitre notre corps alors que la médiation chiffrée éloigne notre rapport intuitif à nous-mêmes, aux autres et au monde.
Cette mathématisation du monde n’est pas nouvelle. Hannah Arendt décrivait le monde moderne comme une époque de changement profond, où se joue un nouveau rapport avec la connaissance scientifique, laquelle utilise un langage arithmétique et quantitatif qui nous fait perdre le monde empirique des sens.
Vers un « Mindful Cyborg »
Cependant, « croire qu’une technologie puisse nous rendre plus heureux traduit une immense fatigue d’être », nous prévient Alain Damasio (écrivain français en science fiction). Pour lui, nous n’avons pas encore exploré toutes les possibilités offertes par notre corps et notre cerveau. Le fait d’en déléguer certains segments aux nouvelles technologies consisterait à régresser, étant donné que le cerveau se développe lorsqu’on le sollicite.
Pire encore, le fait de traduire nos comportements sous des formes de chiffres, classés et hiérarchisés, pourrait finir par finir par engloutir notre capacité d’action. En créant des normes auxquels il faudrait conformer, on pourrait aboutir à une disparition de notre subjectivité. Cela n’est pas sans rappeler l’épisode « Chute libre » de Black Mirror (saison 3, épisode 1) où le système de notation régule la société, marginalisant ainsi tous ceux qui ne respecteraient pas la norme imposée.
Pour Chris Dancy, son histoire pourrait bien devenir la nôtre dans quelques années. Ainsi, il s’est donné comme nouvelle mission d’apprendre aux gens à ne pas se faire dévorer par les machines. Par le biais de ses séances de « méditation avec le smartphone », il prône un rapport plus conscient aux technologies et espère ainsi qu’on se souviendra de lui dans le futur.
To be continued.
Liana Babluani
LinkedIn
Sources :
Photo 1 : eduskopia.com
Photo 2 : hubsante.com
Photo 3 : notesfromachair.com
Photo 4 : gaite-lyrique.net
Vidéo : Page Youtube éponyme de Chris Dancy
Auteurs :
• Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (1958)
• Michel Foucault, L’herméneutique du sujet (2001)
• * Marshall McLuhan, Understanding Media: The extensions of man ( 1964)
Liens :
• « On a externalisé le corps humain », Alain Damasio ( telerama.fr )
• « Peut on compter sur la quantification ? », Valentin Lefebvre – 30/03/2016 (influencia.fr)
• « Big Data et quantification de soi : La gouvernementalité algorithmique dans le monde numériquement administré », Maxime Ouellet, Marc Ménard, Maude Bonenfant, & André Mondoux ( Canadian Journal of Communication Vol 40 – 2015 )
• « Heureux et traqués (avec le quantified self) », François Badaire – 07-02-2016 (blog de médiapart.fr)
• « Du quantified self au quantified bot , les risques d’une pratique en vogue », Xavier Comtesse – 11-02-2016 ( objetconnecte.com )
• « L’homme le plus connecté du monde s’est fait dévorer par ses données », Claire Richard – 09-09-2017 ( http://tempsreel.nouvelobs.com )
Références :
• Black Mirror – Saison 3, episode 1 (Chute libre)