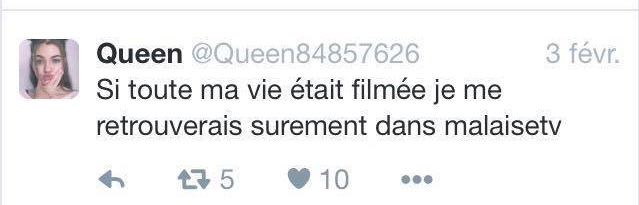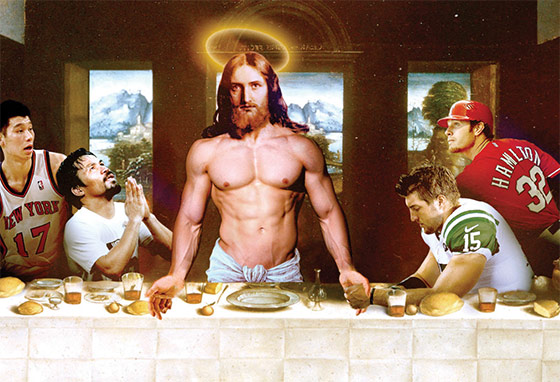Longue vie au podcast audio
Si les origines du mot podcast restent mystérieuses (contraction d’ « iPod » et de « broadcasting » ou initiales de « Program On Demand » ?) plus personne ne doute de son succès. Enfant de la radio et du web, le phénomène podcast – apparu pour la première fois courant des années 2000 – est assurément un petit protégé de la famille des transmédias. Alliant la fluidité de l’oral et la souplesse du digital, ce média s’érige en symbole gagnant de la remédiation. Auparavant utilisé comme moyen de rattrapage des émissions radios manquées, il se définit aujourd’hui comme un média en tant que tel.
L’audio x le digital = équation gagnante de l’infotainment
McLuhan disait « The content of any medium is always another medium ». En d’autres termes, toute médiation est par essence une remédiation : un contexte de média existant qui vient être transformé. Par exemple un film tiré d’un livre est une remédiation de ce même livre.
Dans le cas présent, les podcasts peuvent être décrits comme une version 2.0 de la radio. On y retrouve ainsi la relation d’animateur/auditeur (podcasteur/ auditeur). L’influence de la culture d’internet, toujours plus riche et variée, bouscule les programmes pour y proposer un large panel de sujets à la demande. Avec 80 millions de téléchargements, le reportage fiction Serial diffusé à l’automne 2014 aux Etats-Unis est le reflet de cet engouement pour les nouveaux formats audio qu’offre le podcast. Du divertissement à l’information, de la fiction au reportage, il mélange information et divertissement et cela plaît. France Inter, par exemple, a vu son nombre de téléchargements progresser de 50% entre les saisons 2013-14 et 2014-15.
Toutefois, bien que le podcast provienne en grande majorité du format radio, il sait également prendre ses distances de celui-ci !
Avec leur format où la parole s’étale, se nourrit du point de vue de l’auteur et invités, le podcast prône un retour à la slow information. Ses sujets sont généralement abordés avec un certain recul qui s’oppose à la culture de l’instantanéité que l’on retrouve sur la toile. Même rupture du côté de la publicité : elle est quasi-absente ! Seule l’auto-promotion – moins intrusive qu’une publicité en tant que telle – est pratiquée, bien souvent en indiquant un programme susceptible d’intéresser l’auditeur.
« Parole, parole, parole » au service du storytelling
À l’heure du règne de l’image que Régis Debray décrit comme étant la période « vidéosphère », le retour de l’audio et rien que l’audio peut surprendre. Pour autant, la parole et plus précisément la conversation s’est amorcée comme une tendance porteuse quand on voit les émissions de télévisions comme, par exemple, « conversations secrètes » de Canal Plus (où Michel Denisot se promène et converse avec son invité). Le format vidéo en moins, reste un réel engouement pour la conversation, cet acte pourtant quotidien. Et cela tombe bien puisque le podcast offre une plus grand liberté de parole : aucun format imposé que ce soit dans le style, le temps, ou encore le contenu.
« The Beautiful thing about podcasting is it’s just talking…it is one of the best ways to explore an idea » @joerogan #quotes #podcasting pic.twitter.com/A3jZMERqoH
— The Gospel Friends (@mygospelfriends) 23 décembre 2016
Face à la méfiance que peuvent avoir les publics quant aux manipulations médiatiques, le podcast plaît pour sa liberté, son authenticité. Il est question d’une polysémie et d’une primauté du podcasteur. Tous uniques, traitant le sujet à leur manière : de façon institutionnelle pour les grands noms de la radio tels que France Inter ou France Culture, ou encore et surtout avec de la subjectivité pour les billets et podcasts d’amateurs.
Ainsi, dans tous les cas, le résultat se veut humain, avec sa part d’imperfections, de spontanéité. La pratique peut aller d’un podcast improvisé (les conversations de Garance Doré dans « Pardon my french » ou celles de « Getting To Know You » de Radio Kawa) à un récit construit autour du storytelling (« Transfert » de Slate.fr, « Arte Radio : flux principal » de Arte).
L’authenticité propre au podcasteur et sa production confère à la relation avec l’auditeur un sentiment plus intime. Les enregistrements amateurs, par exemple, se font souvent dans des lieux privés (lieux domestiques, hôtels entre autres) à destination de publics qui les écoutent dans leur quotidien. C’est une relation plus personnelle qui s’instaure puisque pour un grand nombre de podcasts il n’y pas de public lors de l’enregistrement. Il n’y a pas non plus d’interventions d’auditeurs comme c’est le cas avec la radio. Cela donne l’impression à l’auditeur d’être le seul destinataire.
Enfin, la logique d’abonnement via les flux RSS (« Rich Site Summary ») renforce cette relation quasi fidèle. Étant abonnés, on retrouve une logique de communauté qui suit la conception de Walter Ong, pour qui les nouveaux médias sont censés permettre de reconstituer un lien social.
Finalement le podcast plaît pour son efficacité et sa simplicité : la fluidité de la langue couplée à la créativité d’internet. Plus qu’un simple média d’infotaiment, la liberté de ton qu’il accorde tend à le placer en instrument politique. On assiste d’ailleurs à sa réutilisation par des mouvements féministes comme « Génération XX » racontant le portrait de « wonder woman » « Badass » consacrée aux figures de femmes dans la Pop Culture, ou encore « La poudre » de Nouvelles Écoutes où Lauren Bastide converse avec des figures féminines. Il est certain que le podcast a pris ses marques dans la pop culture.
Ophélie Lepert
LinkedIn
Sources :
• Media meeting « Le podcast ou la délinéarisation réussie de la radio », écrit par Frédéric Courtine, publié le 1er Avril 2014.
• Le blog documentaire « Nouveaux territoires de création documentaire : podcast mon amour ! » Écrit par Fanny Belvisi et publié le 27 septembre 2016.
• Konbini « Le podcast, nouveau terrain de jeu des féministes ». Écrit par Valentine Cinier et publié Février 2017 .
• Wikipédia, RSS
Crédits :
• The average penguin
• Mygospelfriend sur Twitter