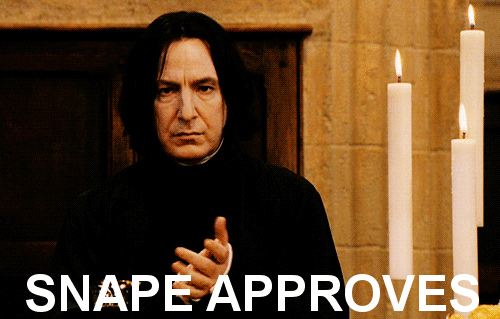Lettre ou (ne) pas lettre : quand la lettre ouverte s'affirme
La lettre ouverte de Zola au président Félix Faure : « J’accuse ! » publiée le 13 janvier 1898, est un texte qui marque un tournant dans l’histoire de la lettre ouverte, car il démontre sa puissance en tant qu’outil communicationnel et argumentatif. C’est aussi grâce à cette lettre ouverte, que l’on peut repérer le premier paradoxe qui la compose.
Certes, cette lettre ouverte est une défense héroïque des principes démocratiques, prônés par Zola. Pourtant, ses motivations ne sont pas purement désintéressées. En effet, même si Zola est à cette période au sommet de sa carrière littéraire, il n’est pas pour autant reconnu par les « siens » du monde des lettres, comme le montrent ses nombreuses tentatives, qui se sont toutes soldées par des échecs, d’intégrer l’Académie Française. De même, ses « amis » politiques ne le prennent pas au sérieux, et lui reprochent de ternir la réalité sociale. A cet égard, la lettre ouverte de Zola est symbolique d’un concept paradoxal. Au-delà d’un coup de gueule politique, cette lettre virtuose traduit une volonté de faire ses preuves et de s’établir en tant qu’intellectuel reconnu.
Par conséquent, la lettre ouverte n’est pas qu’une revendication désintéressée, publiée dans l’intérêt du bien commun. Elle fait preuve d’une motivation plus égoïste, et d’une ribambelle de subterfuges lui permettant de se placer aujourd’hui comme un outil communicationnel efficace, qui a plus d’un tour dans sa manche.
La lettre ouverte, un oxymore
La lettre ouverte est un outil de communication bien plus subtil qu’il n’en a l’air. La première ruse, c’est la double dimension qu’elle recouvre. En effet, tout le paradoxe tient au fait qu’elle s’adresse à une personne en particulier, mais est ouverte à un lectorat bien plus immense. La correspondance dans son sens le plus commun est du domaine privé. Lorsque l’on écrit une lettre à son amant, celle-ci n’est pas normalement destinée à être publiée dans les médias. C’est intime. La lettre ouverte, c’est tout le contraire. Elle défie les règles traditionnelles de la correspondance, et à plusieurs niveaux.
L’élargissement des destinataires peut aussi appeler à une diversion. Prenons l’exemple de la lettre ouverte de Mark Zuckerberg et sa femme à sa fille. Le destinataire premier se veut être le nouveau-né, qui, soit-dit en passant, ne sait pas lire. Il est on ne peut plus clair, par le contenu de la lettre, que cette prise à parti n’est qu’une diversion pour annoncer une nouvelle qui n’a pas grand chose à voir avec une naissance ou l’amour paternel. La lettre ouverte est ici choisie dans le but de faire l’annonce d’une donation de l’auteur à sa propre fondation. Il dévoile donc un manifeste pour sa fondation.
Et puis … :
Tout l’intérêt de la lettre ouverte est dans sa double dimension communicationnelle : un destinataire premier, et un public secondaire.
La forme : l’ingrédient fondamental dans la recette de l’argumentation
La question qui se pose également, c’est pourquoi choisir la forme de la lettre ouverte pour s’exprimer, au lieu d’un article traditionnel mettant en exergue une opinion. Michel Leiris, dans la préface de L’âge de l’homme parle de la nécessité d’une : « forme qui soit fascinante pour autrui ». Au-delà du fond, cette forme est primordiale dans l’efficacité de l’argumentation. La lettre ouverte bénéficie de cette fascination du lecteur. Elle a plus d’impact dans l’imaginaire du public, et est bien plus attirante car elle promet un discours engagé, et parfois même dramatique. Cela fait partie de son contrat de lecture : elle soulève régulièrement une polémique, un point sensible, et s’inscrit donc dans la dimension du spectacle.
Cette lettre ouverte publiée dans Libération par Marwan Muhammad, ancien porte-parole du Collectif Contre l’Islamophobie en France, à l’attention du Premier ministre Manuel Valls, illustre parfaitement cette promesse de divertissement. Ponctuée d’un ton polémique et satirique dès la première phrase : « C’est difficile, pour un Premier ministre, de ne jamais décevoir. Et pourtant, un jour après l’autre, vous réussissez cette prouesse », Marwan Muhammad s’empare de la forme de la lettre ouverte pour faire pression sur le Premier Ministre.
Le but de l’auteur, c’est de convaincre ou de persuader. Dans les deux cas, la lettre ouverte doit faire appel à des procédés stylistiques méticuleusement choisis, afin de faire adhérer le destinataire premier mais aussi les lecteurs, aux positions de l’auteur. Sa double dimension communicationnelle est donc une forme habile, car elle permet une prise à témoin, ce qui engendre une pression sur le destinataire premier. Elle est à elle seule un exercice stylistique qui suscite différents enjeux.
Cette valeur littéraire de la lettre ouverte rejoint le premier point de l’article. Combinée à la promesse de polémique, et à la puissance rhétorique d’une lettre ouverte, cette dernière peut être aussi analysée en tant qu’apologie de l’auteur, par l’auteur lui-même. Il met en avant ses propres talents d’écriture et sa puissance à convaincre les foules. Toutefois, cet intérêt égoïste ne doit pas se faire ressentir à la lecture, d’où l’importance de la forme en tant que style, qui permet de voiler les différentes motivations de l’auteur.
Malheureusement, si une lettre ouverte n’est pas efficace, et ne convainc pas son lectorat, les retombées se font fortement sentir et la critique est directement adressée à l’auteur. Si l’on en revient à la lettre ouverte de Mark Zuckerberg, la stratégie de diversion n’a pas terriblement marché. Que ce soit sur Twitter ou dans les médias d’informations, l’auteur de la lettre a été moqué et critiqué. Les lecteurs ont eu l’impression de se faire berner. A force de vouloir se mettre en avant trop explicitement dans sa lettre, se positionnant comme le sauveur du monde, Mark Zuckerberg a transgressé certains codes de la lettre ouverte qui veulent que les intérêts égoïstes de l’auteur soient plus subtilement déguisés.
Les médias et la lettre ouverte : une belle histoire d’amour, en général
A cet égard, le rôle des médias est primordial dans le processus d’argumentation d’une lettre ouverte. Il n’y a pas de lettre ouverte sans publication médiatique. De plus, relevant de la dimension spectaculaire, c’est un outil de communication intéressant pour eux, car il associe information et fascination. Du côté de l’auteur, il lui est nécessaire de viser des médias de masse, afin d’accroître au maximum sa visibilité, et que sa lettre ouverte atteigne son destinataire premier. En effet, beaucoup de lettres ouvertes sont écrites et publiées chaque jour, sans avoir pourtant un réel impact car écrites par des « anonymes », des personnes inconnues du grand public. Paradoxalement, ce sont des lettres régulièrement adressées à des figures connues, politiques ou non, d’où l’importance d’accroître sa notoriété et par extension, l’écho de la lettre ouverte.
@GuillaumeGrlt témoigne par ce tweet du déséquilibre de la lettre ouverte, qui parfois, n’atteint pas le destinataire escompté, faute d’une couverture médiatique suffisante. Les réseaux sociaux sont l’une des causes mais également l’une des solutions à leur défi. Ils permettent à la fois l’accès à une petite notoriété – par exemple grâce au nombre de retweets ou de partages – qui augmentera la visibilité de la lettre, mais ils sont à la fois un mal. En effet, c’est à cause de cette densité d’informations permise par les réseaux sociaux que la lettre ouverte de @GuillaumeGrlt va peut-être se noyer.
La lettre ouverte : un outil de communication asymétrique
On pourrait comparer l’échange qu’implique la lettre ouverte à la métaphore du catch de Roland Barthes dans les Mythologies : « Sur le Ring et au fond même de leur ignominie volontaire, les catcheurs (…) sont pour quelques instants, la clef qui ouvre la Nature, le geste pur qui sépare le Bien du Mal, dévoile la figure d’une justice enfin intelligible ». De la même manière, les auteurs, durant le temps de la lecture, sont érigés en justiciers, défendant une cause qui leur est signifiante. C’est également un échange qui, s’il répond au code de la lettre ouverte, appartient au domaine du spectacle, comme le catch. Les auteurs seraient donc des catcheurs, qui paradoxalement n’affronteraient pas leur destinataire premier, mais un autre catcheur du public secondaire.
Effectivement, une lettre ouverte n’appelle pratiquement jamais à une réponse du destinataire premier par une autre lettre ouverte. Il peut y avoir un acte de riposte ou d’acceptation de la part du destinataire premier, mais il ne se retranscrira que très rarement par une autre lettre ouverte. Pourtant, si on prend la métaphore du catch, c’est qu’il y a une réponse, une correspondance de lettres ouvertes. La subtilité s’observe dans le glissement du destinataire secondaire qui devient émetteur. Prenons l’exemple de Bruno Lemaire et Germinal Peiro. Bruno Lemaire a écrit une lettre ouverte à l’attention du Président de la République (destinataire premier). En retour, il reçoit une réponse par lettre ouverte de Germinal Peiro (destinataire secondaire).
Premier coup de poing :
Deuxième coup de poing :
La correspondance de lettres ouvertes se manifeste dans un échange asymétrique de l’information mais aussi des émetteurs qui se battent à chaque fois contre des adversaires différents.
Il y a donc une double-asymétrie :
asymétrie de la réponse : forme de la lettre ouverte qui appelle une réponse d’une autre forme par le destinataire premier (actes, discours télévisé, promesse électorale…)
asymétrie des adversaires : un échange de lettres ouvertes est possible, sans qu’il y ait une correspondance entre destinataire premier et deuxième émetteur.
Clémence Midière
@Clemmidw
Sources :
Facebook « a letter to our daughter »
Courrier International : « Humour. Et si la fille de Mark Zuckerberg répondait à la lettre de son père? » -http://www.courrierinternational.com/dessin/humour-et-si-la-fille-de-mark-zuckerberg-repondait-la-lettre-de-son-pere
Libération : « Monsieur le Premier Ministre, vous incarnez la République du mépris » article de Marwan Muhammad – http://www.liberation.fr/debats/2016/01/25/monsieur-le-premier-ministre-vous-incarnez-la-republique-du-mepris_1428858
Twitter : Tweet de @GuillaumeGrlt
Brunolemaire.fr : « L’agriculture se meurt » : ma lettre à F. Hollande co-signée par 106 parlementaires » – https://www.brunolemaire.fr/actualites/577-l-agriculture-se-meurt.html
Parti-socialiste.fr : « Lettre ouverte de Germinal Peiro : réponse à la lettre ouverte de Bruno Lemaire » – http://archives.parti-socialiste.fr/articles/lettre-ouverte-de-germinal-peiro-reponse-la-lettre-ouverte-de-bruno-le-maire
Crédits images :
Facebook
Courrier International
Libération
Twitter
Brunolemaire.fr
parti-socialiste.fr