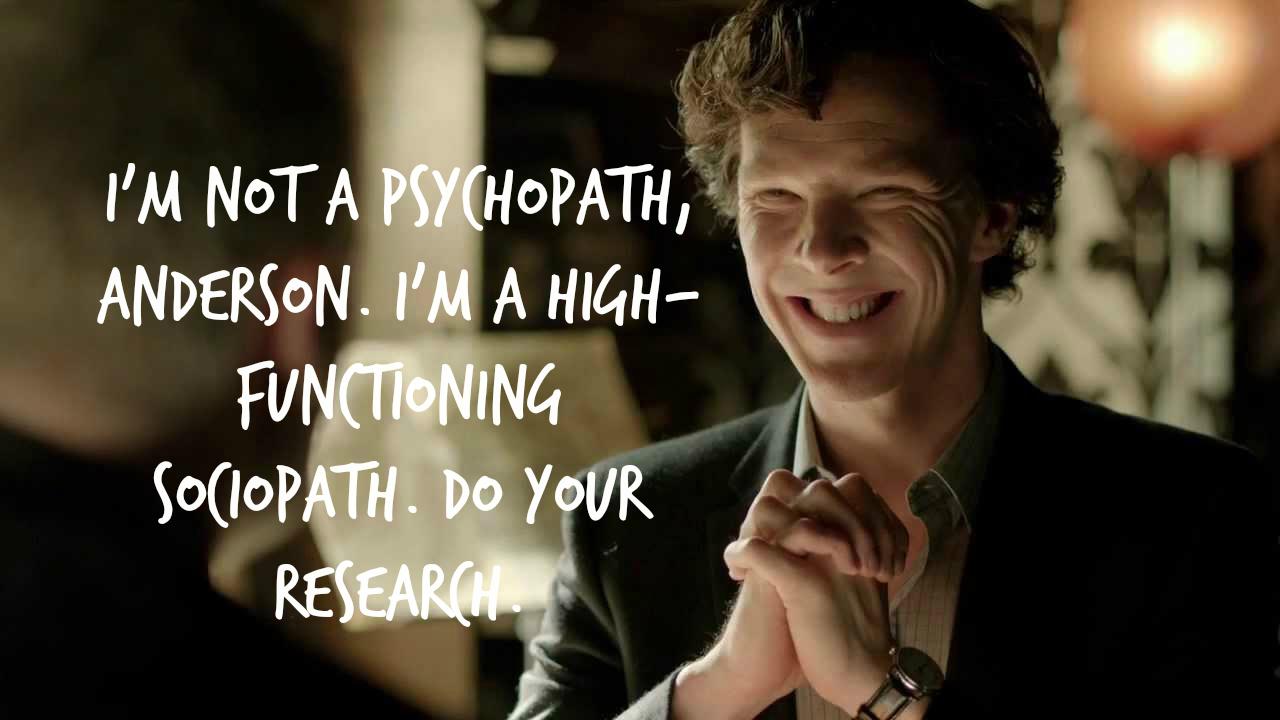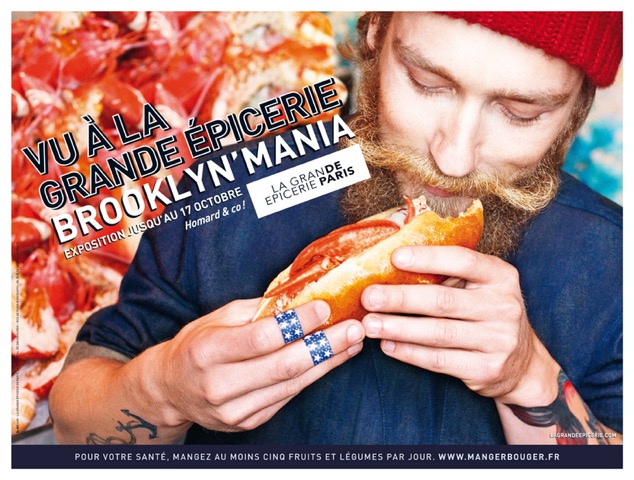« Cette semaine, il y avait le procès de Zyed et Bouna qui est hautement symbolique en ce qu’il est symptomatique de l’impunité policière particulièrement dans les quartiers. Il faut savoir que c’est la mort de ces deux enfants dans un transformateur qui avait embrasé les banlieues en 2005 » affirme le youtubeur Bonjour Tristesse dans sa vidéo du 23 mars 2015. Et en effet, l’accident tragique du 27 octobre 2005 eut à l’époque des répercussions nationales, forçant le Président d’alors, Jacques Chirac, à déclarer l’état d’urgence, une mesure qui n’avait pas été prise depuis l’époque de la guerre d’Algérie.
Les images de ces émeutes violentes restent encore aujourd’hui dans de nombreux esprits : les chaînes internationales comme CNN ou la BBC montraient une France à feu et à sang, dans un déluge de commentaires alarmants qui laissaient présager un futur désastreux pour le pays. Si dix ans plus tard, les émeutes ont bel et bien fini par s’éteindre, l’angoisse née à cette période, celle d’une banlieue dangereuse, mère de tous les crimes et de tous les vices, reste bien ancrée dans l’inconscient collectif.
https://www.youtube.com/watch?v=28cA-L7mB4o
L’accident de trop
Les faits : Clichy-sous-Bois, banlieue de Seine-Saint-Denis, aux alentours de 17 heures. Un employé de funérarium voit deux adolescents, Zyed Benna (17 ans) et Bouna Traoré (15 ans) et leurs amis traîner autour d’un chantier de logements sociaux. Il s’inquiète : ces jeunes pourraient venir voler quelque chose. Suite à son appel, des agents de la brigade anticriminalité (BAC) arrivent dix minutes plus tard. Les deux jeunes garçons, effrayés, s’enfuient aussitôt, poursuivis par les policiers. Leur course les amène devant l’enceinte de la centrale EDF, où ils se réfugient. Les trois garçons : Muhittin, Zyed et Bouna, reçoivent une décharge de 20 000 volts. Si le premier, miraculeusement, survit, ce n’est pas le cas des deux autres. S’ensuivent, dès le 30 octobre, deux semaines d’émeutes dans la banlieue qui rapidement, se propagent à travers toute la France. Le 17 novembre, la France redevient calme.
Les derniers soubresauts de l’opinion sont pour le procès des policiers qui ont poursuivi les deux adolescents, accusés de « non-assistance à personne en danger ». Le 18 mai 2015, ils seront définitivement relaxés.
La France divisée : « Ils en ont parlé ! »
L’affaire Zyed et Bouna a divisé l’opinion publique en deux camps bien distincts. D’un côté, ceux qui affirment que les émeutes sont dues à un dysfonctionnement de la justice et qui croient que les deux adolescents sont les victimes d’une société inégalitaire. De l’autre, ceux qui pensent que cet accident est anodin et ne montre pas de faille policière. Partisans de l’une et de l’autre thèse s’affrontent particulièrement violemment sur les raisons de leur mort : les uns prétendent que les jeunes hommes devaient bien avoir quelque chose à se reprocher pour fuir ainsi devant la police ; les autres affirment que bien qu’innocents, la terreur policière est si forte en banlieue qu’ils voulaient fuir les représentants de l’ordre.
« À la fin tu es las de ce monde ancien »
Le 27 octobre signe les dix ans de la disparition de Zyed et Bouna. Les médias relaient alors de nombreux articles, séries de photos, portraits pour l’occasion, tous marqués par la même interrogation lancinante : « Qu’est-ce qui a changé en 10 ans ? ». Dr Jekyll et Mr Hyde, la banlieue a cette double facette : zone oubliée de la République, coupable de laxisme pour les uns – la popularité de Nicolas Sarkozy s’explique en partie à l’époque par son célèbre : « On va nettoyer au Karcher la cité », de déroger à son principe d’égalité et de fraternité pour les autres. Les médias ont tour à tour relayé ces deux visions antagonistes d’une même affaire, hésitant à décrire un espace qui reste pour beaucoup une terra incognita. Des images-catastrophe de 2005, avec voitures en feu et affrontements multiples aux rétrospectives d’aujourd’hui, comment parler de la banlieue ? Mais a-t-elle vraiment changé, cette banlieue tant fantasmée ? Le constat après tant d’années est largement amer dans la presse aujourd’hui : « Une explosion de colère pour rien ? » titre Libération le 25 octobre.
La nécessité du témoignage : le Bondy Blog
Mardi 27 octobre, je rencontrais Patrick Apel-Müller, directeur de rédaction de L’Humanité, qui au cours de l’interview affirma qu’un projet avait été mis en place avec les étudiants de l’université de Marne-la-Vallée pour qu’ils parlent de leur expérience et de leur vision de la banlieue qu’ils connaissent tant au sein des pages du journal. Le projet n’a pas encore pu aboutir, suite au manque de moyens du journal lui-même, mais cela prouve bien que plus de 10 ans après la mort des deux adolescents, le sujet reste encore présent dans les médias, à travers des initiatives sur le temps long. Le cas le plus célèbre est celui du Bondy Blog, créé par Serge Michel, journaliste au magazine suisse L’Hebdo en 2005 pour couvrir les émeutes. Au fil des années, le blog, véritable pieuvre, s’est diversifié, et aujourd’hui on le retrouve à la fois sur les chaînes de la TNT France Ô et LCP, et sur le site du journal Libération. Le projet est donc au devant de la scène médiatique, et la simple survie du blog semble être déjà un hommage rendu aux victimes du 27 octobre.
« Morts pour rien »
Pourtant, loin de se féliciter de leur rôle de porte-parole essentiels pour la survie d’une véritable démocratie, les contributeurs du Bondy Blog sont moroses. Leur réussite personnelle – bien des anciens blogueurs se retrouvent dans des grands médias- n’éclipse pas la réalité bien plus grise de l’environnement dont ils sont issus. Dans « En 10 ans, qu’est-ce qui a vraiment changé ? » Claire Diao affirme: « Si vous me parlez de ces jeunes qui, en 2005, brûlaient des voitures pour rappeler qu’ils existaient, je vous répondrai sans doute qu’en dix ans, la République, elle leur a bien ri au nez ». De même, le 27 octobre, le Figaro publiait un article dans lequel le rappeur Youssoupha revenait sur les évènements de 2005 et leurs répercussions: « Malheureusement les leçons de ces drames n’ont pas été tirées ». Quant au Huffington Post, il titrait dans un article du 16 mai dernier « Dix ans après les émeutes de 2005, où est passée la colère des banlieues ? » La répétition monotone des médias – qui adoptent tous le même titre au mot près – montre que le changement n’a rien d’évident.
Le constat n’est pas seulement présent dans la presse écrite et web. La télévision partage également ces impressions mitigées. C’est ainsi que France 3 réalise un documentaire intitulé « Sous la capuche » qui évoque différents habitants de Clichy-sous-bois et de Villepinte en 2015. Le documentaire conclut « il est toujours aussi difficile de trouver sa place quand on est jeune, enfant d’immigrés, et que l’on vit dans ces territoires ». Quant à la radio, elle se fait l’écho de ces mêmes préoccupations: Europe 1 publie pour l’occasion un reportage signé Salomé Legrand et Cécile Bouanchaud qui conclut: « Car la seule chose qui n’a pas vraiment changé à Clichy-sous-Bois, c’est le sentiment d’injustice, toujours vivace ».
Des médias sans mémoire
Aussi, pour une fois, les voix qui s’élèvent sont harmonieuses: la banlieue est désespérément identique à elle-même. Mais à quoi cela est-il dû ? Pourquoi les médias qui retournent sur le terrain cinq, dix ans après les faits retrouvent la même situation, la même réalité peu glorieuse et s’en étonnent ? Peut-être que la réponse se trouve dans une déclaration de Renaud Epstein, sociologue. Il explique pourquoi il a lancé sur Twitter un « rétro-live-tweet » (rediffusion des tweets de l’AFP pendant les émeutes): « Publier ces dépêches était une manière de sortir de ce que je voyais se dessiner : un gros moment de mobilisation politique et médiatique … pour mieux oublier ensuite ».
Une explication au phénomène d’immobilisme affirmé jusque-là se dessine alors: peut-être que si la banlieue n’a pas changé, c’est que rapidement elle s’est retrouvée loin des feux des projecteurs. Les médias, et ainsi l’opinion publique, ne sont pas restés dans les banlieues après les évènements de 2005. Une actualité en chasse une autre. Certes, des initiatives comme celles du Bondy Blog et toute une culture de la banlieue s’est développée dans le monde de la musique à travers le rap, mais l’actualité ne s’est faite que sporadiquement, au gré des évènements qui pouvaient interpeller l’opinion. C’est ainsi que la plupart des reportages télévisuels ou écrits ont livré au fil des années une image négative de la banlieue, montrant les habitants sous l’angle de la délinquance et plus récemment de la montée de l’intégrisme religieux.
https://www.youtube.com/watch?v=kPNWLSfTY88
Si bien sûr il s’agit d’une réalité qu’on ne peut négliger, il est à noter que cet angle unique est celui adopté majoritairement par les rédactions, et qui propage donc une vision unilatérale de la banlieue. Certes, la considérer seulement à travers les problèmes sociaux et les violences réelles semble réducteur. Pour autant, l’image de solidarité que veulent défendre les partisans de la banlieue sonne creux. Les journalistes semblent avoir péché en privilégiant toujours plus le temps court, et l’actualité immédiate, à l’analyse qui requiert un temps long. Les émeutes de 2005 appelaient un moment de réflexion, de pause pour pouvoir comprendre toute la complexité de cet espace imaginé. Mais cette réflexion n’a pas eu lieu, les médias étant sans doute emportés par la dictature de la vitesse, emportés à grand galop par le développement foudroyant d’Internet. Surtout, depuis le 7 janvier, l’inquiétude s’est déplacée, car le péril semble s’être émietté: il peut venir de partout, de quelques individus isolés. La banlieue n’intéresse plus puisqu’elle n’a plus le monopole de la peur ; elle n’est plus symptomatique, ou de manière bien plus amoindrie, d’un dysfonctionnement de la République.
Depuis la mort de Zyed et Bouna, deux opinions divergentes dominent sans partage: ceux qui s’offusquent de la délinquance et rejettent la faute sur des populations qu’ils identifient d’abord comme des « non-français » ; ceux qui exaltent la richesse culturelle et fraternelle de cette banlieue dans des discours qui semblent quelque peu idéalistes. Le monde des médias semble quant à lui se contenter au rôle de relai neutre d’une situation désespérée. Aucune position intermédiaire n’est donc possible, tant que qu’un temps de réflexion nécessaire n’aura pas été adopté.
Myriam Mariotte
Sources :
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2005/12/07/le-dernier-jour-de-bouna-traore-et-zyed- benna_718481_3208.html
http://www.liberation.fr/france/2015/10/25/la-revolte-de-2005-une-piece-en-cinq-actes_1408725
http://www.liberation.fr/societe/2010/10/26/zyed-et-bouna-la-poursuite-inavouable_689160
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/18/zyed-et-bouna-dix-ans-apres-enfin-le-verdict_1311506
Crédits photos :
France TV Info
L’Obs plus
Compte twitter du Youtubeur Bonjour Tristesse