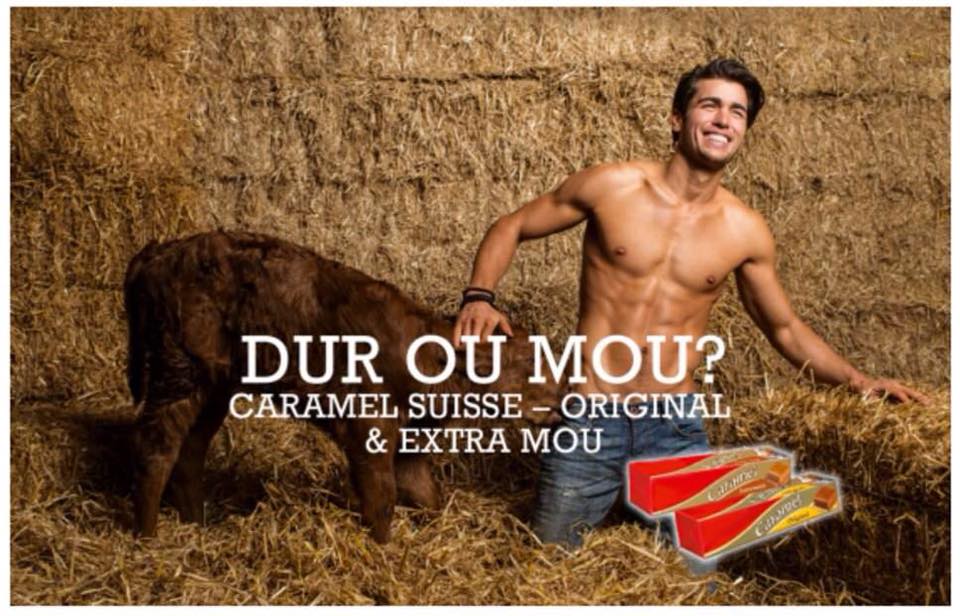Nabilla, we are watching you
Le 7 novembre dernier, à 8h du matin, grand coup de théâtre en France. Nabilla Benattia, star de télé-réalité aurait poignardé son compagnon, Thomas. Une nouvelle tragique et rapidement relayée faisant l’effet d’un raz-de-marée médiatique.
On l’a adorée ou détestée, certains ont été dingues d’elle, d’autres moqueurs. Une chose est sûre, Nabilla a été en l’espace de 3 ans une des personnalités médiatiques les plus marquantes du petit écran. Repérée dans l’Amour est aveugle sur TF1 par La Grosse Equipe, elle connait sa réelle ascension avec sa participation aux Anges de la télé réalité saison 4 et 5. Une émission où elle cumule phrases cultes et histoires d’amour. En 2013 elle défile pour Jean Paul Gautier, obtient son propre show la même année, et rejoint la bande de Cyril Hanouna en 2014. De prétendante à chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, son parcours à la réussite fulgurante l’amène ainsi à être qualifiée de Kim Kardashian française. Cependant, tel Icare s’approchant bien trop près du soleil, Nabilla a brûlé ses ailes, chutant ainsi dans un nouveau bassin médiatique, celui de la prison, là où les retombées ne sont pas aussi avantageuses que celles de la télévision. Malheureusement pour toi Nabilla, tu n’avais pas vraiment prévu ça.
Nabilla, vedette de la médiologie
Lors de ses participations à diverses émissions de télé-réalité, Nabilla est rapidement devenue le centre d’attention, notamment par son corps et des spéculations autour de ce dernier. Une exhibition alors répétée et marquante ayant un impact médiatique de poids, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Une Nabilla épanouie dans la bonne époque, entre vidéosphère et hypersphère.
Dans son cours de Médiologie générale, Régis Debray introduit la notion de médiasphère qui divise en trois périodes l’histoire des systèmes de transmission culturelle. La troisième de ces périodes démarre avec l’invention de la télévision en couleur et se nomme vidéosphère, où le visible fait autorité et où l’immédiateté règne. Un temps propre à Nabilla où ses apparitions télévisées créent le buzz par son parler vrai, agitant ainsi systématiquement la twittosphère, où ses plus grandes et meilleures frasques sont immédiatement reprises et diffusées. Une quatrième période est proposée par Louise Merzeau, enseignante-chercheuse en Sciences de l’Information et de la Communication, l’hypersphère caractérisant une époque plus actuelle, où dominent les réseaux numériques. Un temps lié au développement d’internet, véritable outil pour la starlette connectée et proche de ses followers. Nabilla, bien dans son temps, peut alors jouir d’une forte présence médiatique faisant ainsi son succès.
Une prisonnière de la sphère médiatique
Que ce soit dans l’Amour est aveugle ou dans les Anges de la télé-réalité, Nabilla était une participante de programme répondant d’une logique panoptique. Concept proposé par Michel Foucault dans son ouvrage « Surveiller et punir », le panoptisme décrit les mécanismes de surveillance et discipline circulant dans les institutions de la société. Enfermée dans une villa, entourée de caméra, le regard des téléspectateurs est rivé sur elle, l’observant, la décryptant. Une surveillance pourtant jouée, valorisant le spectacle de l’émission et le corps même de ses participants. Une sphère dans laquelle Nabilla se situe et dont elle n’a pas le contrôle, non sans lui déplaire. Constamment filmée et analysée, Nabilla forge ainsi sa célébrité des retombées médiatiques de cette surveillance. Couverture de magazines people, plateaux tv, l’image Nabilla fait vendre et attire.
Mais suite à son altercation avec son compagnon, cette logique panoptique a pris une nouvelle tournure. L’épée de Damoclès s’abat. Du confessionnal à la garde à vue, de la villa à la prison, Nabilla bascule dans un autre univers qui au final ne sera pas si différent. Enfermée à nouveau, elle continue d’être observée et analysée par les médias. Cependant cette fois-là, ce ne sont plus ses forces comme son corps, qui sont mises en valeur, mais ses faiblesses, ses incapacités. Aucun contrôle, elle ne peut pas compter sur un montage pour la mettre en valeur. Nabilla est encore au centre de l’attention mais qui cette fois la dessert. La nouvelle de son incarcération, dans une période de vidéosphère, est immédiatement relayée, faisant une fois de plus le buzz, surmédiatisant alors à nouveau la starlette. On parle d’elle, mais cela n’est plus à son avantage. Les retombées médiatiques détruisent sa popularité là où auparavant elles la construisaient. Nabilla est alors une prisonnière, de la prison féminine de Versailles certes, mais également d’une sphère médiatique de laquelle elle ne peut s’échapper. Une sphère où elle est entrée avec la télé-réalité quatre ans auparavant et dont elle ne sortira qu’une fois que son actualité people cessera.
Vers une peopolisation à l’anglaise ?
Ce fait divers amène ainsi à une réflexion sur le futur de l’actualité, de l’information française. Arrivons-nous culturellement vers un modèle davantage anglo-saxon ? L’exemple de l’Angleterre est signifiant, où le yellow journalism* détient une part considérable du marché de la presse, avec une peopolisation de l’actualité qu’on retrouve notamment avec le journal The Sun, tiré à plus de 2 millions d’exemplaires chaque jour. Des faits divers, des informations offrant des records aux sites et journaux français. Comme le montre le Tube dans une émission dédiée à ce fait divers, l’affaire Nabilla, en quelques chiffres pour le mois de novembre, c’est plus de 6000 articles et 715 000 tweets. Le star system s’infiltre dans les médias supplantant ainsi des sujets davantage sérieux aux dimensions moins attrayantes, moins spectaculaires.
Si en ce mois de février, Nabilla est bien sortie de prison, elle demeure toujours enfermée dans cette sphère médiatique, avec une actualité – certes plus faible – portant toujours sur sa vie privée, avec un manager la poursuivant en justice, ou encore des rumeurs de mariage.
*presse à scandale
Félix Régnier
@filgato
Sources :
Régis Debray – Les cahiers de médiologie
Olivier Aim – Une télévision sous surveillance
Louise Merzeau
Le plus
Le plus – NouvelObs
Le Tube
ledauphine.com