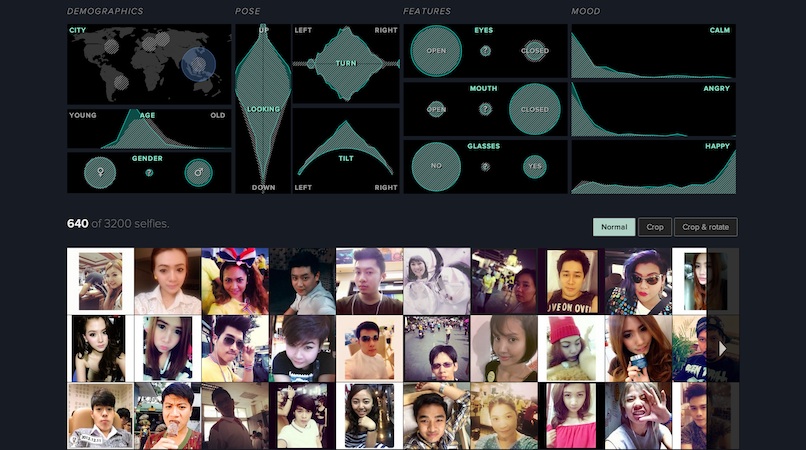Gogglebox : Ces britanniques qui regardent leurs compatriotes regarder la télévision.
A l’heure des superproductions aux budgets faramineux, la recette du succès pourrait tenir à bien peu de choses… Prenez un échantillon représentatif du peuple britannique, ajoutez-y un canapé plus ou moins miteux et une série de programmes triés sur le volet. Agrémentez selon votre convenance le décor de junkfood et de quelques boissons. Placez-le tout devant un écran de télévision.
Vous obtenez la nouvelle émission phare de la chaine Channel 4.
L’idée de Gogglebox (littéralement, « la boîte à yeux » soit le « petit écran »), est si simple qu’elle en est presque impertinente. Il s’agit pour le spectateur de regarder d’autres spectateurs regarder la télévision en se délectant de leurs réactions. Rien n’est écrit, tout est spontané, seul le choix des programmes est réalisé en amont par la production. Divers et variés, ces derniers, qui peuvent traiter de cuisine comme de politique, ont en commun leur cible grand public. De X Factor aux pubs John Lewis en passant par le dernier discours de David Cameron, chaque épisode de Gogglebox compile les évènements marquants du paysage audiovisuel des sept derniers jours.
Sans scénario, sans action et sans équipe de tournage, le programme n’a pas à rougir face à la concurrence. Non seulement son concept incongru rassemble plus de deux millions de spectateurs chaque mercredi, mais il est aussi le nouveau chouchou des réseaux sociaux. Une vague de réactions succède immanquablement à chaque diffusion et le buzz fonctionne tant et si bien que l’émission devrait désormais être suivie en prime time le vendredi soir.
Si l’on sait la téléréalité capable de battre des records d’audience, l’engouement que suscite Gogglebox peut néanmoins surprendre. Comment une mise en abyme aussi banale peut-elle captiver un public si étendu ?
La réponse est peut-être à chercher du côté de ses créateurs… Stephen Lambert (directeur du studio éponyme), a pensé l’émission comme un laboratoire social, un documentaire sur la « réalité observable ». A la fois miroir de l’actualité du pays et immersion dans l’intimité de ses citoyens, Gogglebox bénéficie d’un double ancrage propice à l’identification. D’autant que si les moyens dédiés au tournage sont dérisoires, le soin accordé au choix du casting est au centre de toutes les attentions. Quatorze ménages ont été retenus selon des critères bien spécifiques. D’âge, de sexe et de groupes socioprofessionnels différents, les familles et groupes d’amis ayant accepté de se prêter au jeu incarnent une Angleterre aux multiples facettes.
Quinquagénaires huppés propriétaires d’une maison d’hôtes dans le Kent, coiffeurs homosexuels installés à Brighton, immigrés habitants de Derby, couple de retraités vivant à Liverpool, copines chômeuses du quartier londonien de Brixton, la distribution est volontairement hétéroclite. Débordants de spontanéité, les protagonistes sont des plus attachants. Nul besoin d’artifices pour que le charme opère. Tour à tour engagées, émouvantes, excessives ou franchement hilarantes, les interactions ont de quoi séduire le spectateur avide de parlers francs et de discours sans langue de bois.
Si le programme est évidemment novateur en matière de feedback – faire de la réaction des spectateurs face aux programmes un programme à part entière, il fallait y penser-, il entraîne aussi son lot de polémiques. Certains jugent le concept malsain et crient au voyeurisme, d’autres sont simplement atterrés par l’intérêt motivé par un programme… qui n’en a pas. Or, les critiques à l’égard de Gogglebox tendent à être tempérées par la mouvance actuelle. L’émission n’est en effet pas la seule à donner à voir ce qui, de prime abord, parait trop commun pour être médiatisé. En Corée du Sud, il est possible de payer pour regarder des filles manger sur Internet. En Norvège, la chaine NRK, spécialiste de la slow TV, diffuse des feux de cheminée et des paysages apaisants sur les écrans. Sans scénarisation ni montage, cette nouvelle forme de télévision vise moins à distraire le spectateur qu’à le relaxer.
Au-delà des jugements de valeur, ces programmes sont aujourd’hui les principaux témoins de l’évolution des usages de la télévision.
Marine Bryszkowski
Sources
TheGuardian
Radiotimes
Libération
STYLIST, numéro 42, 27 mars 2014