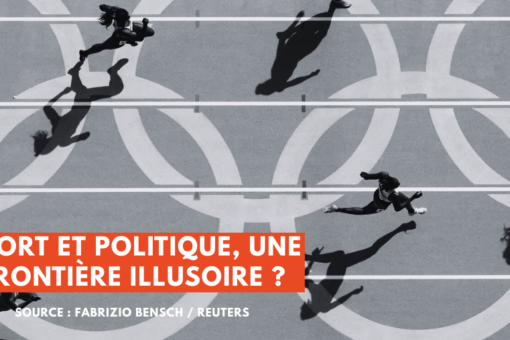Le 7 novembre dernier, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a condamné le déploiement d’une banderole en soutien à la Palestine par les supporters parisiens lors du match de ligue des champions face à l’Atletico Madrid. Le ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur X, en affirmant « Je demande au PSG de s’expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d’unité. (…) ».
Séparation entre sport et politique : un lieu commun ?
Cette déclaration de Bruno Retailleau s’inscrit dans un discours assez répandu soutenant que sport et politique doivent être strictement séparés, car l’ingérence politique nuirait à l’esprit du sport. Comme en témoigne, le mécontentement de certains supporters parisiens outrés par ce tifo, promettant de ne plus remettre les pieds au stade dans ces conditions. L’un d’entre eux, interrogé par le journal l’Équipe, soupçonne le Qatar d’être à l’origine de ce message politique.
Le sport discipline noble ?
On présente le sport comme une discipline noble, chargée de valeurs positives comme le mérite, le respect, l’humilité, la santé, le dépassement de soi… Toutes ces valeurs créent les conditions pour une compétitivité saine. Le sport est donc vecteur de partage, d’universalisme, d’inclusion…; et constitue une pratique bénéfique pour le corps et l’esprit. Tous ces éléments confèrent une connotation extrêmement positive au sport.
La politique néfaste par nature ?
En revanche, la politique porte avec elles une série d’images négatives. Étant relative à l’exercice du pouvoir, il est commun d’entendre que la politique divise, crée des tensions, renforce les conflits. Il est vrai que la politique demande de l’engagement et des prises de position. Le fait de prendre parti, implique nécessairement des désaccords, exacerbés par la volonté de faire triompher son modèle de pensée. Ceux qui défendent une totale séparation du sport et de la politique, basent leur raisonnement sur une soi-disant volonté de préserver la discipline sportive des effets jugés négatifs de la politique. Autrement dit la politique apparaît comme un nuisible qui entache la pureté du sport.
Focus historique
Ce discours qui prône une séparation nette entre sport et politique, se nourrit d’un historique profond et peut ainsi être appréhendé grâce à l’Histoire. Alors, à travers trois exemples, faisons un petit retour historique pour savoir s’il est pertinent de dissocier ces deux arènes de pouvoir.
Tommie Smith et John Carlos, figures de la lutte raciale par le sport
Le 16 octobre 1968, lors de la finale du 200 mètres aux Jeux olympiques de Mexico, les sprinteurs américains Tommie Smith et John Carlos, obtiennent respectivement la médaille d’or et de bronze.Ils montent sur le podium en chaussettes noires, symbole de la pauvreté des Afro-américain, vêtu d’un foulard symbole de l’oppression. Les deux athlètes américains baissent la tête et lèvent le poing ganté de noir, couleur des Black Panthers. Les différents signes réunis sur la photographie symbolisent un ensemble de revendications que prônent les afro américains.
Ce geste de contestation apparaît dans des États-Unis marquées par les tensions raciales, et l’assassinat de Martin Luther-King Jr quelques mois plus tôt. Smith et Carlos, en profitant de la visibilité des Jeux, brisent le mythe d’un sport dépolitisé, et inscrivent leur combat dans l’histoire. Le Comité international olympique radie les deux sprinteurs des JO à vie. Preuve que l’institution tente d’imposer l’illusion d’une neutralité sportive. Aujourd’hui, cet acte est reconnu comme un moment clé du combat pour l’égalité raciale.
Le sport outil de coercition pour les nations dissidentes
Pendant des décennies, l’Afrique du Sud a instauré l’apartheid, un système de ségrégation raciale profondément ancré dans toutes les sphères de la société, y compris dans le sport. Les athlètes noirs sud-africains étaient systématiquement écartés des compétitions officielles, le pays envoyait uniquement des délégations blanches aux Jeux olympiques. Face aux pressions internationales et aux appels au boycott de plusieurs nations africaines, le CIO a fini par exclure l’Afrique du Sud des Jeux de Tokyo en 1964, suivie d’une interdiction permanente de participation aux JO à partir de 1970. Cet isolement sportif a constitué un levier symbolique contre le régime sud-africain, contribuant à son affaiblissement sur la scène internationale. Ce n’est qu’à partir de la fin officielle de l’apartheid en 1991, que l’Afrique du Sud réintègre les JO. Lors des Jeux de Barcelone en 1992, Nelson Mandela assiste en personne au retour de la nation arc-en-ciel dans la compétition, incarnant l’idée que le sport peut aussi être un moteur de réconciliation. La présence de Nelson Mandela, victime de l’apartheid et incarnation de la lutte contre le racisme, renforce le poids de la réhabilitation de l’Afrique du Sud au sein du Comité olympique. Cette sanction historique prouve bien que le sport peut être utilisé comme un outil diplomatique, capable de sanctionner un régime politique et d’engendrer une dynamique de changement. Contredisant ainsi frontalement, l’idée que le sport devrait rester à l’écart des conflits politiques.
Kathrine Switzer la première marathonienne de l’histoire
Le sport a également joué un rôle dans l’émancipation des femmes. Pourtant, le père des JO modernes, Pierre de Coubertin, s’opposait à leur participation aux compétitions sportives. Aux débuts du sport moderne, une multitude de préjugés entourait la pratique féminine, allant de la perte de féminité à une silhouette jugée trop masculine, en passant même par une supposée menace pour la fertilité. Ainsi, lors des premières compétitions, les femmes étaient systématiquement exclues.La lutte pour l’intégration des femmes dans le sport a été longue, mais elle a accompagné certaines évolutions sociales . En 1967, passionnée de course à pied, Kathrine Switzer décide de participer au marathon de Boston. Avec le soutien de son entraîneur, elle réussit à s’inscrire en ne renseignant que son nom de famille. Munie du dossard 261, elle prend le départ, mais après quelques kilomètres, un organisateur tente de l’arrêter en pleine course, donnant naissance à une photo devenue historique. Malgré cette tentative d’exclusion, elle devient la première femme à boucler les 42 kilomètres du marathon. En représailles, la fédération américaine d’athlétisme la radie, mais son geste marque les esprits. Propulsée en une des journaux du monde entier, elle devient une figure de l’émancipation féminine. Son acte de résistance contribue à changer la perception des femmes dans le sport et à ouvrir la voie à leur participation aux courses de fond, et plus largement, à leur reconnaissance dans le monde sportif.
Séparation du sport et de la politique, un raisonnement absurde ?
Ces exemples illustrent l’incohérence de l’idée selon laquelle, une séparation stricte entre le sport et la politique serait nécessaire. La politique englobe tous les enjeux, environnementaux, sociaux, économiques…; qui façonnent notre monde, et le sport n’y fait pas exception. Il ne se déroule pas dans une bulle hors du temps, exempte de toute influence politique. Dès lors, comment pourrait-on affirmer, comme l’a fait le communicant Franck Tapiro sur CNews en décembre dernier, que la politique « tue le sport » ?
Ou un simple contre-sens ?
Les personnalités politiques adoptant cette position tendent parfois à confondre un message de soutien contre une injustice ou une prise de position en accord avec les valeurs du sport, avec une instrumentalisation du sport à des fins politiques. Ou bien perçoivent très bien la nuance mais tentent seulement de satisfaire le plus large éventail de personnes, en reprenant les idées les plus répandues. Si le sport est utilisé comme un outil de propagande par des régimes fascistes, comme ce fut le cas lors des JO de Berlin en 1936, alors évidemment que la politique pervertit le sport. En revanche, lorsqu’il sert à combattre les inégalités et à promouvoir la paix, à l’image de la vision de Nelson Mandela, illustrée par sa présence aux JO de Barcelone en 1992, ce n’est plus la politique qui dénature le sport, mais bien le sport qui contribue à améliorer la politique.
Aliénation par le sport ?
Comme le soutient John Hargreaves dans Sport, Power and Culture, le sport présente cet avantage de divertir, de détourner le temps des matchs et des compétitions, la population de sujets plus graves qui polarisent la société. Le sport participe donc à détourner les individus des sujets politiques qui se répercutent nécessairement sur leur quotidien. Mais les grands événements sportifs peuvent également, être perçus non pas comme des facteurs d’aliénation, mais comme des moyens d’atténuer les tensions sociales et politiques, à l’exemple des JO de Paris 2024. L’effervescence de ces Jeux a quasiment fait oublier aux français la large victoire de l’extrême droite aux élections européennes du 9 juin dernier, ou l’absence prolongée de gouvernement durant cette période. C’est peut-être ici que se trouve le véritable enjeu qui nourrit les polémiques entre sport et politique.
Sources :
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Le-tifo-free-palestine-a-fait-fuir-du-parc-des-princes-certains-supporters-du-psg/1523685
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Nathan-supporter-du-psg-s-est-desabonne-apres-le-tifo-free-palestine-on-ne-remettra-plus-les-pieds-au-parc/1523669
Compte Twitter (X) de Bruno Retailleau
Tommie Smith et John Carlos (Wikipédia, Brut, France TV)
https://www.lefigaro.fr/sports/scan-sport/actualites/exclu-des-jo-pour-avoir-leve-le-poing-john-carlos-reclame-plus-de-liberte-d-expression-au-cio-1005926
Nelson Mandela (Site du CIO, Wikipédia)
https://www.olympics.com/cio/news/nelson-mandela-une-voix-au-service-du-sport
Kathrine Switzer (INA, France Info)
Histoire de la femme et du mouvement olympique
https://www.olympics.com/cio/pierre-de-coubertin/pourquoi-pierre-de-coubertin-etait-il-oppose-a-la-participation-des-femmes-aux-jeux-olympiques
Nelson Mandela (Site du CIO, Wikipédia)
https://www.olympics.com/cio/news/nelson-mandela-une-voix-au-service-du-sport
Marcus Alexandre