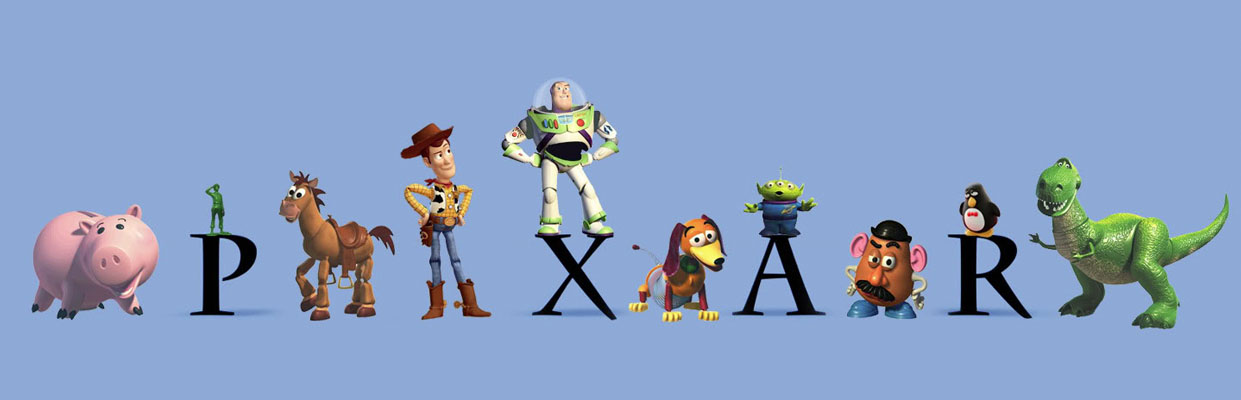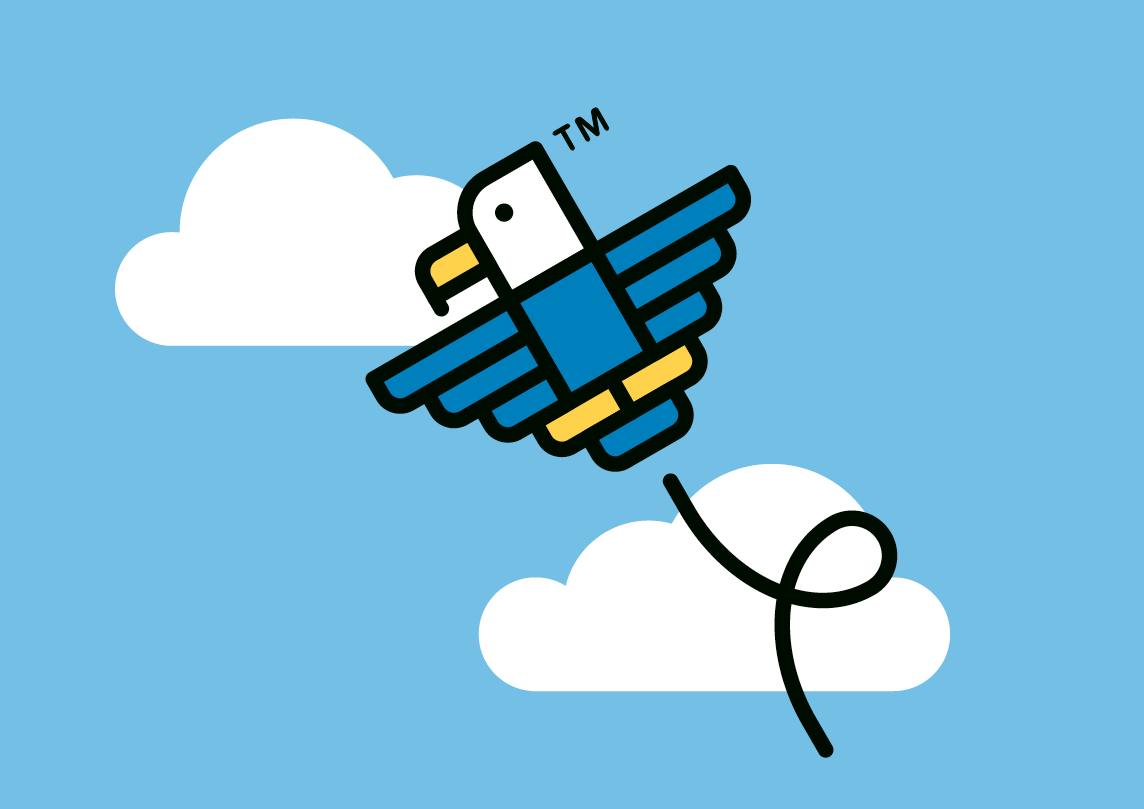Je suis un vrai, un dur, un tatoué
A l’occasion de la sortie de son livre « Why does Mommy have tattoos » en avril 2016, l’artiste Marilyn Rondón revient sur les motivations qui l’ont poussée à publier un ouvrage pour enfants destiné à briser les préjugés liés aux tatouages. L’occasion de se pencher sur une pratique ancestrale encore mal aimée par beaucoup.
Le tatouage, des préjugés qui lui collent à la peau
Si le tatouage est aujourd’hui particulièrement mis en lumière par les médias, il existe une diversité des savoir-faire et des perceptions qui est souvent occultée. En Polynésie Française comme dans les Îles Marquises – très belle exposition à ce sujet au musée du Quai Branly actuellement !-, le tatouage est un véritable rituel qui permet de distinguer les classes sociales et l’âge de chacun de ses membres : plus on est tatoué, plus on accède aux privilèges de la société et plus on est respecté. En ce sens, le tatouage est un acte sacré qui s’incarne dans des motifs comme le Tiki, le dieu créateur qui veille sur ses peuples.
Mais le tatouage prend une toute autre dimension dans certaines sociétés où il est synonyme de honte et de stigmatisation. Dans le Japon du VIème siècle, il servait à marquer les criminels qui conservaient la trace de leur forfait à vie, sans oublier l’Allemagne nazie, qui marquait les déportés d’un numéro indélébile qui les réduisait à un code, à un produit.
Laissez vos tatouages au vestiaire je vous prie
Cependant, depuis la fin du XXème et le début du XXIème siècle et devant l’afflux massif de personnes se faisant tatouer (une partie ou le corps entier), la question du tatouage s’est reposée différemment : permet-il d’appartenir à un groupe particulier ? Est-il seulement à visée esthétique de sorte que le tatoué le réalise tout d’abord pour soi et non pour l’opinion publique ? Si le tatouage, dépourvu de toute dimension sacrée comme nous l’avons énoncé plus haut, est pour beaucoup le moyen de conserver à vie un motif qui lui est cher, il reste toutefois assez mal vu dans le monde du travail et en particulier par les recruteurs qui l’associent à un « mauvais genre », qui renvoie une image de fantaisie et même de subversion qui n’a pas lieu d’être dans le milieu professionnel. Lors d’une interview pour Konbini, Marilyn Rondón raconte comment le fait d’être une femme tatouée influence l’opinion : une femme doit incarner la beauté, la finesse, là où le tatouage serait une vulgaire tache sur une pureté supposée. Elle revient sur l’esclandre provoquée par sa patronne le jour où elle se tatoua le visage alors qu’elle-même était tatouée. A ce titre, Grazia s’était amusé à publier une série de photographies retouchées par Cheyenne Randall reprenant des personnalités telles que Jackie et John Fitzgerald Kennedy ou encore Kate Middleton et le Prince William, en leur imaginant de nombreux tatouages : en touchant à de telles icônes, il s’agit de questionner nos a priori et nos convictions : Jackie aurait-elle été si respectée si elle avait été tatouée ?
L’art du tattoo
Mais si le monde du travail préfère laisser de côté la fantaisie, la publicité quant à elle la reprend à son compte : le tatouage n’est alors plus vu comme vulgaire ou sale mais comme un atout de charme et de séduction. Prenons l’exemple des parfumeurs : un homme tatoué incarne la force voire la domination, tandis qu’une femme tatouée se voudra sexy, mystérieuse, inaccessible et surtout inoubliable : le tatouage est un moyen d’ « encrer » sa différence, mais avec style.
Ces mises en scène des tatouages tentent elles aussi de surmonter les idées préconçues qui corsètent encore ces derniers dans une image de gribouillis qui ne ressemblera plus à rien des décennies plus tard. Elles ont aussi pour vocation de leur rendre leurs lettres de noblesse et de les montrer tels qu’ils sont : des œuvres d’art.
C’est d’ailleurs ce que les tatoueurs défendent ardemment à travers de nombreux salons et en opposition aux détracteurs, à l’image de l’émission « Tattoos fixers » diffusée sur Channel 4. Il s’agit de filmer des personnes regrettant leur tatouage ou s’étant fait tatouer à leur insu, et de le « rattraper » en tatouant un autre motif par-dessus. Les tatoueurs britanniques se sont insurgés car selon eux cela retire toute la dimension artistique du tatouage en le présentant comme un vulgaire collage, dénué d’inspiration et de création. Les tatoueurs de l’émission, également accusés de plagiat, bafouent l’éthique des tatoueurs et la marque de chacun. Le tatoueur Paul Taylor a alors lancé une pétition contre l’émission et qui fut massivement soutenue par les amoureux du tattoo.
Si le tatouage peine encore à se faire accepter comme art et surtout comme un choix individuel qui n’entache en rien ni la personnalité ni la profession des adeptes, le travail et la finesse d’un bon nombre d’artistes tatoueurs tend à redorer son blason. Et puis, Angélina Jolie reste la preuve vivante que l’on peut être belle, élégante, et tatouée.
Ludivine Xatart
Sources
-Konbini, « Pourquoi Maman a des tatouages ? », Olivia Cassano, Mai 2016
-Konbini, « Une émission de téléréalité agace l’industrie du tatouage britannique », Kate Lismore, Avril 2016
-Kustom Tattoo : L’histoire du tatouage
-Grazia, « Pourquoi maman a des tatouages? » : un livre à l’assaut des préjugés, Chloé Friedmann, 22 Avril 2016
-www.mondialdutatouage.com
Crédits photos
-Konbini, « Why does Mommy have tattoos ? »: © Marilyn Rondón
-Marie Claire, “Les plus beaux tatouages repérés sur Pinterest”: © Pinterest/DR
-corion.over-blog.com
-Grazia : photos tatouages numériques par Cheyenne Randall
-deleardebeauté.wordpress.com
-bloodisthenewblack.com
-vice.com