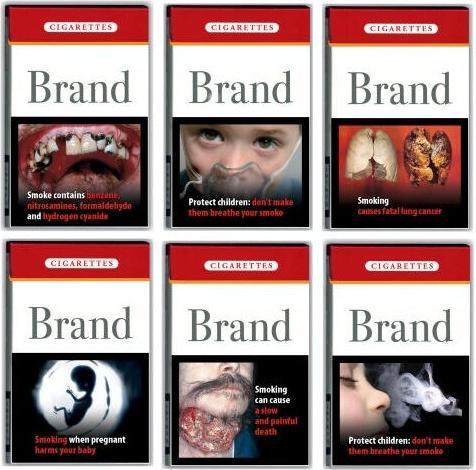La French Touch est-elle Made in France ?
Continuons notre dossier spécial made in France avec Le Gorille – le webzine musical du CELSA – qui nous parle de la French Touch. Cette dernière montre à quel point la construction d’un imaginaire est décisive, et que les Français eux-mêmes sont souvent les premiers à convaincre.
Produite en France, par des DJs et des graphistes français, il aura fallu la reconnaissance internationale pour que ce phénomène musical qu’est la French Touch soit pris en considération comme une production culturelle française à part entière.
Longtemps absente de la scène électronique, de son histoire et de son imaginaire, la France a finalement trouvé une place de choix, à partir des années 1990, à travers le mouvement French Touch.
Éloigné des codes de la musique française, la French Touch est un mouvement polymorphe qui naît au début des années 1990 et s’illustre par une facilité à s’exporter au-delà des frontières hexagonales. Elle est le fruit d’un ensemble d’artistes, issus de la même génération, qui investissent le champ de la musique électronique en renouvelant et en enrichissant son approche. De fait, outre la production musicale, le phénomène utilise avec habileté le domaine de l’image. Martin James, journaliste anglais considéré comme le premier à avoir utilisé l’expression « French Touch », précise :
« Pour beaucoup, il n’existait aucune règle précise quant à ce genre musical qui, selon moi, n’en était d’ailleurs pas un. Je définirais plutôt la French Touch comme un phénomène post-genre, caractérisé par ses références culturelles et son origine urbaine ou nationale, plutôt que par une forme musicale, une imagerie ou un comportement de type tribal comme en retrouve sur d’autres scènes musicales plus spécifiques. »
Une même génération d’artistes, celle des digital natives, se rencontre ainsi sous le chapiteau de la musique électronique. Les années 1990 sont celles de la culture du mix, du copié-collé, du détournement et sont marquées par l’utilisation d’un outil omniprésent : l’ordinateur. Ainsi, musiciens, labels, graphistes participent ensemble à la création de nouvelles écritures nourries par l’univers culturel anglo-saxon
La synergie entre musique et graphisme s’explique alors par la nature même de la musique électronique et par une philosophie commune qui s’incarne dans le rejet du star-system et de ses codes marketing. Ainsi l’esthétique de la French Touch a pour principe l’absence de représentation des artistes afin de donner une identité visuelle à une musique abstraite. En un mot, les protagonistes ont voulu mettre en avant la musique plutôt que la personnalité des artistes. Musicalement, la French Touch, c’est également une certaine chaleur donnée à la House à travers la prééminence de samples disco et funk, entre autres. Nick Clift, Directeur Marketing chez Astralerks Records, explique :
« Les Français savent donner du style, de la fraicheur, de l’énergie à la musique qu’ils produisent ! »
(Hold Up – Super Funk 1997)
Parallèlement, l’émergence du home studio participe pleinement de cette effervescence dans une atmosphère originelle déjantée, clandestine, droguée aussi. Cet esprit indépendant et l’affranchissement vis-à-vis des majors que permettent les nouvelles structures – le home studio en tête – donnent ainsi naissance à une liberté créative qui représente une part constitutive dans la mise en place d’une nouvelle esthétique, musicale et graphique. Entre 1993 et 2001, sous l’impulsion de la French Touch, les ventes du Bureau export de la musique française sont multipliées par 26, passant de 1,5 million à 39,3 millions de disques.
Si la chaleur apportée à la musique électronique par nos compatriotes DJ constitue l’élément caractéristique de la French Touch, le mouvement se caractérise également par un élan d’innovation en termes de communication artistique. En effet, la synergie entre graphisme et musique fut à l’origine d’une nouvelle manière de communiquer la musique.
Le savoir-faire French Touch : la communication 360˚ avant l’heure
Avant les années 1990, la production d’un projet autour d’un artiste était éclatée entre une multitude d’acteurs, chacun apportant sa patte à l’objet final. L’artiste écrivait ses titres et l’album était produit sous la contrainte financière imposée par le label. A la sortie de l’album, la production de clips et de visuels était l’apanage des services artistiques internes aux maisons de disque. La mise en scène des spectacles restait quant à elle secondaire, seules la musique et la personnalité de l’artiste ayant une réelle importance.
Si les graphistes américains et anglais investissent le support « pochette » dès le début des années 1970, il faut attendre en France les années 1990 et les débuts de la musique électronique pour que les hommes d’images commencent à quitter leur support privilégié, à savoir l’affiche.
C’est alors que se met en place une collaboration étroite entre les musiciens et les graphistes de la French Touch, pour accompagner chaque sortie musicale d’un univers pictural et scénique unique. L’identité visuelle, créée à partir des codes de la culture pop, est désormais déclinée sur tous les supports de communication permettant ainsi d’entourer l’artiste d’une image de marque cohérente et immédiatement identifiable.
En 1999, Antoine Bardou-Jacquet, l’un des deux fondateurs de l’atelier de graphisme indépendant H5, expliquait :
« Alors que dans une agence de pub ou une major tu ne rencontres pas l’artiste mais plein d’intermédiaires, des chefs de projet, de marketing, nous on travaille avec les labels dans la proximité, la confiance, la spontanéité. »
Et les ventes s’en suivent ! Adam Scott, disquaire indépendant à New York :
« Les Français font de très belles pochettes, c’est pour ça qu’ils vendent beaucoup d’albums »
L’album Super Discount d’Etienne de Crecy reste à ce titre l’un des exemples les plus marquants de la décennie 1990 et du savoir faire français en termes de communication par l’image. L’agence de graphisme H5, en collaboration avec le label indépendant Disques Solid, habille l’album d’une pochette forte en couleur qui détourne les codes de la société de consommation pour un impact visuel maximum – pochette qui servira plus tard de tatami à deux judokas un peu allumés sur le clip « Prix Choc » et qui sera revisitée en rose pour le second volume Super Discount 2.
Et à ceux qui douteraient de l’existence d’une véritable intention stratégique, les petits génies du marketing qui composent le duo Daft Punk répondent lors d’une interview donnée au magazine Coda en Juillet 1998 :
« On a travaillé de très près sur les pochettes, les vidéos. Ca a été notre plus gros boulot de l’année 97. Finalement, les moments de création qu’on a eus en 97, c’était par rapport à toute la production audiovisuelle. »
Et c’est ainsi qu’on retrouvera sur les trois premiers albums studio du groupe un seul et même logo, abrasif à souhait et décliné en couleurs et en matière pour une image de marque toujours intacte aujourd’hui !
Nul n’est prophète en son pays : la French Touch et le jeu de miroir du Made in France
Inspirés des productions House de Chicago et Detroit, les DJ français s’approprient donc la frénésie mécanique propre à cette musique. Ainsi, la French Touch est fondée sur un paradoxe : voilà une production perçue comme française, dont les DJ sont Français, dont les graphistes sont formés dans des écoles françaises mais dont les racines se trouvent principalement outre-Atlantique et outre-manche. De plus, même les influences plus larges dépassent le cadre hexagonal. Eric Morand, co-fondateur du label F Communications (dont le logo détourne le macaron France destiné aux voitures) raconte :
« Mes parents écoutaient Brel et Brassens. Moi, je n’écoutais que de la disco américaine, plutôt soul… »
Toutefois, cela n’empêche pas les journalistes les plus cocardiers d’y trouver quelque fierté mais aussi une certaine confusion :
« On a affaire à une musique dont les bases sont essentiellement françaises : la disco (sic), le trip-hop… La musique électronique française s’exporte précisément parce que ses bases sont aussi bien en France qu’aux Etats-Unis ou en Angleterre. C’est la première fois qu’on assiste à ce phénomène » comme le souligne le journaliste musical Christophe Basterra.
Au-delà même de la question des influences, les caractéristiques propres à la musique électronique interpellent. Si les canons de la musique française sont ceux admirablement tenus par Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Alain Bashung, Claude Nougaro et autres tauliers, alors Laurent Garnier, Quentin Dupieux*, Étienne de Crécy ou Thomas Bangalter sont loin de correspondre aux standards hexagonaux. D’un point de vue linguistique, voilà une musique sans parole à proprement parler, et quand parole il y a, elles sont le plus souvent chantées en Anglais. Profitant d’une musique où le texte tient un rôle mineur, la French Touch ne rencontre donc pas la barrière de la langue. La barrière linguistique, la French Touch la rencontre paradoxalement en France où on ne peut proposer une musique « made in France » sans respecter un cahier de charges et la question des quotas à une époque où les clips étaient davantage diffusés à la télévision que sur internet :
« Quand on faisait une vidéo et qu’il fallait qu’elle passe sur M6 ou sur MCM, il y avait les histoire de quotas de chansons françaises. Or, pour nous qui faisions des chansons destinées à un public international, il fallait qu’il y ait un petit peu de Français. Sinon, on était classés, nous artistes français, dans la même catégorie que les artistes américains. Pour Flashback, on a fait un clip qui est entre le clip et le court-métrage avec des dialogues en français pour entrer dans les quotas français ; ce qui a permis à la vidéo d’être diffusée efficacement » détaille Eric Morand du label F Communication.
Cette barrière de la langue fut justement l’un des obstacles du rock français dont l’export (cf vidéo) pâtit de textes uniquement destinés au public francophone. La patte française de la French Touch aura donc été cette capacité à s’affranchir des contraintes françaises pour mieux les affirmer à l’étranger. Alors que le Made in France cible un marché essentiellement national et trouve d’autant plus d’échos que résonnent les clairons patriotiques en ces temps de troubles, le phénomène French Touch a progressivement permis à la France de s’imposer sur l’échiquier de la culture pop. La French Touch ou l’entrée de la musique française dans la mondialisation :
« À la fin des années 1990, qu’on soit à Tokyo, à Paris, à New-York, à Londres ou à Singapour, on est une génération qui a les mêmes repères, qui sait utiliser les nouvelles technologies : les frontières se sont abattues » juge Jérôme Viger-Kohler, organisateur des premières soirées French Touch en France.
Contrairement au Made In France, dont la présence en tant que label est censée garantir un certain succès au produit estampillé, il aura fallu que le phénomène French Touch triomphe d’abord à l’échelle internationale avant que les médias français cocardiers s’en gargarisent pour vanter les mérites de leurs compatriotes dans un pays qui s’est toujours montré soucieux de son rayonnement international et d’un éventuel déclin de son influence culturelle :
« Au début, c’était le Tiers monde aussi, maintenant c’est le Koweit (rires). On a vu que ces gens là étaient reconnus à l’étranger mais n’avaient pas leur place dans les clubs parisiens à l’époque. C’était complètement absurde puis on est passé du truc branché chez nos voisins en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis ou au Japon à quelque chose qui a pris en France » poursuit Jérôme Viger-Kohler.
Nul n’est prophète en son pays…
Gianluca Pesapane
Antoine Benacin
Visitez le site du Gorille, le webzine musical du CELSA
Sources :
French Touch, le catalogue de l’exposition des Arts Décos
Reportage « French Touch », TV5
L’émission French Touch de Pop etc. sur France Inter