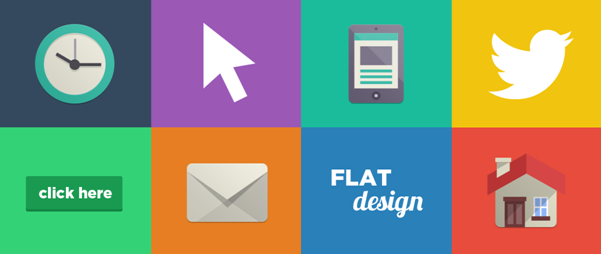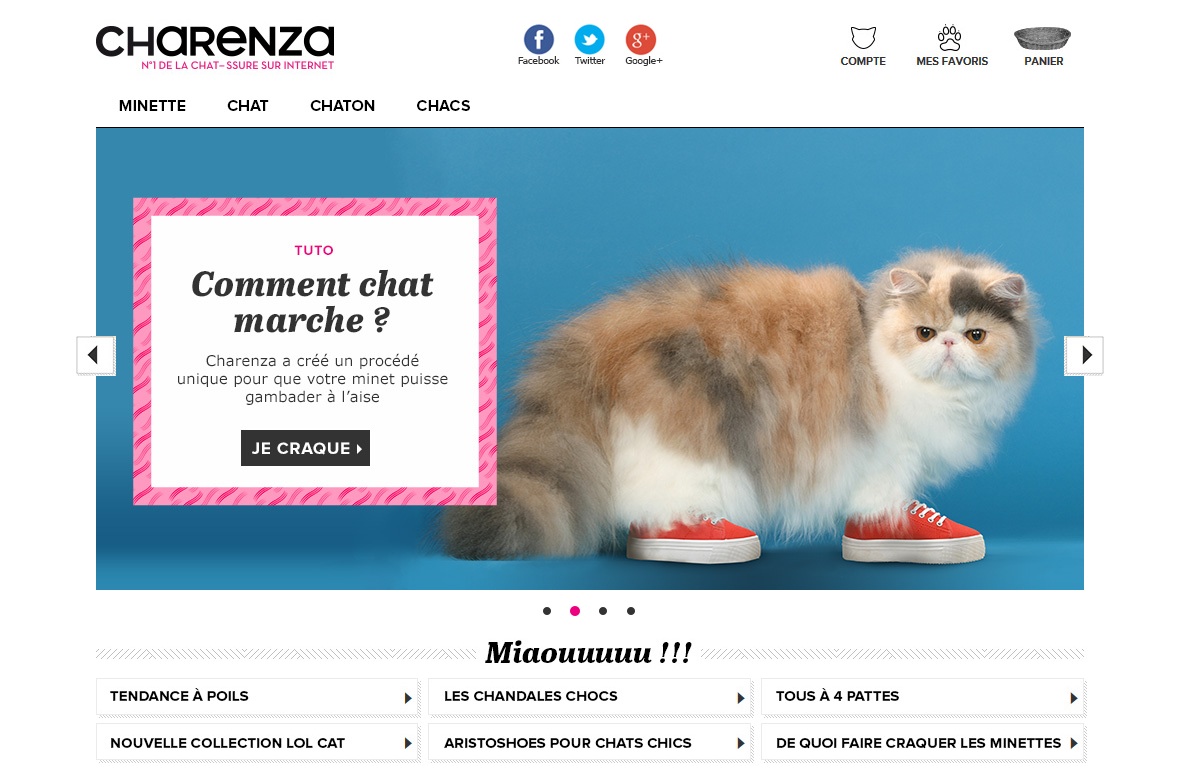Pour ce premier article du Dossier, deux de nos rédactrices vous proposent leurs interprétations des stratégies marketing autour du cross-média et du transmédia, en passant par un éclaircissement définitionnel de ces deux termes. En quoi le cross-média diffère-t-il du transmédia ? Comment annonceurs, agences et chaînes TV les intègrent-ils dans leurs campagnes ?
Le mot d’ordre de toute entreprise médiatique aujourd’hui : la visibilité. Mais quitte à être partout, mieux vaut ne pas le faire n’importe comment.
Plurimédia, cross-média, et dernièrement transmédia… Autant de termes traduisant cette logique et inspirant confusions et interrogations. A première vue identiques, ils se distinguent néanmoins par leur logique marketing qui ne cesse de subir « l’évolution naturelle de la consommation des médias par le consommateur ». Il apparaît d’ailleurs d’autant plus important de saisir les nuances entre les différentes notions que celles-ci sont utilisées dans diverses stratégies marketing par les annonceurs. Tentons donc d’éclaircir ces concepts (et d’éviter de vous perdre), tout en intégrant ces derniers dans des logiques marketing concrètes.
Les premiers pas : et un, et deux, et trois médias !
Dans les années 1990/2000, le plurimédia s’imposait. Il s’agissait alors d’augmenter sa visibilité sur plusieurs médias simultanément, et ce de façon plus ou moins cohérente. Mais les médias se consommaient un à un, sans aucune espèce de lien entre eux, si ce n’est une identité de marque. On se souvient ainsi des produits dérivés issus de la première édition de la Star Academy, diffusée en 2001 sur TF1, qui a abouti à la vente de 400 000 billets pour la tournée, 800 000 exemplaires du magazine, 2 millions de singles et 1,5 million d’albums. La deuxième édition, elle, a donné lieu à la création d’un jeu de société, destiné à transformer toute la famille en stars, et d’un magazine Star Academy, “Le mag de toutes les stars” réalisé par BestNet de Georges Attal. Il s’agissait alors, tout au long des différentes éditions de l’émission, de gagner en visibilité autour de produits dérivés portant la marque « Star’Ac. »
Le cross-média : créer du lien entre les différents supports
C’était le temps du « visible partout » par addition de messages indépendants et dont la cohérence s’articulait principalement autour de la marque. Puis l’arrivée des téléphones portables et l’explosion d’Internet ont changé la donne et la stratégie. Il n’a plus été question de simultanéité et de quantité, mais de connexion : le cross-média était né. L’impératif marketing devient alors de créer du lien entre les médias eux-mêmes afin de renforcer l’impact du message. Une publicité dans un magazine peut renvoyer à un site Internet, renvoyant lui-même à la télévision. Dans le cross-média apparaît également la nécessité d’une histoire pour que « la campagne cross-média guide le consommateur des médias de masse jusqu’à l’acte d’achat », dixit Emmanuel Roye, directeur délégué de NRJ Group. De facto, le cross-média fait intervenir la notion de temps, puisque le dispositif doit avoir un début, un dénouement avec sa dose de suspense, et une fin. Coca-Cola (1) a ainsi opéré une campagne cross-média en réactualisant en janvier 2013 ses traditionnels ours blancs dans ses publicités ; la diffusion d’un spot publicitaire de 60 secondes invitait le consommateur à découvrir un film d’animation de 6 minutes réalisé par Scott Free sur le site officiel de la marque (et également sur YouTube). De même, un retour sur 90 ans de relation entre l’ours polaire et Coca-Cola et une représentation des actions engagées par la marque en matière de croissance responsable ont également été développés sur le site. Avec un tel déploiement, les annonceurs ont alors l’opportunité de diffuser un message davantage ciblé avec des possibilités de personnalisation et surtout d’interaction.
Toujours dans cette logique cross-médiatique, qui permet de communiquer une information, d’entretenir un lien et une fidélisation à travers des médias complémentaires, on peut également penser à la fameuse Odyssée de Cartier. Pour son 165ème anniversaire, le joaillier a invité au voyage et au rêve tout en affirmant la place du luxe dans l’ère du digital. Le film réalisé par Bruno Aveillant avait ainsi été disponible sur Internet avant sa première diffusion sur TF1 et Canal +, dans les salles de cinéma, les magazines ou bien le site dédié (www.odyssee.cartier.fr). La connexion entre ces médias ? La panthère, emblématique de la marque depuis 1904. L’animal se déclinait sous différentes formes, que ce soit la panthère à plusieurs carats sur une bague, le bébé panthère pour le côté mignon tout doux… Toute une aventure retraçant l’histoire de Cartier tout en lui donnant une image jeune, intemporelle.
Cependant, peut-être le crossmédia ne s’arrête-t-il pas aux annonceurs pour autant. Utiliser plusieurs supports pour diffuser un concept, une vision, renvoyer à un site Internet et créer une communauté… Sans que cela n’entre nécessairement dans une stratégie publicitaire ou marketing, on pourrait aller jusqu’à analyser la situation de l’un des artistes contemporains les plus médiatisés du moment : Banksy. Anticapitaliste, antimilitariste, maniant l’humour, la politique et la poésie dans ses pochoirs, l’artiste est également réalisateur (Faites le mur) et auteur (Guerre et spray), tout en relayant sur Internet ses voyages et créations (en témoigne son site lors de sa visite à New-York – banksy.co.uk). L’interaction avec le consommateur pourrait alors résider dans le dynamisme des productions de l’artiste et dans le mystère qu’elles entretiennent.
Ainsi, dans le cross-média, les médias se font écho les uns les autres et entrent en résonance, alors qu’ils s’additionnent dans le plurimédia. La distinction devient cependant moins évidente avec l’arrivée de la notion de transmédia. Les définitions de ces deux phénomènes étant subtiles est souvent floues, tentons alors d’éclaircir les choses.
Le transmédia et la création d’univers dédiés au consommateur
Avec l’émergence des réseaux sociaux et les progrès technologiques croissants, cette « superposition de moyens complémentaires » (2) qu’est le cross-média est dépassée par l’usage du consommateur. Le nouvel enjeu aujourd’hui, c’est de multiplier le message sur toutes les plateformes possibles en faisant non plus de la superposition mais en invitant à imbriquer les messages entre eux, à prolonger l’expérience et surtout à placer le consommateur au cœur de l’histoire. La diffusion de la troisième saison de la série Hero Corp sur France 4, début octobre 2013, a par exemple été accompagnée d’un dispositif transmédia. Robin Digital Content et Simon Astier, cocréateur de la série, ont ainsi conçu une application gratuite sur Smartphone où le téléspectateur peut découvrir du contenu inédit pour aller plus loin dans l’histoire. En interagissant avec ses utilisateurs. L’appli invite aussi à participer à des enquêtes et à visionner des webséries inédites. Elle constitue enfin un second écran pendant la diffusion de la série. De même, durant l’été 2006, les créateurs de la série Lost ont lancé un jeu en réalité alternée (ou ARG), composé entre autre de sites viraux, vidéos et mini-jeux, afin de ne pas perdre l’attention de leurs fans entre les saisons 2 et 3.
Il s’agit alors, avec le transmédia, de créer « une fiction dont vous êtes le héros », dixit Eric Viennot, créateur du jeu d’enquête Alt-Minds. Que ce soit dans une stratégie de cross-média ou de transmédia, l’interaction avec le consommateur s’impose comme mot d’ordre, mais le transmédia y ajoute une expérience immersive totale dans laquelle les entreprises et annonceurs cherchent à attirer le consommateur, ce dernier participant au sens propre à l’histoire. Par ailleurs, l’objectif des deux stratégies de déploiement médiatique diffère. Avec le cross-média, la diversité des supports sert davantage une stratégie marketing et commerciale, même si ce dernier a recours, dans une moindre mesure, à la mise en expérience du consommateur et à l’histoire (ou storytelling). On peut dire que le consommateur, face au transmédia, ne consomme pas seulement le produit, il vit et crée la marque. S’il s’agit toujours de cibler le message et de le rendre interactif, il est surtout question de dissimuler l’aspect mercantile derrière une véritable créativité grâce à la participation, au jeu et à un storytelling complexe, et d’effacer les différents médias convoqués dans un contenu à la fois global et varié.
Les annonceurs aussi s’emparent des réseaux sociaux – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest (qui sait, peut-être même Google+ un beau jour ?) – et amorcent des stratégies cross-média.
En 2012, pour fêter ses 75 ans, la SNCF a ainsi rejoint ces réseaux sociaux, permettant de suivre l’actualité du groupe, de partager les offres commerciales ou même d’organiser un jeu concours sur Instagram invitant les voyageurs à se faire photographes pour immortaliser leurs plus beaux moments sur les rails. A défaut de faire arriver ses trains à l’heure, la SNCF trouvait ainsi le moyen d’inclure ses clients dans son histoire.
Faut-il pour autant voir une stratégie marketing derrière chaque déclinaison de l’univers en question ?
Si l’on s’en tient au phénomène Harry Potter, on note bien une quasi omniprésence du monde des sorciers. A la base série de livres pour enfants, l’adaptation cinématographique n’a pas tardé à faire son entrée pour être suivie de jeux vidéo sur diverses consoles et ordinateurs, envahissant également les jeux plus « traditionnels » (Lego Harry Potter, jeux de société…) ainsi que la sphère Internet. L’abondante production des fans de la saga (fanfictions, création et financement de sites ou jeux en ligne dédiés à cet univers) s’ajoute à cela et pourrait faire croire à une stratégie commerciale. Cependant, le fait que cette déclinaison ait été progressive (et non l’objectif initial de l’auteur) et en partie amateur tend à infirmer cette idée. En revanche, la création du site www.pottermore.com pourrait bien s’en réclamer.
Plurimédia, crossmédia, transmédia sont autant de néologismes qui ont rapidement été mis à profit dans des logiques commerciales. Cependant, ces nouvelles notions posent avant toute chose la question de nos rapports aux médias et de l’usage que l’on en a en tant qu’individu. Les annonceurs peuvent se servir d’autant de supports qu’ils le souhaitent pour pousser à l’achat, ce que nous consommons le plus, ce sont bien les médias eux-mêmes.
Par Annabelle Fain et Eugénie Mentré
(1) Un article du Dossier sera consacré aux stratégies marketing adoptées par Coca-Cola.
(2) Le cercle les Echos : « Le transmédia, avenir de la télévision ? »
Sources :
E-marketing.fr
Stratégies.fr
Orange.fr
Journaldunet.com
Ecs-paris.com