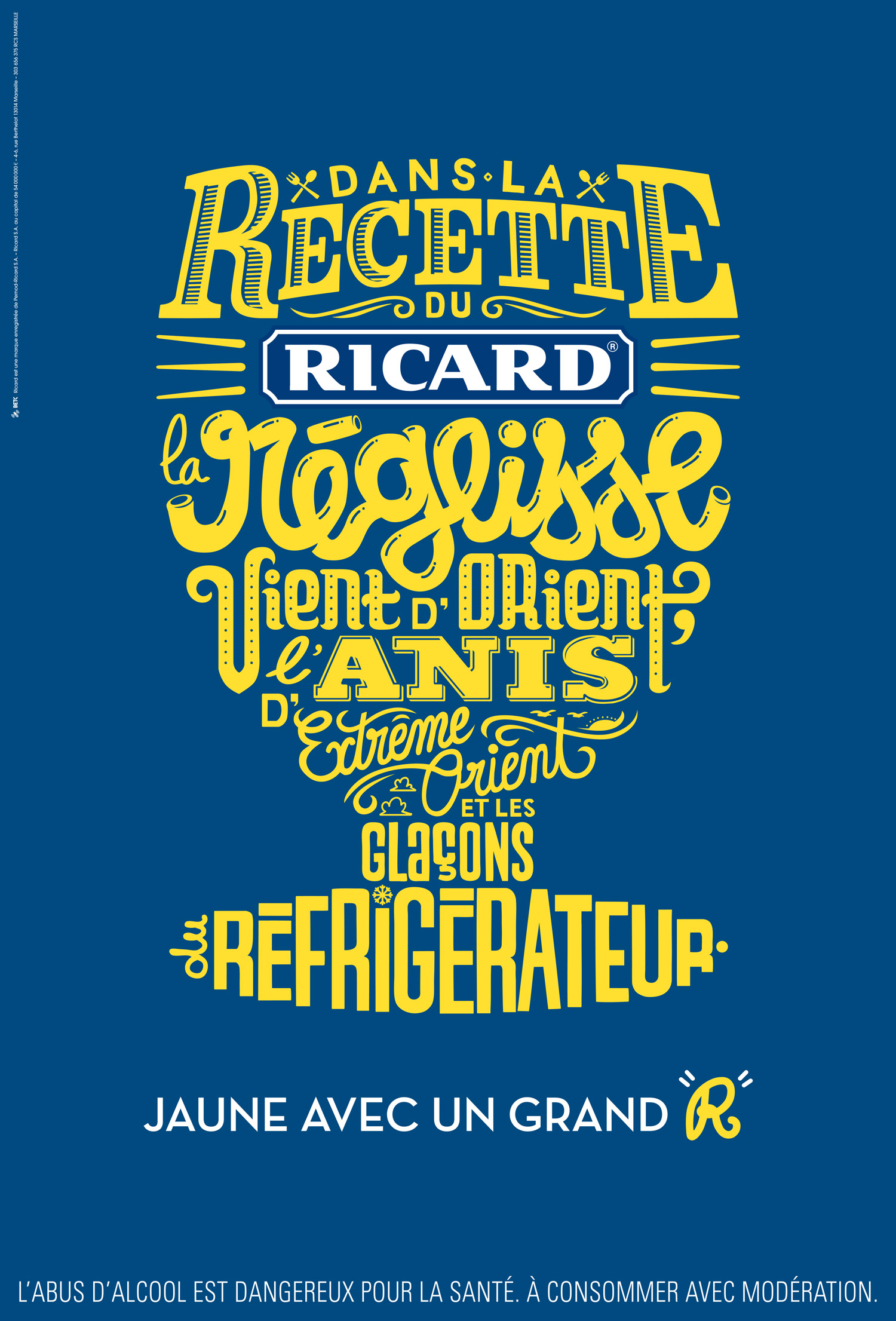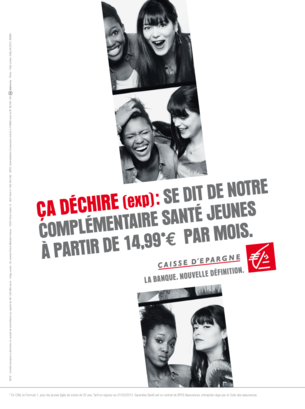Entrepreneur[e]s
A l’heure où la parité gagne du terrain en France grâce aux sanctions financières imposées par le gouvernement, l’inégalité professionnelle entre femmes et hommes demeure forte dans de nombreux secteurs. Le bilan 2013 de la loi pour l’égalité des salaires en entreprise, votée le 2 novembre 2010, fait état de 4 entreprises sanctionnées et plus de 400 mises en demeure (elles ont 6 mois pour régulariser leur situation). Cependant, note la ministre des Droits des Femmes Najat Vallaud-Belkacem, dans l’émission de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV ce mercredi 4 septembre, le chiffre le plus significatif du réveil des consciences est celui des 2700 plans d’égalités présentés par « les entreprises qui ont compris que le couperet désormais tombe ».
Loin du « name and shame » américain, les entreprises en faute ne sont pas expressément désignées. Il nous est donc permis de nous interroger sur les secteurs d’activités les plus concernées par la question de la parité. Comme souvent, les apparences peuvent être trompeuses et les secteurs les plus jeunes et dynamiques ne sont pas toujours les plus justes à l’égard de leurs membres actifs.
Cet été, entre le biopic de Steve Jobs, la sortie du livre de Sheryl Sandberg et le voyage dans la Silicon Valley de notre ministre de l’Economie Numérique, Fleur Pellerin, la question de la position des femmes du secteur « tech », devient brûlante. Mais la médiatisation récente de figures féminines exemplaires dans l’industrie technologique ne parvient pas à masquer la réalité d’une industrie souvent inégalitaire.
A y regarder de plus près, il s’avère que l’écosystème digital, partout dans le monde, n’est pas tendre à l’égard du sexe féminin. De nombreux projets veulent mettre à mal les stéréotypes en encourageant les femmes à se lancer dans l’industrie numérique.
En juillet sur Indiegogo, le projet de deux journalistes (l’une française, l’autre américaine) a récolté des fonds pour la production d’un documentaire sur entrepreneuriat féminin intitulé « She Started It ». Nora Poggi et Insiyah Saeed ont débuté le tournage dans la Silicon Valley et elles ont prévu de l’achever à l’automne en Europe, notamment à Paris. Le but d’une telle production est de mettre en lumière le parcours atypique (ou non) de ces femmes à la tête d’entreprises numériques, mais aussi d’influencer une nouvelle génération de femmes nées avec le digital. Un programme qui se résume par « Si elles l’ont fait, alors pourquoi pas moi ? »
Un projet plus qu’utile quand on s’attarde un peu sur les chiffres de l’entrepreneuriat féminin, en France et ailleurs. Pas une femme à la tête d’une entreprise du CAC 40, et 21 seulement dans le classement Fortune 500 2013 (dont Marissa Meyer, à la 494ème place !). La France affiche un retard flagrant en terme de femmes occupant des postes à hautes responsabilités, loin derrière de nombreux pays européens et asiatiques. Un problème propre à « la culture d’entreprise française » selon Viviane Chaine Ribeiro, administratrice de Syntec Numérique, le premier syndicat professionnel de l’écosystème numérique français.
Dans ce secteur, les efforts sont nombreux pour unir et former les femmes. Girls in Tech, par exemple, fédère une communauté des femmes entrepreneurs dans le milieu technologique, en organisant des évènements qui mettent en avant les talents féminins. La fondatrice de la branche française du réseau, Roxanne Varza, évoque elle aussi la nécessité d’un changement de mentalités. Elle s’étonne notamment de l’absence de fondatrices de sites de rencontres, sites qui s’orientent pourtant vers un public très féminin. AdopteUnMec et Gleeden, qui se démarquent en étant « 100% pensés par des femmes » et au service des femmes, sont tout deux dirigés par des hommes !
A travers ce type de stratégie communicationnelle, c’est l’attitude d’un secteur tout entier qui est remise en question.
L’évolution, plus politique, des femmes dans le monde professionnel depuis ces dix dernières années est en décalage avec le rythme effréné de l’innovation technologique. Pourtant, la population féminine est chaque jour plus présente dans la sphère numérique, comme en témoigne de nombreuses études qui attribuent aux femmes l’utilisation majoritaire de réseaux sociaux tels que Facebook, Pinterest et Instagram. Il semble donc nécessaire pour le secteur des hautes technologies de reconnaître le rôle que les femmes peuvent jouer en son sein, notamment dans leur capacité à comprendre et influencer les utilisatrices qui font vivre l’économie numérique.
L’exode professionnel des femmes s’opère très tôt dans la scolarité, et peu de femmes s’orientent en ingénierie et science de l’informatique. Le taux de reconversion vers d’autres secteurs atteint des sommets au niveau universitaire.
Pour Nora Poggi, la médiatisation des femmes entrepreneurs de l’industrie numérique est un moyen d’inspirer les jeunes générations et de les convaincre de sauter le pas de l’entreprenariat. Elle nous évoque les raisons de son projet et ses aspirations pour le tournage en France : « Notre projet est à vocation globale. Mon but final est de pouvoir aller sur tous les continents à la recherche de ces femmes entrepreneurs dans l’industrie technologique. J’ai donc commencé par ce que je connais : la Silicon Valley où je vis depuis deux ans, et l’Europe d’où je viens. […] En France, j’aimerais interviewer Anne-Laure Constanza de Envie de Fraises, Céline Lazorthes de Leetchi, Fanny Pechiodat de MyLittleParis, et bien d’autres. Je veux m’intéresser aux histoires personnelles et professionnelles de ces femmes. En établissant le contexte de leurs parcours, ainsi que leurs réussites et les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, je pense que nous verrons apparaître de manière sous-jacente les différences culturelles à l’œuvre. Il n’y aura pas de comparaison faite entre les femmes, mais plutôt une mise en contexte. Nous voulons aussi partir tourner à Berlin et à Londres, où tant de femmes entrepreneurs peuvent témoigner. »
Dans cette même lignée, un plan de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin a été présenté mardi 27 août par Najat Vallaud-Belkacem, Geneviève Fioraso et Fleur Pellerin. Aujourd’hui les femmes représentent 30% des entrepreneurs, un chiffre que les trois ministres voudraient voir grimper à 40% en 2017. Et dans le secteur numérique, elles composent 28% de la population active (selon Syntec Numérique), un chiffre bien en deçà de la moyenne nationale.
Ce plan de sensibilisation vise à agir tout au long de la scolarité en rendant l’entrepreneuriat attractif et accessible aux femmes. Un site de référence doit voir le jour en octobre 2013, et des fonds spécifiques vont être alloués aux projets d’entreprises menés par des femmes.
Clémentine Malgras
Sources :
She Started It Itw de Viviane Chaine Ribeiro pour Les Echos Plus d’infos sur le plan de sensibilisation : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/entrepreneuriat-au-feminin-un-plan-pour-lever-les-obstacles