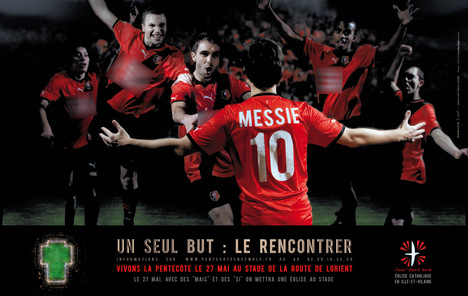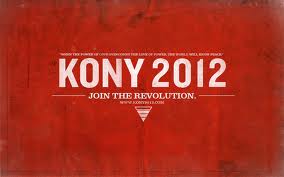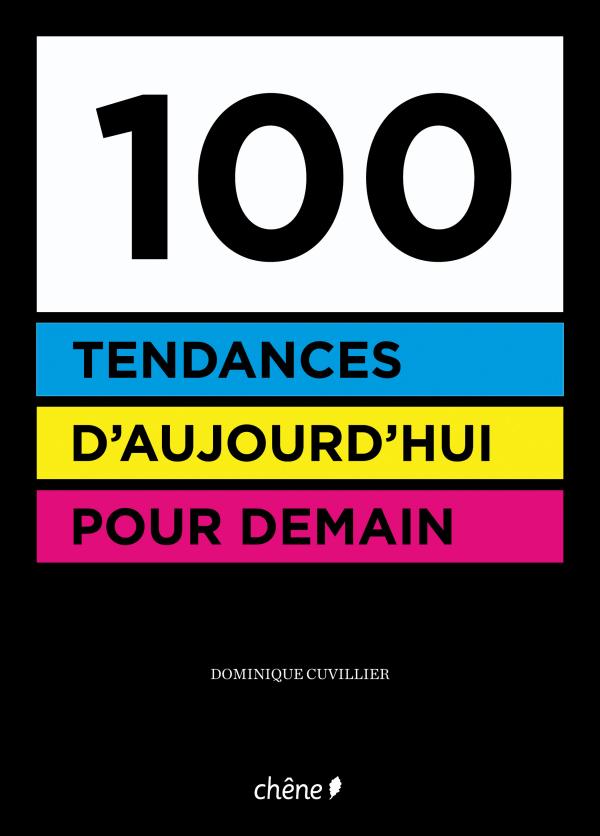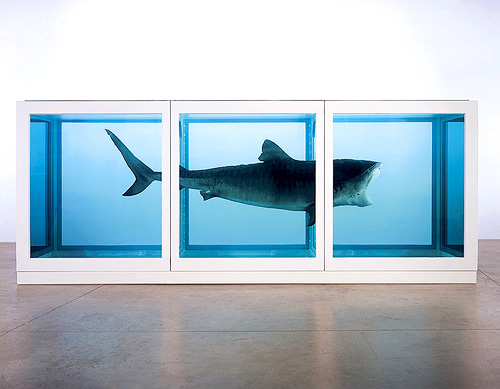Jacques a dit que c’était le bon temps…
La nostalgie est de mise ces derniers temps. Les anciennes stars remontent sur scène et font salle comble, les films parlent de stars décédées pour raconter leurs vies… Tout est bon pour fuir la crise et ce monde bien compliqué qui oblige à réfléchir sur l’essentiel. Les gens sont submergés de problèmes, le chômage monte, la délinquance est partout et la peur s’installe vite. Et si on reproche aux politiques de ne pas parler assez de la crise, on ne reproche en revanche pas aux publicitaires de tout faire pour nous en éloigner (ce qui est après tout leur rôle). Par exemple, le métro se couvre depuis quelques jours d’affiches sur la (re)sortie au cinéma du Roi Lion, mais en 3D cette fois. Disney est l’un des maîtres de cette publicité de la nostalgie, ressortant notamment en DVD remastérisé tous les Disney un à un, replongeant les enfants et les anciens enfants devenus parents dans la douceur d’un monde où la fin est toujours heureuse.
Un autre exemple, le dernier en date, est celui d’Hollywood chewing-gum. Si vous avez allumé votre télévision dernièrement, vous n’avez pas pu manquer cette publicité qui commémore 60 ans de pubs télévisuelles de la marque.
On commence par voir un amoncellement de vieux postes TV sur lesquels défilent toutes les publicités des fameux chewing-gums depuis la création de la marque. Puis, au moyen d’une mise en abîme, la caméra nous fait entrer dans l’un des écrans et nous présente un paquet de chewing-gums Hollywood mentholés, les plus classiques qui soient. Ce paquet reviendra ensuite entre chaque extrait publicitaire durant les 30 secondes du spot, à la manière d’un message subliminal : moins d’une seconde à l’écran, seul élément visible sous la forme d’un de ces « freeze » d’image qu’avaient les anciennes télévisions. Ce vieil écran un peu détraqué dans notre télévision HD moderne, ainsi que ce paquet vert reconnaissable entre tous, sont les premiers éléments nostalgiques de la publicité et présentent la cible : ceux qui ont connu ces grosses et lourdes télévisions, bien avant les écrans plats et les dimensions extravagantes. Un petit retour dans le passé donc, tant par la forme que par le thème, et qui est récurrent grâce à ce « freeze » que l’on retrouve tout au long du spot publicitaire.
Ensuite, différents moments se suivent ponctués par les dates des différentes pubs : 1985, 1988, 91 et 99, 2006 puis 2009 et enfin, bien que la date ne le mentionne pas, la dernière image est celle d’aujourd’hui avec le nom de la marque et le sigle des 60 ans. L’idée de « toujours là » est parfaitement véhiculée, et en 30 secondes Hollywood chewing-gum parvient à faire revivre aux anciens enfants, désormais adultes d’une quarantaine d’années, les différents moments de vie qui ont accompagné ces différents concepts publicitaires. Pour ma part, la première fois que ma zapette m’a amenée sur ce spot, j’ai senti une bouffée nostalgique m’envahir en voyant la statue de la Liberté jeter sa culotte et plonger dans la baie de New-York : combien de fois ai-je pu voir cette publicité étant enfant ? C’est d’ailleurs l’extrait le plus long de la courte vidéo (7 secondes contre 2 à 5 secondes pour tous les autres), ce qui montre bien son impact à l’époque de sa sortie. Le retour du slogan musical « fraîcheur de vivre » à la fin est un autre rappel de ce temps qui passe et de la mémoire qui accompagne les slogans publicitaires (et donc de leur efficacité !).
Cette célébration médiatique est ainsi parfaitement adaptée non seulement par rapport au contexte mais aussi dans sa forme même. Nombreuses sont les publicités qui ont traversé les âges et que l’on évoque entre amis ou en famille (la marmotte qui emballe le chocolat notamment, qui est un grand classique). Par ce moyen, Hollywood chewing-gum aide ces réminiscences et s’ancre dans le temps médiatique comme une marque inébranlable et incontournable, mais aussi ancrée dans le présent car les trois derniers extraits sont les plus longs, comme pour bien montrer que l’évolution a été positive et que ces publicités sont les plus importantes. Il y aurait beaucoup à dire sur l’évolution des concepts publicitaires, mais un regard rapide sur la forme cette publicité nous apprend déjà beaucoup à propos d’une stratégie communicationnelle qui fonctionne et qui dure.
Héloïse Hamard