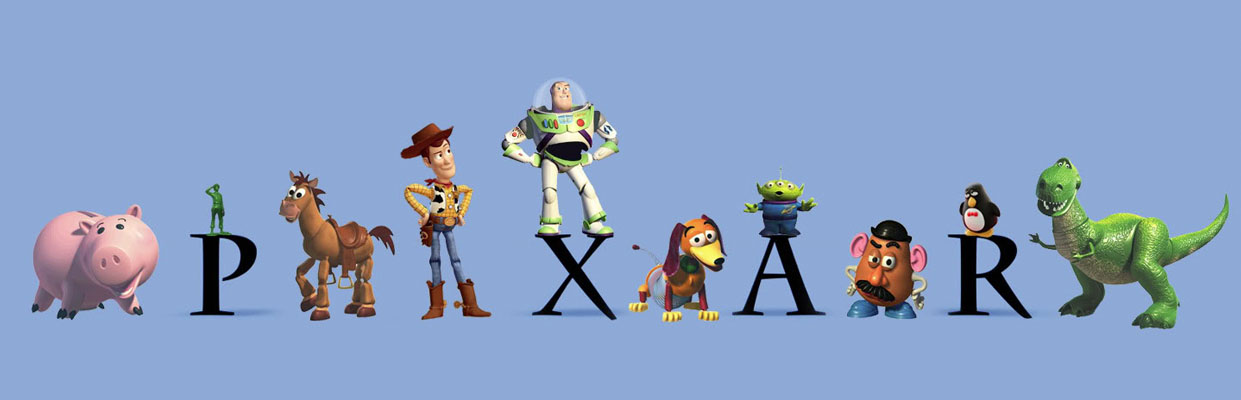I’m a Barbie girl
Quoi de neuf au pays merveilleux de Barbie ? Il y a quelques semaines, la plus célèbre poupée de 29 cm semblait se la couler douce avec son amie Victoria Beckham. Cette dernière s’est en effet lancée dans une vaste entreprise de revalorisation de son image ; et quoi de mieux pour Posh qu’une séance photo avec la copine de Ken pour paraître plus cool, décontractée, détendue ? « Life in plastic, it’s fantastic », isn’t it ? Ce genre de campagne de self-branding semble en tout cas témoigner d’une réalité indéniable : Barbie peut devenir un véritable outil de communication. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que Mattel a vendu en 1997 sa milliardième poupée (apparue en 1959) et, qu’aujourd’hui, environ cent cinquante deux exemplaires sont achetés chaque minute.
Surfant sur ce succès mondial non démenti, le site américain Plus-size-modeling.com, spécialisé dans les mannequins rondes, a enflammé la Toile le 18 décembre en postant sur Facebook une photo comparant la Barbie traditionnelle avec son pendant XXL.
Dès le 18 décembre, donc, les réactions ne se font pas attendre. Pas moins de 37 000 likes accueillent la publication et nombre de commentaires s’y ajoutent. La question soulevée par le site – devrait-on commercialiser une telle poupée au physique moins conventionnel ? – est simple ; et pourtant, elle se heurte à un certain paradoxe qui alimente les débats houleux.
Les critiques classiques que reçoit Barbie tournent continuellement autour des mêmes sujets. Ce jouet contribuerait à répandre une image précise de la femme au physique stéréotypé. Difficile alors pour les petites filles d’accepter leur propre apparence lorsque les canons de beauté définis comme idéaux sont si strictes et difficiles à atteindre. Et que dire du rôle social réservé à une telle figure féminine qui a tous les traits d’un simple fantasme masculin, à la limite du pornographique ? « You can touch, you can play, if you say, I’m always yours » : Barbie est encore bien loin du modèle plus féministe de femme libérée. Mais cette poupée XXL n’est-elle pas la porte ouverte à toute une série de nouveaux clichés ? Ce double, voire triple menton -n’ayons pas peur des mots- est-il réellement représentatif d’un physique plus standard ? D’après certains commentaires nous serions plutôt face à une caricature des femmes rondes. Et il y a encore plus grave.
Est-il nécessaire de rappeler que l’obésité est, parfois une maladie, du moins toujours dangereuse ? Ainsi, si on craint que les jeunes filles ne s’identifient à la Barbie taille XXS, est-il préférable qu’elles imitent la Barbie XXL ? A une autre échelle, pour soutenir une petite fille malade, Mattel avait créé il y a quelques années une Barbie chauve. Certaines associations encourageaient alors à la commercialisation de telles poupées. Mais si l’entreprise est louable et touchante lorsqu’elle reste ponctuelle, il devient bien plus malsain d’encourager les enfants à jouer avec des miniatures atteintes de cancer.
On pourrait alors même craindre que le projet de Barbie ronde n’ait plus de véritable portée éthique, mais devienne un simple objet de communication : à l’heure où les enseignes vestimentaires se doivent d’élargir leurs gammes de vêtements pour toucher des cibles plus corpulentes, ce genre de jouet pourrait devenir un support publicitaire idéal.
Face à ces dénonciations concernant les modèles qu’elle impose, l’entreprise Mattel pourrait rétorquer qu’il ne s’agit aucunement de communiquer un quelconque imaginaire et que Barbie reste un jouet, donc forcément une stylisation. D’ailleurs, ses proportions ne sont en rien réalistes : si Barbie sortait de son « Barbie World », elle ressemblerait à une espèce de monstre difforme, en rien désirable, comme l’a montré une étudiante américaine en 2011.
Oui mais justement, c’est là que le bât blesse. Depuis sa création, Barbie s’est targuée de véhiculer une certaine image positive de la femme à travers le monde. Dès 1967, et plus fréquemment à partir de 1980, la poupée s’est par exemple diversifiée selon les types ethniques. Lorsque l’on se vante de symboliser la diversité, forcément, les impératifs et les controverses deviennent plus systématiques. De même, à partir des années 70, Barbie voit ses professions et ses loisirs se multiplier afin de symboliser le plus fidèlement possible la diversification du rôle de la femme. Dans les années 80, on peut même lire le slogan « We, Girls, can do anything. Right Barbie ? ». Barbie féministe qui assure que les femmes peuvent avoir accès aux mêmes métiers que les hommes ? Laissez nous rire.
Pour échapper aux polémiques, il faudrait alors que la marque Mattel se positionne : sa Barbie est-elle un simple jouet innocent ou un vecteur de communication d’une certaine image de la femme ? C’est peut être la première question à se poser avant de se demander s’il est nécessaire de commercialiser des poupées de corpulence variée.
Mais si l’on en juge par le happening organisé par l’ONG Peuples Solidaires le 10 décembre, à savoir placer une poupée ouvrière de deux mètres de haut sur les Grands Boulevards pour sensibiliser les passants aux conditions de travail chez les sous-traitants de Mattel en Chine, il semblerait que la popularité de l’indémodable Barbie en fasse un support parfait de communication. Une Barbie engagée deviendrait un excellent moyen de toucher le grand public. Serait-il alors temps pour la « blond bimbo girl » de sortir de son « fantasy world » ?
Margaux Putavy
Sources
HuffingtonPost
LeFigaro
Magrandetaille