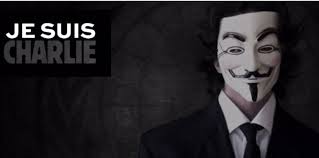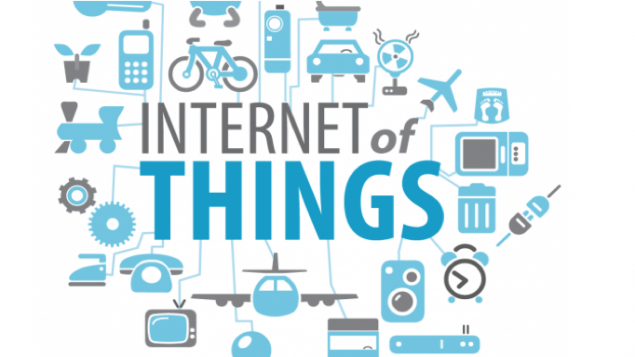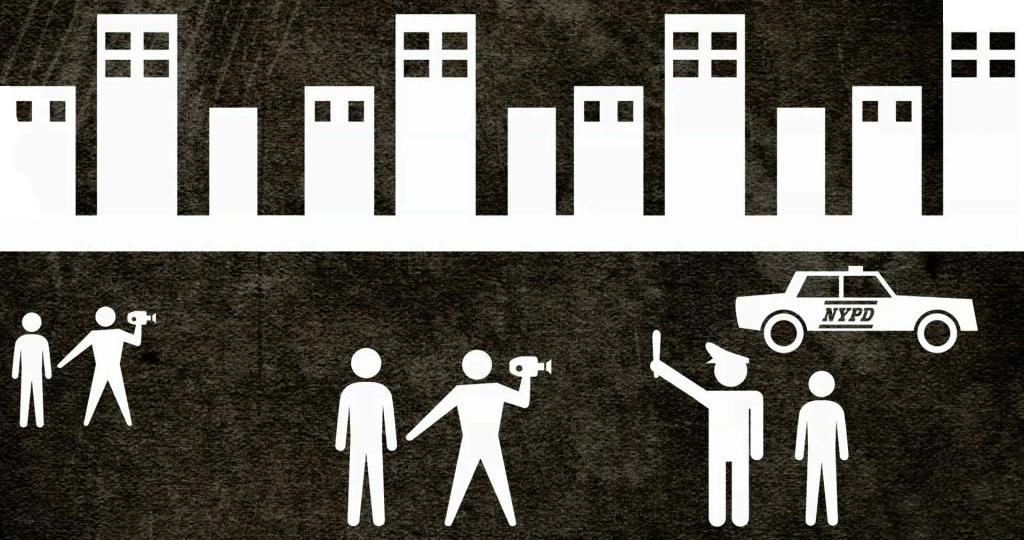Une parité intellectuelle siliconée
Le 28 janvier 2015, Newsweek consacrait sa Une à la Silicon Valley et à son rapport aux femmes, « What Silicon Valley thinks of women ». La couverture a fait parler d’elle dans les médias en raison de l’ironie qu’elle met en scène avec une représentation de la femme objet. Or, si certains médias ont très vite salué la ridiculisation mise à l’œuvre par Edel Rodriguez, le dessinateur, d’autres y ont vu une caricature sexiste servant la misogynie pourtant dénoncée dans le papier.
Ces réactions contrastées mettent en exergue l’ambivalence de la représentation de la femme dans l’imaginaire social, mais aussi, sa représentation selon et parmi les élites.
Le site Women 2.0 fait état de menaces des fraternités reçues à l’encontre d’un de ses rédacteurs Vivek Wadhwa qui s’attache activement à défendre la place des femmes dans les plus hautes sphères hiérarchiques de la société.
Cette misogynie qui se traduit par le mépris des « cerveaux » de la Silicon Valley, par du harcèlement et parfois par des contrats rompus est souvent justifiée ou en tous cas expliquée par l’isolement du profil des employés de la Silicon Valley. C’est de fait le portrait du geek ou d’un individu n’ayant d’autres contacts avec la gent féminine que dans l’espace de leur foyer où leur autorité n’est pas contestée. Ces justifications qui dressent des portraits type de l’homme qui peuple la Silicon Valley n’auraient-elles pas pourtant tendance à accentuer cette barrière entre l’homme à la pointe de l’innovation capitaliste et de la femme ?
L’imaginaire d’une élite masculine
Certes, plus que le problème de l’égalité paritaire dans les faits, la caricature d’Edel Rodriguez amène à penser la représentation des femmes parmi l’élite et plus précisément dans ce cas, au sein de la Silicon Valley.
La Silicon Valley est elle-même une allégorie des entreprises les plus innovantes basées dans le bassin californien. De ce fait, elle est tantôt fantasmée pour sa création technologique produite par des cerveaux venus du monde entier, tantôt abhorrée pour le capitalisme qu’elle symbolise ainsi que pour les secrets qu’elle abrite.
Ce fantasme s’illustre notamment à travers le succès international de la série The Big Bang Theory. Or c’est bien à travers ces représentations fictionnelles qu’est véhiculé le portrait du génie actuel. Le personnage de Sheldon figure ainsi une intelligence exceptionnelle détachée de toute émotion ainsi que de tout respect envers la gent féminine. Si Sheldon parvient à trouver en la personne d’Amy Farrah Fowler son alter égo féminin, celle-ci demeure attachée à des émotions que n’éprouve pas Sheldon telles que des pulsions sexuelles. En définitive, le personnage de Sheldon flirte avec l’irrationnel et l’émotionnel dès lors qu’Amy Farrah Fowler prend une part grandissante dans son quotidien. C’est donc l’image du scientifique rationnel qui transcende l’humain qui est opposée à celle de la femme ramenant constamment au pathos. Par là même, le travail d’intégration des femmes dans l’élite n’est pas que pratique, il est également fictionnel puisqu’il n’est pas efficient dans les consciences et dans l’image culturelle de la femme.
Une réalité contaminée par la représentation misogyne
Si la Silicon Valley est aujourd’hui le premier lieu qui convoque l’idée d’élite dans l’imaginaire collectif, la presse écrite incarne également le lieu d’une élite intellectuelle au regard de la doxa. En ce sens, la Une de Newsweek n’est pas anodine puisqu’elle transmet une image presque banalisée du rapport entre hommes et femmes au travail. De ce fait, cette Une se fait porteuse d’un sens, celui de l’imaginaire collectif façonné en grande partie par la presse et les médias en général qui établissent le lien entre le démos (le peuple) et le cratos (le pouvoir).
C’est pourquoi les représentants des médias sont aussi les ambassadeurs du progrès social en ce qui concerne l’égalité, la parité puisque ce sont les premiers à notifier les discordances de nos démocraties. Toutefois, la presse qui incarnerait au mieux une élite libérale au sens le plus large du terme, est aussi un média très masculin où la valeur intellectuelle de la femme n’est pas affirmée dans la représentation hiérarchique des rédactions. Ce sont ainsi les exemples de Jill Abramson au New York Times ou encore de Natalie Nougayrède au journal Le Monde. Si ces deux femmes sont parvenues au poste prestigieux de rédactrice en chef dans les faits, leur autorité et leur légitimité ont vite été contestées au cœur même de leur rédaction, ce qui souligne en creux une incapacité de la part de certains intellectuels à reconnaître la supériorité hiérarchique d’une femme par sa culture, sa compétence.
Par là même, plus qu’une réalité factuelle il s’agit bien d’une perception de l’image de la femme, de sorte qu’une femme se verra moins questionnée sur son expertise que sur ses émotions en raison d’une représentation culturelle de la psyché féminine.
Les remèdes sont-ils politiques ?
Depuis la présidence de M. Hollande, l’intégration d’une égalité homme-femme dans la politique a été mise en valeur de sorte que les mesures pour la parité ont été poussées et peut-être poussives.
Certes, il s’agissait par exemple de proposer des listes parfaitement paritaires pour les élections municipales où le nombre de candidats est souvent insuffisant dans certaines communes. Si ces mesures étendues à d’autres sphères comme au gouvernement avec un équilibre entre le nombre d’hommes et de femmes parmi les ministres, part d’une bonne volonté, le résultat sur la représentation des femmes peut être plus contestable.
De fait, ces mesures indiquent une incapacité à parvenir à une égalité fondée sur le mérite et questionnent la légitimité de toute discrimination dite « positive ». S’il est nécessaire d’imposer un changement pour qu’il ait lieu, ne serait-il pas plus à propos de démontrer par le mérite que la valeur intellectuelle d’une femme est égale à celle d’un homme ? En conséquence, les premiers acteurs de cette démonstration ne pourraient être que les médias ainsi que les génies de la Silicon Valley. A quand une Sheldon au féminin ?
Marie Vaissette
Sources
Newsweek.com
Courrierinternational.com
Women2.com
Huffigtonpost.com
Allocine.fr
Lemonde.fr
Lemonde.fr