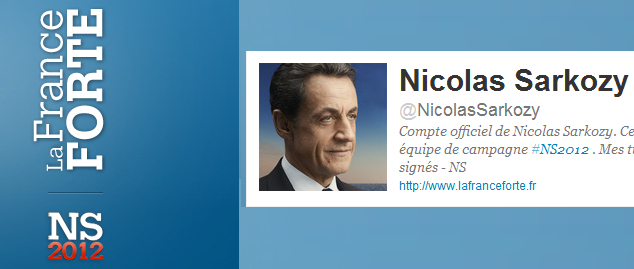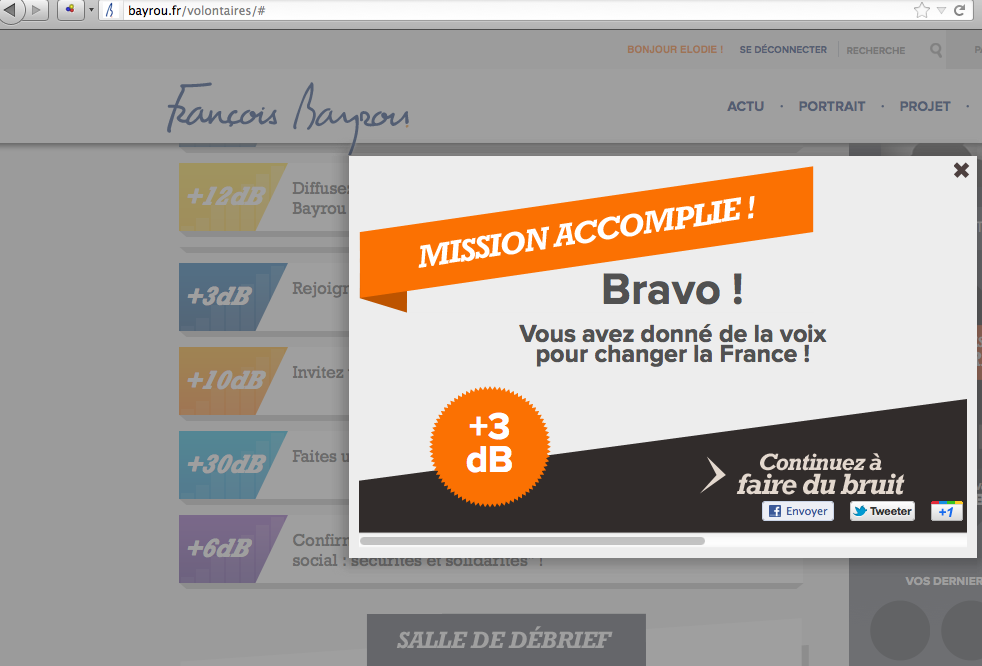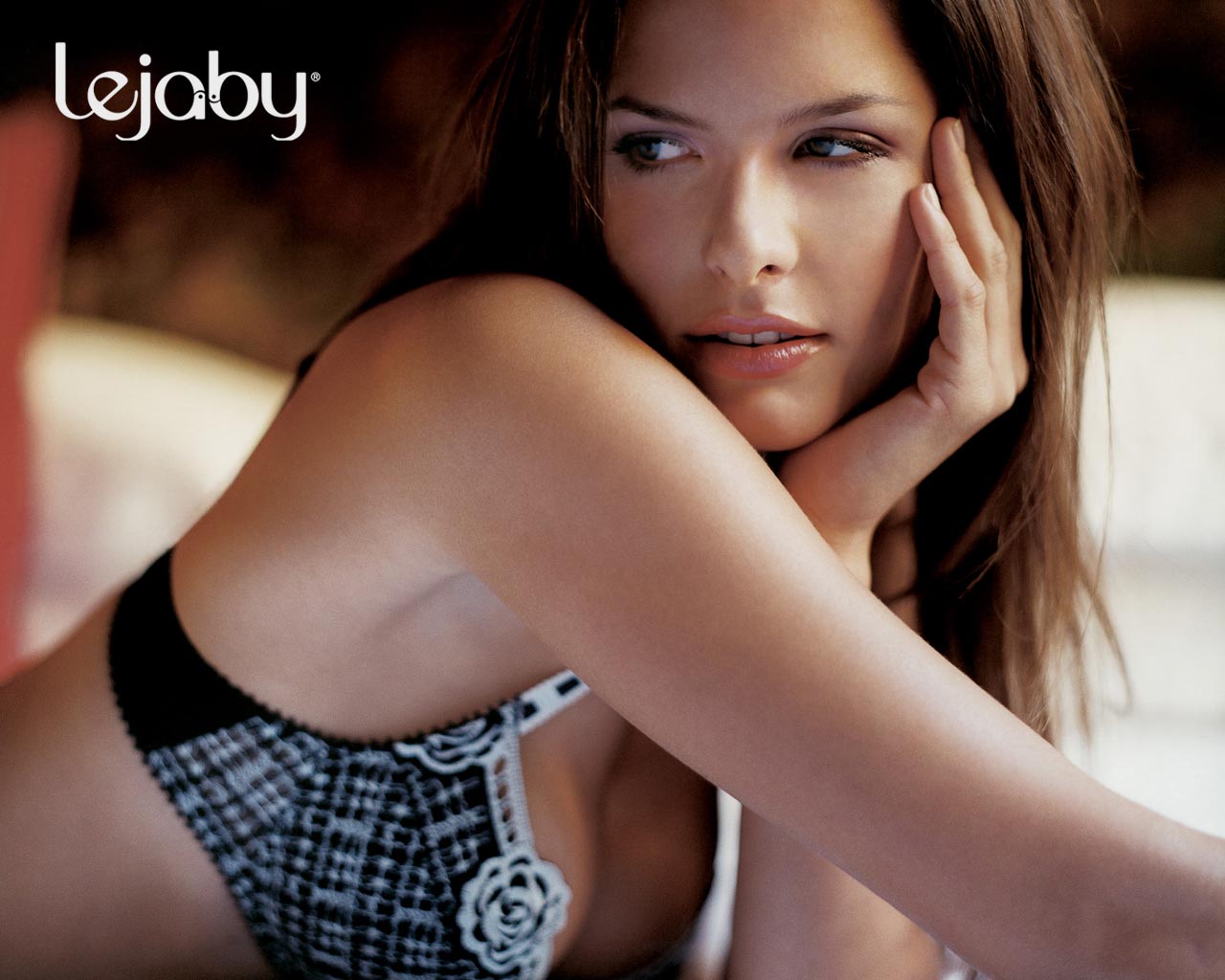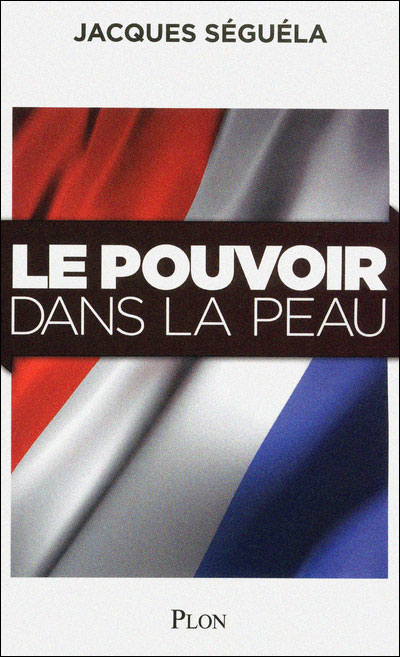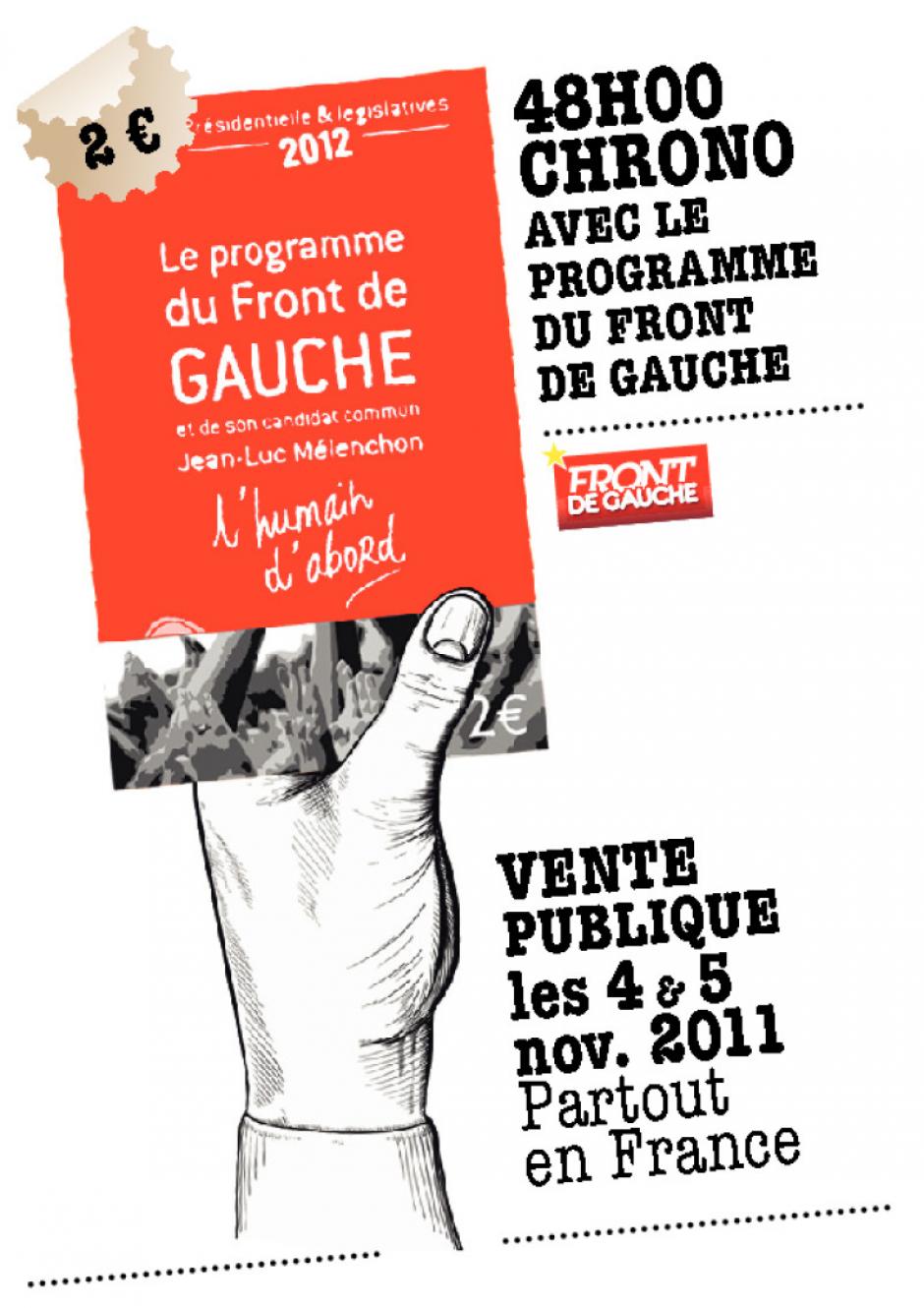Je suis un « anti-communicant »
Début février, nous avons rencontré Maxime Verner, le déjà ex-étudiant du Celsa mais surtout le plus jeune candidat (22 ans) à l’élection présidentielle de 2012. Légèrement en retard, l’outsider nous dit apprendre plein de choses grâce à la campagne qu’il mène, son « école de la vie » comme il aime à le dire. A ce jour, Maxime Verner avait 302 promesses de signatures de maires de villages et de villes qui comptent entre 5 et 8000 habitants. [Il lui en manque aujourd’hui une centaine.] Il avait encore 180 rendez-vous prévus avec des élus dans le mois suivant… « Quand je fais un truc, je le fais à fond ». Pour le vérifier, suivez-le sur Twitter et soyez informés de tous ses voyages !
Croiser un candidat, en théorie, c’est pour parler de politique. Mais nous, nous avions plutôt à cœur de comprendre sa communication. Alors dans cet article, nous ne parlerons pas de la loi pour l’éligibilité des jeunes qu’il a fait passée en 2010, ni de l’Association des Jeunes de France, ni de son livre, ni de ses propositions pour la jeunesse, ni de celles sur l’économie, encore moins de celles à venir sur l’éthique. On trouve tout cela ici. Nous nous contenterons donc de dire qu’il est un candidat de proposition qui ne veut pas être président mais apporter un dynamisme à la campagne, des idées neuves et de vraies propositions pour un projet de société fondé autour d’une politique d’investissements sur la jeunesse. Car la politique, « c’est à tout le monde ». Il aime citer Camus (« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ») et faire le « V » avec ses doigts comme Verner mais c’est surtout « le signe le plus courageux et le plus symbolique » qu’il se puisse faire en temps de crise, Churchill le faisait en 1940.
Le « porte-voix de la jeunesse » se fout de l’image qu’il renvoie il s’en fout de la forme : « Ce qui [l]’intéresse, [le] passionne et ce qu’[il] veux faire, c’est ça : du fond ». D’où sa volonté de ne répondre qu’aux invitations d’émissions qui lui permettent réellement d’exprimer ses engagements. Par principe, il ne refuse pas les médias associatifs (et surtout pas FastNCurious). Il se dit lui-même « anti-communicant » et préfère largement Twitter à Facebook. Il y voit un lieu de rencontre et de débat avec des personnes influentes et y va quand il a un moment. Facebook, il ne s’en sert que comme d’un relais vers son site. D’ailleurs, 4000 personnes par jour vont sur son site (qu’il dit lui-même « mal foutu ») en venant de Facebook pour y découvrir ses articles et ses documents en PDF.
Lorsqu’il officialise ses programmes, il convie ceux qui le veulent. Comme les journalistes ne viennent que si leurs patrons le demandent, inutile de perdre du temps à leur courir après. De même, il dit ne pas être là pour diffuser sa pensée à des milliards de personnes mais plutôt pour débattre et convaincre ceux qui sont réellement ouverts à une politique audacieuse. En clair, il est disponible mais ne force personne à l’écouter. Il propose, à l’électorat et aux citoyens de disposer !
D’un esprit curieux, il voit que ce qui manque à la société, c’est de l’« humain ». Alors il va à la rencontre des gens physiquement. Il lit beaucoup et se nourrit de trois débats par semaine minimum. Il aime y croiser des gens, des passions et des projets qui viennent alimenter et consolider son propre système de pensée. Il précise d’ailleurs que sa communication et sa démarche se fondent avant tout sur l’humain et la générosité. Point trop d’argent, on peut faire un don à son association mais pas plus de cent euros, ainsi on reste fidèle à l’idée de l’association et Maxime Verner reste indépendant. Ses affiches ? C’est un architecte qui a une imprimerie qui les lui a imprimées. Quand il se déplace, il puise dans ses économies personnelles mais cela ne lui coûte pas trop cher puisqu’on lui prête des voitures et qu’il dort chez l’habitant. Et quand il rencontre des élus locaux, il leur parle et leur projette ses idées novatrices et ambitieuses. Il sait que les maires parlent entre eux et mise sur le « bouche à oreille » et le « téléphone arabe ».
Thomas Millard, Romain Pédron et Ludivine Préneron