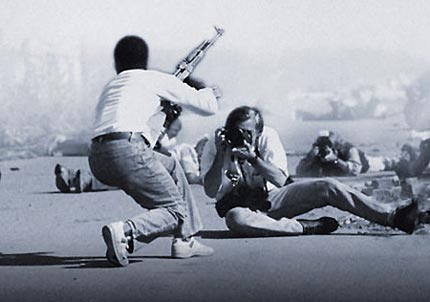Kiss for peace
Benetton n’a pas froid aux yeux. La nouvelle campagne « Unhate » de l’agence italienne Fabrica fait polémique dans l’hexagone et au delà de ses frontières. En effet, quand l’agence italienne Fabrica, centre de la recherche sur la communication du groupe Benetton, lance une campagne choc, ça donne : une série de dirigeants de ce monde s’embrassant de manière improbable. La campagne déclinée en plusieurs visuels montrent des images de baisers sulfureux entre les plus hauts gradés de ce monde : le Pape Benoît XVI embrassant sur la bouche l’imam sunnite de l’université égyptienne Al-Azhar, Barack Obama et le président chinois Hu Jintao, le président de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Même notre cher président n’y a pas échappé : c’est son homologue allemand Angela Merkel qu’il a le privilège d’embrasser.
Le caractère controversé des campagnes Benetton n’est plus à prouver. Nudité, vieillesse, diversité, famine, autant de thèmes que Benetton met en scène de manière crue et dissonante. Quand il s’agit de faire parler d’elle, la marque d’habillement italienne excelle. Sa campagne Unhate est un message qui nous invite à considérer que l’amour et la haine ne sont pas des sentiments aussi éloignés qu’ils en ont l’air. Selon le site dédié à la campagne, ces deux sentiments antagonistes sont souvent soumis à un fragile équilibre.
Cette campagne au-delà de son aspect polémique nous pousse à ne pas haïr. Avec Benetton, encore une fois, la communication est au service de la défense de valeurs. Le discours publicitaire s’adresse à l’inconscient et sort du seul discours rationnel. Ici le mécanisme du discours du surmoi vise à modifier les comportements pour les rendre conformes aux intérêts supérieurs de la société. La marque érige ses valeurs en idéal à atteindre. Elle s’efface, délaisse son identité de marque de mode et laisse place à son combat pour les valeurs.
Même si la démarche est habile, et que beaucoup applaudissent le succès de Benetton, tous ne regardent pas d’un œil clément cette singulière campagne. À commencer par les personnes concernées. La maison Blanche désapprouve l’utilisation du nom et de l’apparence physique du président, et le Vatican, quant à lui est très « fâché » également. Le Saint Siège a pris les mesures nécessaires pour bloquer la diffusion de l’affiche considérant ces clichés comme une atteinte à la dignité.
En somme, pari réussi pour Benetton qui a fait parler de lui mais cela demeure un exemple criant de l’éternelle ambigüité que suppose la liberté d’expression !
Rébecca Bouteveille
Merci à Benetton pour leur coopération !
Photos : ©Benetton