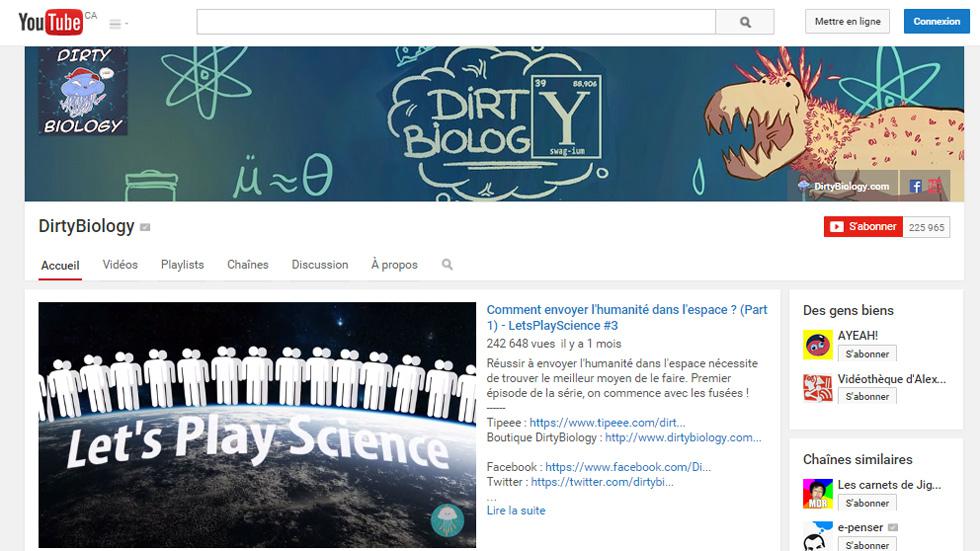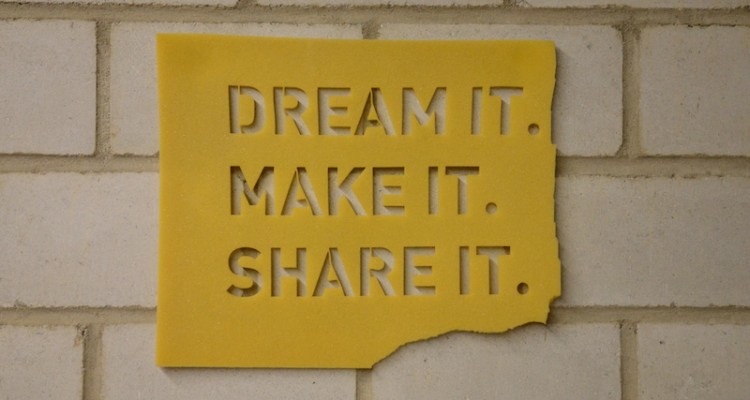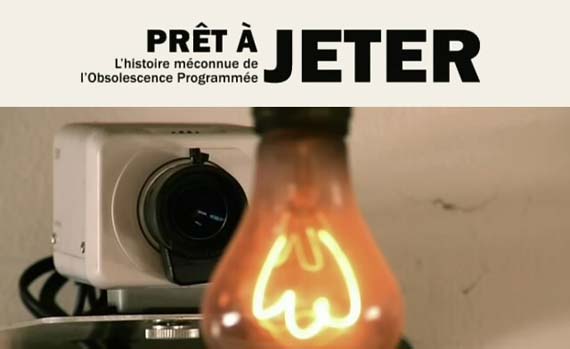Et si les youtubeuses beauté ne savaient pas tout ?
Salut les filles ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd’hui pour parler de l’influence de vos youtubeuses préférées et des dangers qui en découlent. Ne vous inquiétez pas, j’ai mis toutes les références en barres d’infos. N’hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si le sujet vous intéresse et à vous abonner à ma chaîne bien sûr !
Il est aujourd’hui difficile de passer outre les tutos beauté sur YouTube et leurs créatrices, ces nouveaux gourous du net que sont les youtubeuses beauté. Véritables influenceuses, elles partagent des conseils beauté avec leurs nombreux abonnés. Il semble néanmoins que leur champ de compétence ait aujourd’hui bien évolué. Mais où s’arrête la légitimité des youtubeuses beauté ? Quelles peuvent être les conséquences d’un amateurisme qui s’impose comme une référence ?
De la bonne copine à la professionnelle, il n’y a qu’un pas (et quelques milliers d’abonnés)
Rappelons tout d’abord que ce qui fait le succès d’une youtubeuse, c’est en partie sa proximité avec son public. Après tout, c’est une fille comme vous, comme nous, un peu comme la grande soeur qu’on n’a jamais eu. Une véritable relation se tisse et vidéo après vidéo, conseil après conseil, la confiance s’installe. Plus leur notoriété augmente, plus la part de confiance qui leur est accordée est importante.
Nous avons pu remarquer ces dernières années que ces youtubeuses tendent à se présenter comme des « professionnelles » de la beauté. La qualité visuelle de leurs vidéos, les partenariats avec des marques ou encore la participation à des émissions de télévision pour certaines (la célèbre EnjoyPhoenix est une habituée des plateaux et a même participé à Danse avec les stars récemment), véhiculent cette image professionnelle, alors qu’en réalité elles ne possèdent aucune formation en esthétique ou en coiffure pour la grande majorité. Autodidactes, elles s’en sortent souvent très bien. Et même dans les cas où leurs conseils seraient mauvais, un maquillage raté n’est pas un drame : on l’essaie devant son miroir et si ça n’est pas réussi, on se démaquille. Or, si leur non-expertise ne les empêche pas d’être très douées, voire même meilleures que certains experts, il semblerait que cela puisse devenir problématique quand elles tentent d’étendre leurs compétences à des domaines plus spécialisés et plus complexes.
Les youtubeuses beauté sont-elles mauvaises pour la santé ?
Pour continuer à séduire leurs fans et pour ajouter du contenu à leur chaîne, les youtubeuses beauté donnent maintenant de nombreux autres conseils : lifestyle, santé, cuisine, vie privée… Tout y passe. Certaines donnent par exemple des conseils sur les problèmes de peau. N’étant pas diplômées en dermatologie, il semble naturel de remettre en question la légitimité de leur parole. Elles ne font, en effet, référence qu’à leur propre expérience, à d’autres vidéos qu’elles ont pu voir ou encore à des informations qu’elles ont elles-mêmes trouvé sur Internet. La fiabilité de leurs trucs et astuces peut donc être mise en doute.
En outre, le public des chaînes YouTube étant extrêmement large, leurs conseils ne peuvent s’appliquer à tous. Et ce n’est pas certaines abonnées d’EnjoyPhoenix qui diront le contraire. La youtubeuse star, dans une vidéo de masques DIY (“do it yourself”), conseille d’essayer un masque à base de cannelle et de miel qui donne une peau « toute belle, légèrement rosée parce qu’elle a pris des couleurs ». Comme l’explique un article publié sur marieclaire.fr le 20 octobre dernier à ce sujet, la cannelle est « une plante dermocaustique (qui entraîne des brûlures) et très allergisante ». Ainsi, certaines abonnées ont eu la sympathique surprise de retrouver leur visage brûlé après l’utilisation du masque. Bien sûr, l’erreur est humaine, mais lorsque l’on se porte garant devant des millions de personnes des vertus d’une recette, et que l’on a autant d’impact sur des millions de jeunes filles qu’EnjoyPhoenix, l’erreur prend une toute autre dimension. Si les youtubeuses se veulent professionnelles, elles doivent prendre les responsabilités qui accompagnent ce changement de statut.
Tous les conseils sont-ils bons à prendre ?
L’exemple est encore plus frappant dans le cas de Kelly Angelini, alias KayEhHey. Dans une vidéo sortie début décembre 2015, elle donnait des conseils concernant la première fois. Elle insistait sur l’importance de la tenue vestimentaire et du maquillage, ainsi que sur la nécessité de s’épiler pour « ne pas dégoûter son partenaire » et de se laver le sexe plusieurs fois « par respect». Une fois passés ces conseils misogynes, qui véhiculent une conception arriérée de la femme, la youtubeuse renchérit. Elle explique, en effet, qu’il faut parfois se faire violence et se forcer un peu pour sa première fois, car après tout, « tout le monde est passé par là ».
La vidéo a rapidement été supprimée par son auteure . Néanmoins, ces propos ne sont pas passés inaperçus auprès des internautes. Clarence Edgard-Rosa, blogueuse et journaliste féministe, conclut ainsi un article à propos de cette vidéo sur son blog pouletrotique.com: « Son ignorance crasse n’empêche en rien Kelly de se sentir légitime à distiller ses conseils à ses près de 250.000 abonnés, et grâce à YouTube, elle sera rémunérée pour ça. Récompensée financièrement pour avoir expliqué à des jeunes filles que le plus important dans une première relation sexuelle avec un garçon, c’est de se forcer un peu, de ne pas porter un décolleté trop plongeant et de se récurer l’entre-jambes par respect pour les garçons. J’oscille entre honte et colère. Je vais prendre les deux. » Comme le précise une rédactrice du site blastingnews.com, le public de ces youtubeuses est généralement un public jeune, manquant de confiance en soi et de repères. Ces jeunes accordent donc un grand intérêt au discours de leur youtubeuse favorite et dès lors, ces paroles deviennent un réel enjeu. Les propos de Kelly Angelini peuvent être nuisibles, en particulier pour les jeunes âmes qui parcourent YouTube à la recherche de conseils et de réconfort.
Ces exemples de dérapage made in YouTube nous montrent bien que ce média social soulève de nouveaux débats, notamment en ce qui concerne l’amateurisme sur Internet. L’importance accordée aux youtubeuses beauté, à la fois sur Internet et dans les médias dits traditionnels, ainsi que la professionnalisation entraînée par cette médiatisation nécessitent donc une réelle remise en question. Néanmoins, il semble clair que les youtubeuses beauté ont désormais une place prépondérante dans la consommation médiatique des jeunes publics, interrogeant également le futur des sacrosaints magazines féminins.
Clémence de Lampugnani
LinkedIn
Sources:
Marie-Claire, « POURQUOI ENJOYPHOENIX FAIT-ELLE LE BAD BUZZ SUR LA TOILE ? » de Lola Talik
L’obs, « Première fois: une YouTubeuse conseille aux filles de se forcer. Une honte » de Audrey Kucinskas
Blasting news, « YOUTUBEUSE BEAUTÉ: RÉEL MÉTIER, EFFET DE MODE OU VÉRITABLE STAR MODERNE? » par Lilylaura Devillers
« Le pouvoir des Youtubeuses beauté » par Magali Heberard
Crédits photos:
Joel Saget / AFP
Capture d’écran Youtube d’une vidéo de Michelle Phan
capture d’écran YouTube d’une vidéo d’EnjoyPhoenix
apture d’écran YouTube vidéo de KayEhHey alias Kelly Angelini
Twitter