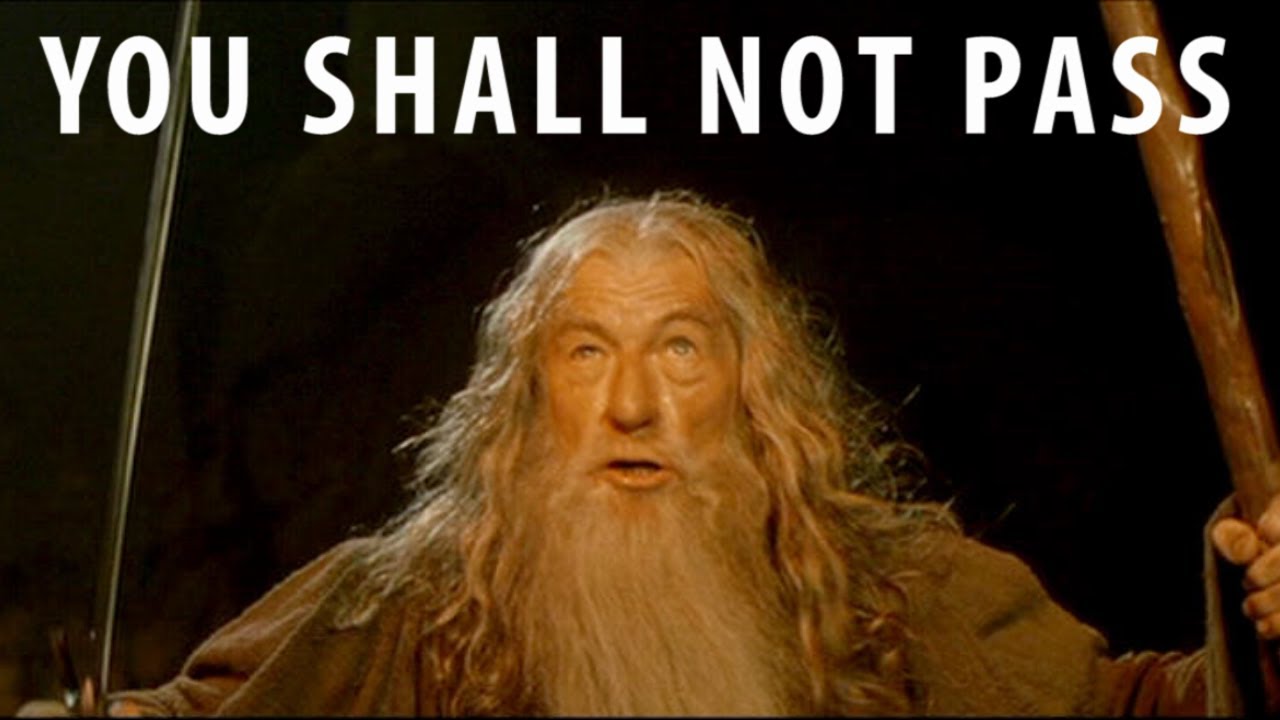Papotons du vapotage
Qui parmi vous n’a pas encore croisé les nouveaux adeptes de la cigarette électronique ? On les trouve partout, en pause avec leurs collègues, à la terrasse des cafés ou même dans les centres commerciaux. Ces néo-fumeurs arborent fièrement leur accessoire fétiche accroché autour du cou, aspirant avec cette touche tellement « chic » à une santé (qu’ils espèrent) meilleure. En effet, si la cigarette électronique représente une alternative intéressante pour tout fumeur qui souhaiterait diminuer sa consommation, voire arrêter de fumer, il n’en reste pas moins que les professionnels du secteur ont mis en place une stratégie marketing bien pensée pour faire de cette promesse de santé un argument commercial.
Chaque jour nous sommes témoins des nouvelles méthodes marketing mises en place par les industriels pour continuer à améliorer leurs ventes dans le secteur ; des ventes qui se portent déjà fort bien.
En effet, d’après les représentants de la Fivape (Fédération interprofessionnelle de la vape) sur 16 millions de fumeurs, 2,5 utilisent régulièrement la cigarette électronique. Inversement, les ventes de tabac dites « classiques » accusent un net recul (8,6% en août sur douze mois pour les cigarettes selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies).
Comme le disait Jean Jaurès : « Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots ». En effet, pour souligner le caractère inoffensif de la cigarette électronique, les publicitaires ont inventé une nouvelle formule magique : qui parle de fumer ? Parlons plutôt de vapoter.
Quels sont les arguments des publicitaires ?
Afin de toucher le potentiel consommateur, la publicité « pédagogique » continue de suivre l’adage « faire comprendre pour faire accepter ». Alors qu’aujourd’hui personne n’est en mesure de prouver (ou non) la dangerosité de la e-cigarette, les publicitaires jouent la carte santé en faisant valoir à leurs consommateurs les avantages de la version électronique. Pourtant, ils ne manquent pas d’autres arguments vendeurs : la cigarette électronique coûterait moins cher à long terme, serait moins désagréable pour les voisins, et elle serait autorisée dans la plupart des lieux publics…
Pour ces cigarettiers, elle serait aussi un excellent moyen d’arriver à stopper définitivement sa consommation de tabac : cependant il semble que, paradoxalement, tout soit fait pour maintenir le fumeur captif : le design, les parfums, et l’assurance de pouvoir continuer à fumer tout en restant en bonne santé… Les lobbys industriels continuent de faire pression afin que nous puissions vapoter l’âme tranquille.
Comment se diffuse cette nouvelle tendance ?
Malgré l’engagement de la Ministre de la Santé Marisol Touraine en faveur de l’interdiction de la publicité autour des cigarettes électroniques, concrètement leur vente n’est interdite qu’aux mineurs. Les publicitaires bénéficient aujourd’hui d’un vide juridique dont ils profitent pour investir ce créneau nouveau avec des méthodes similaires à celles qui avaient été appliquées par le marketing à ses débuts dans la vente de cigarettes classiques.
Que voit-on dans ces publicités ?
De jolies femmes, du glamour, de la classe… Oui, les publicitaires jouent exactement sur les mêmes leviers de persuasion pour influencer leurs cibles, que les anciennes réclames. L’accent est mis sur la gestuelle des fumeurs, une dépendance aussi importante que la nicotine en elle-même. En réaction à ces nouvelles publicités, l’office de la prévention du Tabac (OFT) a saisi le CSA et l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) afin de limiter voir de mettre fin à leur diffusion.
Le public visé par ces publicités se veut le plus large possible : un maximum de sensualité et d’élégance pour le public féminin, de la virilité pour les hommes, tout le monde en a pour son compte. Cependant, un soin tout particulier est apporté pour que n’apparaisse jamais clairement le caractère addictif etpotentiellement dangereux de ces produits. Puisqu’aucune certification n’a été à ce jour mise en place, on en profite pour susciter le désir de la façon la plus discrète possible…
Choisirez-vous la saveur rhum, vanille ou cola ?
La création de ces publicités finit par nous interroger sur leur réception par le jeune public. Tout cela n’inciterait-il pas à goûter à la e-cigarette, non par volonté de sevrage, mais par simple curiosité ? Ces belles couleurs sont en effet bien tentantes pour le jeune public adepte de nouveautés et de goûts exotiques. Il existe des centaines de modèles de goûts différents, certains d’entre eux clairement orientés vers une cible jeune ou féminine. La cigarette électronique, plus qu’une alternative à la « clope », c’est aussi un gadget social et identitaire séduisant.
Branche ton e-pipe sur l’allume cigare !
Pour finir, la diversification de ces objets électroniques fait apparaîtrede curieuses nouveautés : il existe désormais le e-narguilé, le e-cigare, la e-pipe, et même le e-joint ! Avec la montée en puissance de ce secteur en pleine croissance, l’influence des lobbyistes industriels et la puissance de persuasion de ces publicités, il n’est pas sûr que les politiques de santé publiques puissent arriver à rendre les fumeurs moins accros…
Lucie Jeudy
Sources :
youtube.com
liberation.fr
fivape.org
CASH investigation, la grande manipulation de l’industrie du tabac
Crédits photos :
like-cigarette.fr