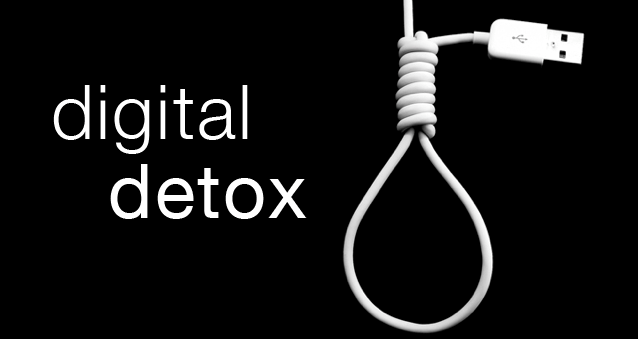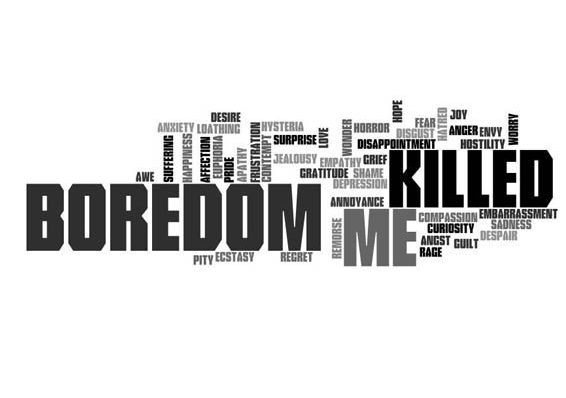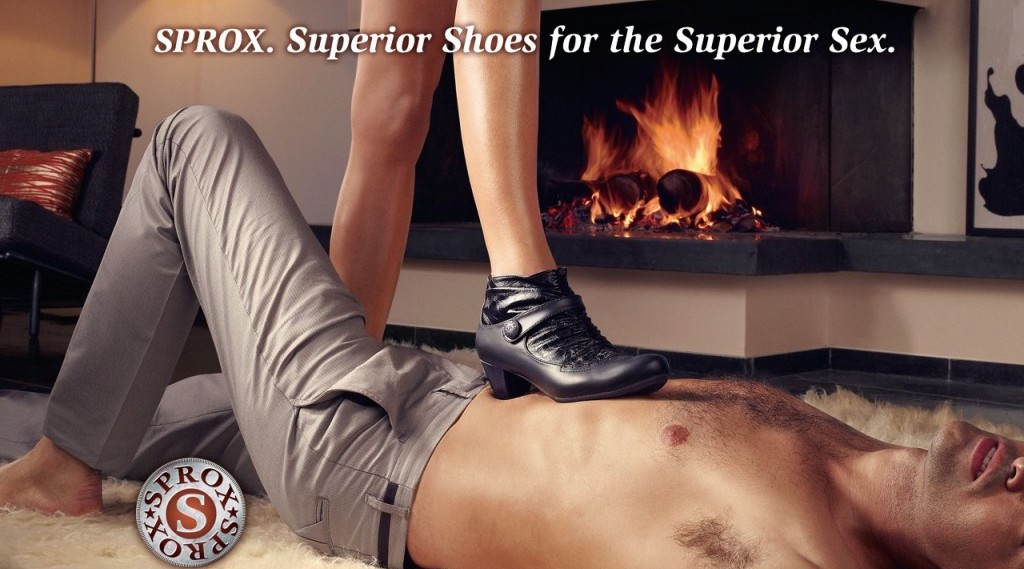Welcome to New York : une histoire Kahnoise
Pendant que certains festoient la fin du Festival et la remise de la Palme d’or à Nuri Bilge Ceylan et que d’autres quittent la croisette les mains vides, déçus de ne pas avoir su trouver leur place au palmarès, il y en a qui s’en vont avec le sourire. Sont-ils satisfaits des résultats de la présentation de leur long-métrage dans la compétition ? Non… Leur film ne faisait même pas partie de la sélection, il ne sortira d’ailleurs pas au cinéma. Et pourtant, producteurs et distributeur rentrent ravis. Pari réussi.
Le buzz, entretenu depuis longtemps, était savamment orchestré autour d’un dispositif communicationnel colossal. Welcome to New York, on peut le dire, fait office d’OVNI dans le paysage cinématographique actuel – une belle occasion pour revenir sur une opération marketing sans précédent, empreinte d’un nouveau commencement dans la législation du circuit de diffusion des films en France.
Trois festivals de Cannes, trois coups de buzz
Il y a trois ans, pendant qu’Amour remportait la Palme d’or, l’affaire DSK éclatait au grand jour, donnant à Wild Bunch une bonne idée pour s’en mettre plein les poches. En quelques jours seulement, Cannes est pris d’assaut par des rumeurs indiquant le commencement de l’écriture d’un scénario s’inspirant de l’affaire.
L’année suivante, en plein tournage du film, la croisette est cette fois-ci marquée par la fuite mystérieuse d’une bande-annonce de travail. Le distributeur se défend alors d’avoir instrumenté une quelconque opération marketing, déclarant que le chef-opérateur du film ignorait tout simplement que ces images étaient confidentielles. On y croit vraiment ?
C’est toutefois cette année que le distributeur a eu l’idée de génie : présenter le long-métrage pendant le festival et sur place, sans y être invité. Le film a en effet été donné à voir en avant-première mondiale dans un cinéma de quartier, s’attirant facilement la médiatisation environnante et l’impact qui s’en suit.
Entre raisons officielles et officieuses…
L’œuvre bénéficie d’une sortie pour le moins atypique et qui demeure, aujourd’hui encore, assez obscure. En effet, Wild Bunch a délibérément fait le choix de priver Welcome to New York d’une sortie en salles en le reléguant à un direct-to-VOD. Généralement, ceci est réservé aux films ayant un très faible potentiel de succès. Ici, ce n’est pas le cas : s’inspirant d’un des scandales les plus médiatisés de cette décennie, réalisé par un réalisateur de renon, Abel Ferrara, et avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, Welcome to New York avait tout pour attiser la curiosité.
Le distributeur déclare avoir pris cette décision en raison de plusieurs facteurs bancals. Premièrement, avec une intrigue de cette envergure, Wild Bunch dit craindre qu’une sortie en salles n’accroisse le piratage massif du film. À ce premier argument, il suffit d’objecter que la VOD facilite la piraterie, et dans une qualité supérieure – notons que le film est disponible sur les plateformes de téléchargement illégal depuis le lendemain de sa sortie, le tout en haute définition. Puis, c’est la campagne de promotion onéreuse pour une exploitation du film en salles qui aurait posé problème au distributeur. Pourtant, qui n’a pas vu ces immenses panneaux publicitaires ventant la sortie du film ? La communication autour de Welcome to New York s’est révélée tout aussi chère que celle d’un long-métrage lambda, à la différence qu’une telle dépense n’avait jamais été organisée pour une sortie en VOD.
Il semblerait donc qu’officieusement, le distributeur ait craint que les inévitables poursuites judiciaires ne nuisent à la sortie du film, qui aurait pu être censuré s’il était sorti en salles. En effet, le direct-to-VOD présente l’avantage d’exposer un film sans que quiconque ne puisse le voir avant sa sortie. Ainsi, personne n’a été en mesure de porter plainte avant le 17 mai ; et si une plainte est déposée, cela n’affectera désormais pas le distributeur : le film est d’ores-et-déjà disponible et regardé. « S’ils veulent nous faire de la publicité, ils sont les bienvenus », déclare ironiquement Vincent Maraval, producteur.
Vers une mutation de la distribution cinématographique ?
À l’heure où de nombreux cinémas ferment leurs portes, l’alternative d’une sortie en VOD est alléchante pour les sociétés de distribution. Wild Bunch, en misant sur ce film en tant que test, a pu vérifier si ce modèle économique était viable et a cherché à répondre à une interrogation pour le moins terrifiante : un film attendu peut-il se délester d’une sortie en salles coûteuse sans que les profits n’en soient minorés ?
Malheureusement, le succès de Welcome to New York semble concluant, même s’il faut souligner que l’ampleur du projet en fait un cas à part : 48 000 locations ont été recensées en moins d’une journée, « un chiffre énorme », assure Wild Bunch. Si l’on est encore loin de la cessation de l’activité des cinémas en France, il n’empêche que le succès de cette opération remet en question la chronologie des médias telle qu’elle est appliquée. En effet, le délai de quatre mois entre la sortie d’un film en salles et son exploitation sur d’autres supports (DVD, Blu-Ray ou VOD) paraît désormais obsolète car décidée à une époque où le numérique était inexistant.
En définitive, si l’on attend avec impatience les procès palpitants de DSK et de ses comparses, il ne devrait plus manquer beaucoup de temps avant que cette rigidité législative ne soit amendée, faisant entrer le monde de la distribution cinématographique dans une nouvelle ère.
David Da Costa
Sources:
Franceculture.fr
Ecran Total : le quotidien des professionnels de tous les écrans, n°2260, jeudi 15 mai 2014.
LeMonde.fr
Crédits Photos :
Propriété de Wild Bunch.