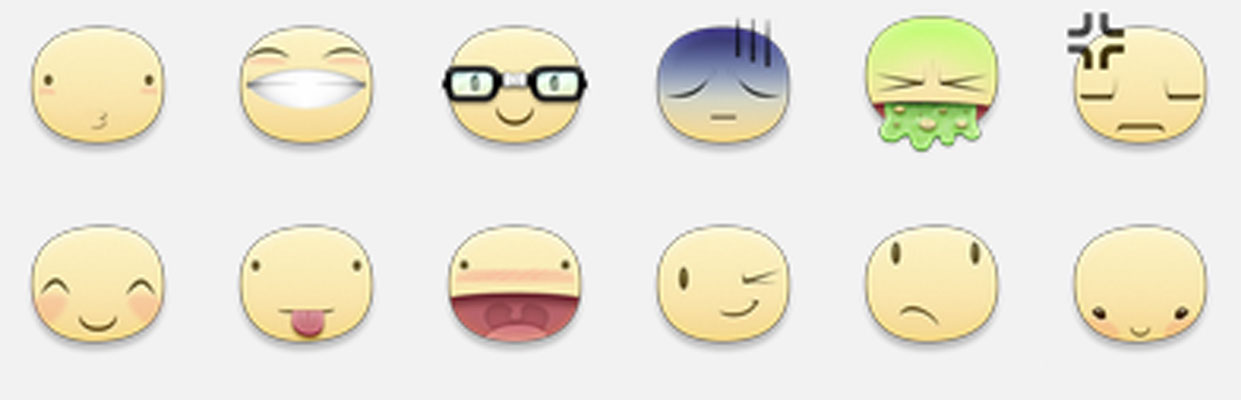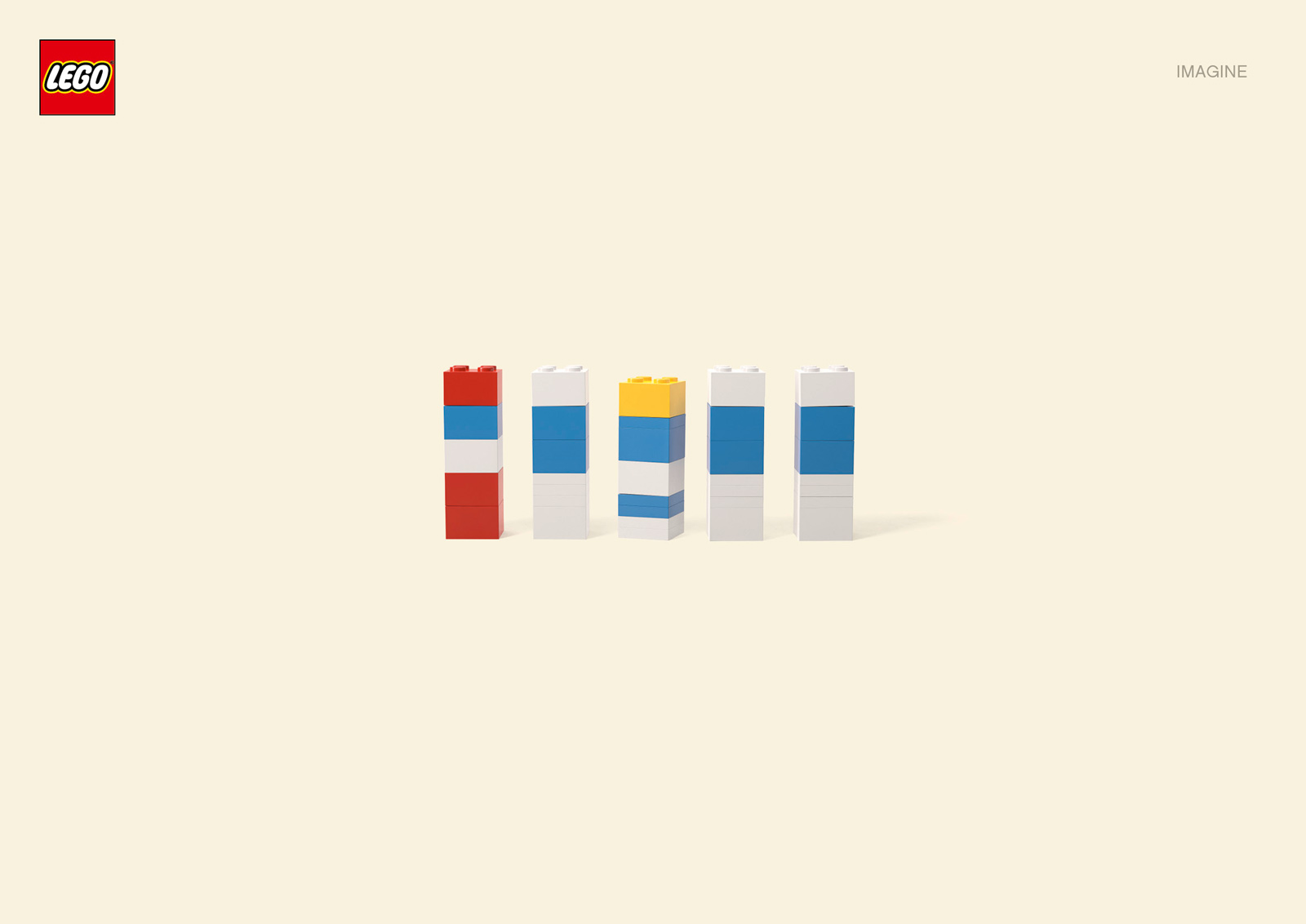Publicité et marketing : la parole aux enfants
De la figure attendrissante du petit garçon et de Maurice son poisson rouge dans la publicité de Nestlé, à celle où le fiston vente la simplicité de la nouvelle voiture électrique de Renault, on ne compte plus les publicités dans lesquelles l’enfant joue un rôle central. Cependant, le statut d’enfant-acteur dans la publicité évolue avec son époque. Ces derniers temps, il semble qu’une légère tendance se dessine : les « publicités expérimentales ». En mettant en scène des témoignages d’enfants, elles soulèvent en creux des questions de société. Des questions sur lesquelles les enfants sembleraient avoir leur mot à vendre… euh, à dire.
Une expérience sociale à caractère scientifique
Interroger les enfants sur l’expérience qu’ils ont d’un produit, l’idée n’est pas révolutionnaire. Il suffit pour le constater d’aller voir du côté de la célèbre marque de petites briques de construction Lego, qui se définit comme un « prestataire d’expériences de jeu » (« provider of play experiences »). Mais en 2014, Lego bouleverse le statut de l’enfant dans la publicité en lançant une campagne d’un nouveau genre : « l’expérience créative ». Cette expérimentation joue sur la mystique de l’épanouissement par le jeu, en nous dévoilant l’envers du décor : par-delà la brique, l’expérience du jeu.
Le principe est simple : plusieurs enfants, entre 6 et 11 ans, sont interviewés chacun leur tour sur leur expérience des Lego. L’expérience consiste alors à démontrer aux mamans que le rapport des enfants aux Lego dépasse toute la profondeur de l’imaginaire créé par l’enfant autour de la brique.
Le cadre de l’expérience et la manière dont elle est filmée révèlent la volonté de dépeindre le caractère sérieux, expérimental et presque scientifique de l’expérience : fond neutre, atmosphère lumineuse, peu de mouvement, plans caméras alternés entre le visage et le corps … Par ces procédés, la marque cherche à prendre le spectateur à témoin et à le persuader de l’authenticité et de la conformité de l’expérience, comme le faisaient les scientifiques au XVIIème siècle. Le spectateur est incité à dépasser la matérialité du jeu pour le voir comme une expérience personnelle constructive, en combattant les a priori des mères – et seulement des mères – jusqu’alors « prisonnières de la brique ».
Quand la publicité fait de la télé-réalité
Plus récemment, le concept d’expérience dans la publicité a franchi une nouvelle étape. Alors que dans le cas de Lego, l’enfant révélait au spectateur les dessous de son expérience de jeu dans une démarche plutôt scientifique, on voit désormais défiler sur nos écrans des publicités dans lesquelles ce ne sont plus des pratiques qui sont en jeu, mais une certaine conception de la société, un point de vue sur des problématiques actuelles. C’est le choix de la publicité aux 10 millions de vues sur YouTube de la marque d’hygiène féminine Always. Dans une interview, Laureen Greenfield, réalisatrice du spot publicitaire « Like a girl », récompensé aux 67ème Emmy Award dans la catégorie « Oustanding Commercial », définit clairement son projet comme une « expérience sociale », une appellation qui fait écho au principe originel de la télé-réalité.
A la volonté de donner une dimension scientifique à l’expérience s’ajoute la prétention de la publicité à devenir un vecteur de prise de conscience et d’évolution sociétale. En dénonçant les représentations de la femme comme une figure de faiblesse et de fragilité, la marque fait le pari de mettre encore plus à distance le produit matériel afin de souligner davantage les valeurs véhiculées par la marque et son engagement social. Dans la continuité de cette publicité, la période de Noël a notamment vu les Magasins U s’emparer à leur tour de la délicate question du genre en utilisant le même principe d’expérience sociale qui met à bas les stéréotypes sociétaux.
L’imaginaire de l’enfant dans les « publicités expérimentales »
Les propos de Monique Dagnaud, ex-directrice du CSA et actuelle directrice de recherche émérite au CNRS, apparaissent de nos jours difficilement contestables : « la publicité s’adresse directement à l’enfant, en fait un héros avec un comportement d’adulte, souvent plus impertinent et astucieux que ses parents ». Les spots publicitaires mettant en place de telles « expériences sociales » redéfinissent le statut de l’enfant dans la publicité. L’enfant est « surprenant de créativité » et de transcendance avec Lego, il prend conscience des stéréotypes sociétaux et en révèle les enjeux à ses parents avec Always, il éveille les mentalités et est vecteur d’évolution sociale avec les Magasins U.
Dans ces « publicités expérimentales », l’enfant ne joue plus seulement à l’adulte : il affirme son individualité et affiche des positions claires. De telles stratégies publicitaires font ressurgir l’imaginaire quelque peu oublié de l’enfant comme figure d’une innocence ponctuée de vérité.
Ces publicités ont majoritairement fait parler d’elles sur le contenu. Et c’est aussi cela leur force : pour atteindre leurs objectifs d’audience, elles réussissent à faire oublier leur nature commerciale en s’immisçant dans les conversations quotidiennes de fond.
A l’image de la publicité d’Always qui matérialise par des cubes les « cadres instituants » (Emmanüel Souchier) de la société pour mieux les détruire, il convient de mettre au jour les « cadres instituants » de ces publicités, qui, sous couvert d’une cause sociale de leur temps, utilisent la fibre émotionnelle et réveillent l’imaginaire de l’enfant comme figure de vérité, au service d’un objectif purement marketing.
Fiona Todeschini
@FionaTodeschini
Sources :
⁃ Lego – http://www.lego.com/fr-fr/aboutus/responsibility
⁃ Emmanuël Souchier (2012). La mémoire de l’oubli : éloge de l’aliénation Pour une poétique de « l’infra-ordinaire ». Communication & langages, 2012, pp 3-19 doi:10.4074/S0336150012002013
⁃ Emmy Awards – http://www.emmys.com/awards/nominees-winners/2015/outstanding-commercial
⁃ Interview Laureen Greenfield (« Like a girl ») – https://www.youtube.com/watch?v=u2wqxiq1nD8
⁃ CNRS – http://cems.ehess.fr/index.php?2639
Crédits images :
– Capture d’écran de la vidéo LEGO – https://www.youtube.com/watch?v=pA_CZ7baFLw