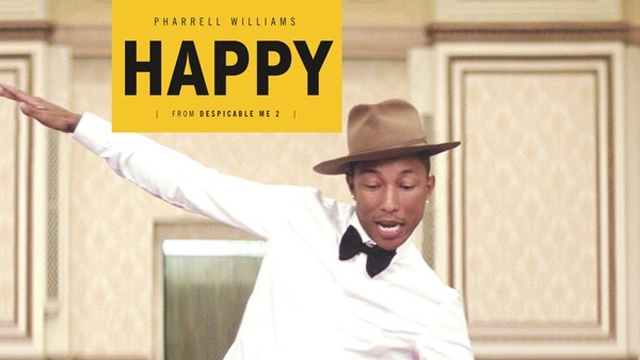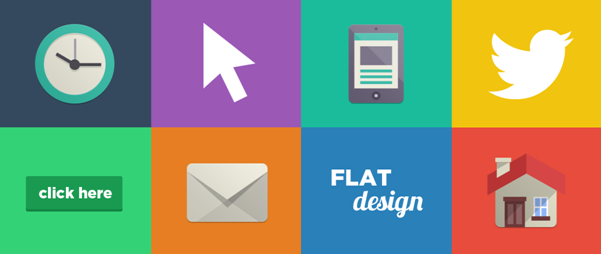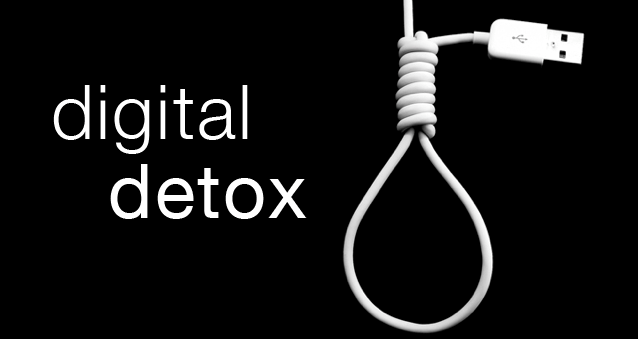Seriez-vous prêts à payer avec le PWYW ?
Depuis plusieurs années on assiste à une transformation de l’attitude du consommateur. Force est de constater que ce dernier rejette de plus en plus la passivité qui lui a longtemps été attribuée. La tendance est en effet à une émancipation croissante du consommateur vis à vis des opérations de marketing en se rendant maître de ce qu’il consomme et de l’argent qu’il dépense.
Il se dessine aujourd’hui devant nous un sujet qui décide de la publicité qu’il souhaite voir sur les écrans − comme nous en avons eu l’exemple avec la marque Nespresso et le sexy George Clooney − un sujet qui décide de quand il veut regarder son programme télévisuel préféré, avec le service de TV à la demande, et même un sujet qui décide du prix qu’il souhaite dépenser pour un produit proposé.
Cette dernière évolution s’exprime dans le « pay what you want » (payez ce que vous voulez), ou le PWYW pour les plus initiés. C’est un système de prix participatif au sein duquel l’offrant n’impose plus un prix fixe pour le produit qu’il propose, mais laisse le consommateur en décider lui-même, générant ainsi une implication exclusive de ce dernier dans la chaîne de valeur.
D’où vient cette tendance ?
C’est le groupe Radiohead qui, en 2007, a initié cette tendance en proposant à ses fans de payer ce qu’ils souhaitaient pour le téléchargement de leur nouvel album « In Rainbows ». Si l’objectif affiché était de se libérer de l’emprise des maisons de disque, il n’en est pas moins vrai qu’ils ont créé le buzz et donc transformé l’évènement en une opération de marketing. En effet, si la majorité des personnes ont téléchargé l’album pour un euro seulement, 40% d’entre elles ont tout de même décidé d’y consacrer 8 euros. L’opération peut sembler ne pas avoir été profitable sur le plan commercial, pourtant presque la moitié des acheteurs ont reconnu la valeur marchande du produit alors qu’on leur laissait le choix de ne rien dépenser du tout.
Depuis, ce système a prospéré dans le monde de la musique et s’est étendu à d’autres domaines marchands tels que la restauration, l’hôtellerie, le tourisme et même la vente en ligne.
Ainsi, cet été, à Paris, cinq hôtels, dont certains étoilés, ont lancé une opération similaire sur une durée d’une vingtaine de jours. Et ça a marché ! Les clients ont dans l’ensemble joué le jeu en payant un prix avoisinant celui habituellement appliqué par les établissements.
Un modèle qui marche quand le lien social est plus fort
En revanche, en 2009, Brandalley, le célèbre site de vente de vêtements en ligne, avait proposé, sous le slogan « rendons le pouvoir d’achat aux français », plus de dix mille articles vendus au prix proposé par les cyberacheteurs eux-mêmes. Malheureusement pour le site, 85% de ces derniers n’ont payé qu’entre 1 et 2 euros, sans tenir compte du prix recommandé par le site, ce qui avait poussé l’e-commerçant à déclarer qu’il regrettait « l’instinct d’appropriation pur et simple [des consommateurs]» et que pour eux l’opération « payez- ce-que-vous-voulez [serait] la dernière ».
Le problème, dans ce cas-là, est bien que le consommateur paie « what he wants » et non « what he thinks is fair ». La nuance, si elle est mince, se doit d’être relevée. On remarque ainsi que l’opération est beaucoup plus concluante dans des domaines qui impliquent un rapport direct entre l’offrant et l’acheteur. Il semblerait que le lien social ait un impact sur l’attitude du consommateur et sur son éthique, élément indispensable à la viabilité de ce système. Le consommateur ne jouerait le jeu que lorsqu’il se trouverait en face de la personne offrante, ou, mieux encore, en face de la main créatrice qui a façonné le produit proposé (un concert, un hôtel, un repas…). L’expérience hôtelière menée à Paris cet été le prouve.
Le PWYW, un idéal ? …
Le PWYW serait-il un système idéal qui révolutionnerait la relation existant entre le consommateur, le produit et l’offrant ? Au vu des expériences citées précédemment, ne devrait-on pas doubler le PWYW d’une action d’éducation du consommateur à la valeur marchande des produits qu’on lui propose pour que ce système soit viable ? Ou devrait-on plutôt le transformer en un système où chacun paie ce qu’il peut payer, et non plus ce qu’il veut payer ? Dans ce dernier cas de figure, l’avancée vers l’autonomisation du consommateur en serait atténuée. En effet ce dernier y perdrait son pouvoir de décision puisque l’effort consenti dépendrait de ses moyens financiers et non plus d’une volonté personnelle.
… Ou une réalité beaucoup plus terre à terre ?
Cependant il faut bien l’admettre, plus qu’un idéal, l’idée du PWYW est une utopie. Ce système est proposé par les offrants non pas avec l’intention de le maintenir durablement, mais plutôt dans l’optique de fidéliser le client par des opérations ponctuelles et accrocheuses.
Ainsi, la société Brandalley qui avait pourtant annoncé ne plus vouloir reconduire l’opération a, contre toute attente, décidé de la renouveler les 13,14, 15 et 16 novembre prochains, mais en fixant cette fois un prix minimum d’achat et un nombre maximum de produits achetés. Si en 2009, l’opération n’a pas été rentable sur le plan financier, elle l’a bien été sur le plan du marketing : le site a pu accueillir 10.000 nouveaux adhérents et donc 10.000 nouvelles cibles publicitaires. Cette opération marketing n’est pourtant pas assumée publiquement puisque dans ses déclarations le e-commerçant assurait « vouloir avant tout faire plaisir à ses clients ».
En effet, plus qu’une nouvelle façon de consommer, le PWYW est une nouvelle façon de concevoir une action de marketing : le consommateur se laisse attirer par des manœuvres accrocheuses qui ont pour seul but de fidéliser les clients ou d’en attirer de nouveau. Ce système serait alors la version moderne de la carte de fidélité.
Valentine Cuzin
Sources :
influencia.net
lesechos.fr
ladepeche.fr
Crédits photos :
spinnakr.com
eil.com
lesbonsplansdenaima.fr