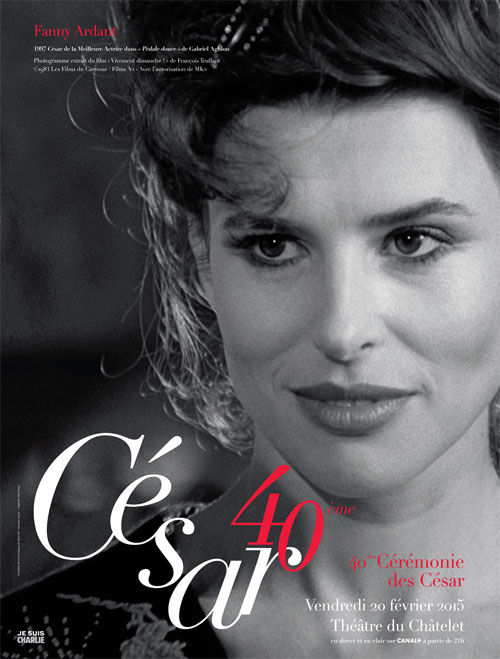Le football est-il ballonné ?
Nous avons tous plus ou moins entendu parler du scandale qui depuis mai, règne sur le monde du football. En effet, depuis l’arrestation pour corruption de sept de ses dirigeants par la justice américaine, la FIFA fait face à un sacré tourbillon. Mais de QUOI est-il vraiment question ?
Le mythe face à la réalité
Oui, le foot, ce sport qui transcende les Hommes au delà des frontières, qui rassemble autant qu’il divise. Principale cause de prise de poids grâce au trio traditionnel “bière-canapé-match à la tv”, mais également principale cause de divorce au XXIe siècle. Oui, le foot passionne, à tel point que cela en est devenu un acteur économique majeur participant à sa propre mythification. Simple nom de joueur ou Coupe du Monde, une conclusion s’impose : le football est un mythe.
De prime abord, on pourrait imaginer que le retentissement du scandale de la FIFA engendrerait la mise en péril de ce mythe et de ses représentations. La dénonciation (ou plutôt le rappel) de l’existence de la corruption et des mensonges frappe l’imaginaire commun et défie le mythe.
Mais peut-on vraiment parler de crise ? Il est vrai que ce mot devient aujourd’hui « un mot valise », utilisé à torts et à travers. Didier Heiderich, directeur de l’Observatoire International des Crises, explique que pour qu’une crise soit totale, il faut que le mythe s’effondre. Cependant, malgré le scandale de la FIFA, le monde du football connaît encore aujourd’hui une popularité sans limite.
Cette non-réaction de la part des supporters démontre les pouvoirs du mythe. En effet, ce dernier a la capacité de se protéger lui-même : on ne peut pas toucher au sacré. Par le fait même que le foot soit érigé en mythe, il ne peut être en crise totale.
Ce n’est donc pas une crise du foot mais davantage une crise institutionnelle. Or, il en ressort que la FIFA en tant qu’institution n’est pas réellement en crise. En effet, ce qui est véritablement touché, c’est le gouvernement de la FIFA. Le nom médiatique du « scandale de la FIFA » semble alors être un leurre. Le « mal de la corruption » mis en exergue dans les médias, fait écho aux personnes qui sont en charge, les décideurs. Le principal concerné au centre du scandale est Joseph Blatter (aka Sepp Blatter).
Il est nécessaire de faire un double constat :
Le foot n’est pas la FIFA.
La FIFA n’est pas ses dirigeants
La communication de crise : preuve d’un détachement de l’institution par rapport à ses dirigeants
Une communication de crise qui, dès le départ, s’est avérée confuse. Même si la réaction a été immédiate, l’ambiguïté de Blatter concernant sa responsabilité lors de sa première conférence de presse le 30 mai 2015 intrigue. Il reconnaît dans un premier temps qu’il y a une crise, mais il ne reconnaît pas sa responsabilité juridique et morale. Dès sa réélection, S. Blatter mise sur une « stratégie du complot », aussi connue sous le nom de la stratégie du projet latéral. Il contre-attaque lors de son interview à RTS (chaîne suisse) et se place en victime. Il s’en prend à la fois à l’UEFA en visant M. Platini, et aussi aux États-Unis. On voit déjà ici qu’il n’est plus réellement question de la FIFA mais surtout de lui.
On observe deux tournants dans sa communication de crise :
D’abord, sa démission. « Démissionner, ça voudrait dire que je suis fautif, or je lutte depuis 4 ans contre toute corruption » avait-il dit au moment de sa conférence de presse. Cela va être, pour l’opinion publique, un aveu de culpabilité implicite. A partir de ce moment là, il y a clairement la volonté d’une distinction entre l’homme et l’institution.
Par ailleurs, le nom médiatique se modifie subtilement, du « scandale de la FIFA » au « scandale à la FIFA ». On sous entend ici que le scandale ne concerne pas véritablement l’institution en elle même, mais encore une fois les hommes à sa tête.
Vient ensuite, sa suspension avec M. Platini.
Joseph Blatter continue de nier sa responsabilité, autant morale que juridique : « That’s the president, Blatter, he is responsible!” But I object. How can I be responsible morally for all the people? » demande t-il lors d’une interview avec le média TASS (Russian News Agency), le 28 octobre.
Sans pour autant changer de la stratégie du complot, il change de cible : les médias. Dans le même temps, il s’insurge contre M. Platini, encore et toujours.
Anecdotique en apparence, la pluie de billets qui s’est abattue sur Blatter lors de la conférence de presse du 20 juillet est lourde de sens. C’est l’apogée de l’humiliation pour l’ex-président de la FIFA. Cet incident traduit de nouveau le mépris d’un public envers le personnage de Joseph Blatter et de ce qu’il incarne : la corruption et non le foot.
Enfin, envisageons le fait qu’au lieu de vouloir inverser les rôles et de se positionner en victime, Blatter use de la stratégie de la reconnaissance. Autrement dit, admettre sa responsabilité, se remettre en cause et demander pardon. Selon Thierry Libaert, professeur en sciences de l’information et de la communication, cette stratégie de l’aveu pourrait engendrer la possibilité d’acquérir des circonstances atténuantes, voire même d’accroître son capital image.
Blatter demeure l’épicentre du scandale, néanmoins d’autres acteurs internes à la Fifa (Platini, Valcke…) viennent apporter des renversements qui élèvent ce scandale au rang de fiction médiatico-judiciaire.
Et les médias dans tout ça ?
Le rôle des médias est primordial. Dans le cas d’une crise liée au sport, son rôle prend déjà tout son sens en amont, car ce sont les médias qui participent à la mythification d’un sport et de son institution.
Joseph Blatter et ses confrères ont bien compris leur importance et le rôle qu’ils jouent dans une crise. C’est d’ailleurs un argument principal dans leur stratégie de victimisation.
En ce qui concerne l’ex-président de la Fédération, il s’en sert pour les dénoncer : « I think it was the pressure of the media. It was the pressure to get rid of the FIFA president » dans TASS, le 28 octobre.
Cette manipulation médiatique par Joseph Blatter est couronnée par une interview de sa fille, Corinne Blatter-Andenmatten dans le journal Blick. Elle insiste pour clamer son innocence et blâmer les médias qui auraient ruiné la réputation de son père : « Pourquoi s’en prennent-ils à lui? Que leur a-t-il fait? Ce n’est pas seulement de la jalousie. C’est de la haine ».
Cet échange résume particulièrement bien la stratégie de victimisation, que Thierry Libaert définit par le fait de « réduire l’intensité de la crise en recourant au registre de l’émotion et en se positionnant autour de la souffrance engendrée par l’ensemble des critiques ».
Enfin, toujours sous l’angle médiatique, lorsque l’on analyse certaines Unes de journaux sorties à la suite du scandale, on remarque encore une fois une distinction entre la FIFA et Joseph Blatter.
Tout d’abord, visuellement, par les photos qui le représentent avant de représenter la FIFA. Ensuite par les titres qui mettent en avant ce personnage et non l’institution. Ils sont crus et percutants : ils représentent le spectacle de la chute, un spectacle qui fait particulièrement vendre.
Pour le mot de la fin, on peut également dire qu’un mythe c’est aussi un personnage, un masque, un costume. Comme disait Gainsbourg : « le masque tombe, l’homme reste et le héros s’évanouit », c’est tout le souci de ce scandale : que reste-t-il de l’homme ?
Clémence Midière
Sources :
La communication de crise – Thierry Libaert
« La crise dans le sport » – Magazine de la Communication de crise et sensible (Vol.22)
« Blatter: FIFA scandal provoked by Michel Platini » – TASS (28 Octobre 2015)
« FIFA : Blatter dénonce une campagne de haine de la part de l’UEFA » – Le Monde (30 mai 2015)
« FIFA : Blatter noyé sous les dollars pendant sa conférence de presse » – Le Monde (20 juillet 2015)
« Fifa-Krimi: Tochter Corinne verteidigt Blatter » – Blick (5 octobre 2015)
Crédits images :
Le Figaro.fr
The Guardian
The Times
Bild
L’Express