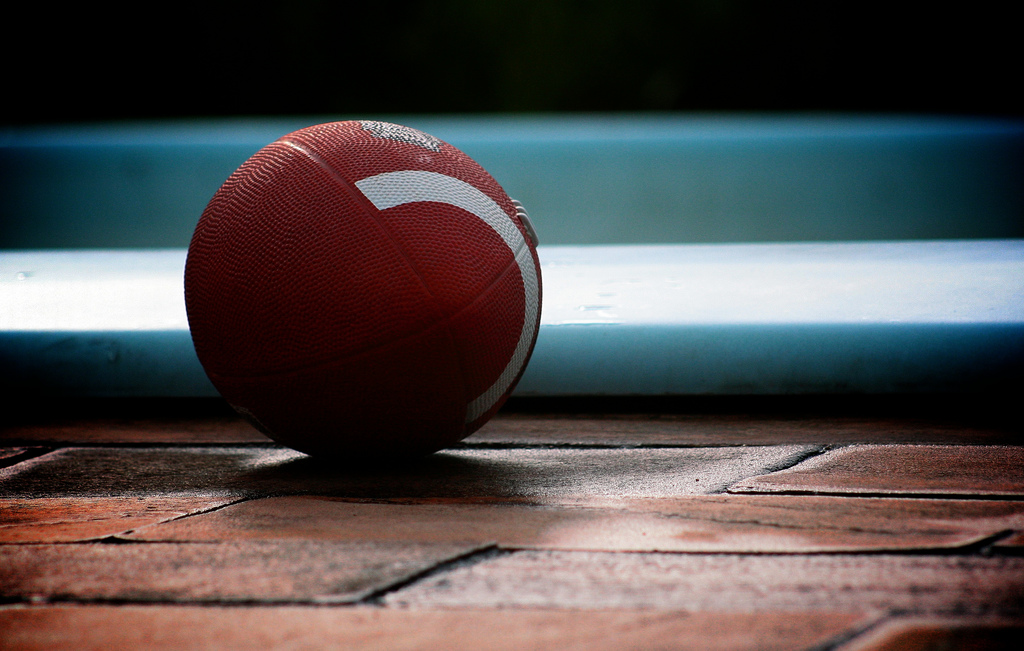Jacques a déclaré la guerre de l’internet
En vérité, plus que Jacques, c’est l’oncle Sam qui l’a dit la semaine dernière en fermant par l’intermédiaire du FBI l’un des sites de partage de fichiers les plus populaires du moment: Megaupload et son équivalent streaming, Megavidéo mais également 17 autres sites. Pour resituer un peu le contexte, cette décision s’inscrit dans le débat de deux lois américaines, PIPA et SOPA, assez controversées puisque même la Maison Blanche a annoncé qu’elle ne soutiendrait pas « une législation qui réduit la liberté d’expression, augmente les risques pour la sécurité cybernétique et sape le dynamisme et le caractère innovant de l’Internet mondial » [1]. Ce serait donc là que se situe le cœur du problème: la violation d’une liberté reconnue comme fondamentale par de nombreux pays du monde et pour laquelle certains se battent tous les jours, la liberté d’expression. On ne serait donc plus libre de communiquer de contenus comme bon nous semble.
Cette décision a évidemment provoqué un tollé parmi la communauté internaute et en particulier dans la communauté hacker. Ainsi, des membres du collectif Anonymous ont immédiatement riposté par un déni de service en rendant hors-service des sites tels que celui du ministère de la justice américain, d’Universal ou encore Hadopi qui visent à restreindre la liberté sur internet au nom de la protection du droit d’auteur. D’autres sites participatifs, tels que Wikipédia, WordPress ou Reporters sans frontières ont également réagi par une sorte de grève à cette tentative de putsh sur la toile.
La question à se poser alors est de savoir quel camp défend quoi ? En vérité, les enjeux de cette guerre du net sont bien entendu économiques. D’un côté les Etats qui interdisent de manière générale le partage gratuit d’informations ou de fichiers au nom du droit des auteurs à être rémunérés pour leur travail, et c’est bien la moindre des choses. De l’autre, il y a d’une part l’ensemble des protagonistes cités dans le paragraphe précédent, Anonymous, les sites participatifs qui se voient contraint en quelque sorte à une publication contrôlée ; et d’autre part sans doute, de nombreux internautes dont vous faites peut être parti qui ne voient pas d’un très bon œil le fait d’être privé de leurs séries télé préférées ou plus généralement de ne plus avoir accès gratuitement et en illimité à des contenus culturels.
Si l’on considère la question objectivement, l’extension de la loi au monde virtuel (une zone relative de non-droit il faut le reconnaître) n’est pas si choquante que ça. Une forme de censure y existe déjà au nom par exemple de la lutte contre la violence ou la pédophilie, allez faire un tour sur les conditions d’utilisation de Facebook. Cependant, la censure de contenu au nom de la protection du droit d’auteur est plus problématique. En effet, cela revient à dire que je n’ai pas le droit de dire, faire suivre, partager quelque chose sans en mentionner l’auteur initial et pour ce qui est des films par exemple, sans le rémunérer. Le problème ici se situe dans le fonctionnement même du web qui peut se décrire comme un média participatif auquel tout le monde contribue et où il est, de fait, souvent difficile d’établir la paternité d’un contenu sur la toile ou d’en limiter la diffusion. Pour illustrer mon propos, si on s’en tient à ce type de raisonnement dans la régulation en ligne, Facebook ou Twitter pourraient très facilement être suspendus alors même qu’ils sont tous les deux des réseaux sociaux incontournables.
En vérité, il faut effectivement trouver un moyen de protéger le droit d’auteur (chacun a droit à la reconnaissance de son travail). Pour autant, il me semble que la répression pure et dure n’est pas le moyen le plus adapté à l’heure actuelle : il s’agit davantage d’un retour en arrière qui entrave et bloque la communication parce qu’elle bloque la diffusion, l’échange et le partage de contenus. Comme je l’ai dit plus haut, le web est participatif et encourage l’émulation intellectuelle, la contribution de tous peut donc être requise. Si on considère la question du partage de films ou de musique par exemple, cela pourrait passer par une sorte de redevance culturelle, à l’image de la redevance télévisuelle, reversée aux auteurs de musique, films… En somme, un système participatif jusqu’au bout ainsi qu’on me l’a suggéré récemment (oui, je ne revendique pas la paternité de cette suggestion et, finalement, peut être que tout commence ici !)
Justine Jadaud
[1] Plus d’infos sur PIPA et SOPA
Crédits photo : ©Anonymous – ©Wikipedia