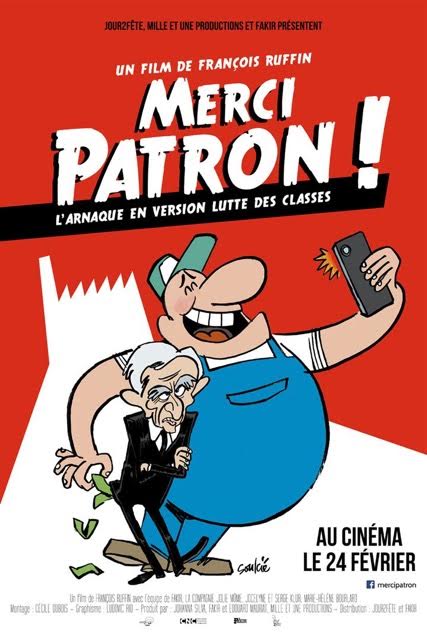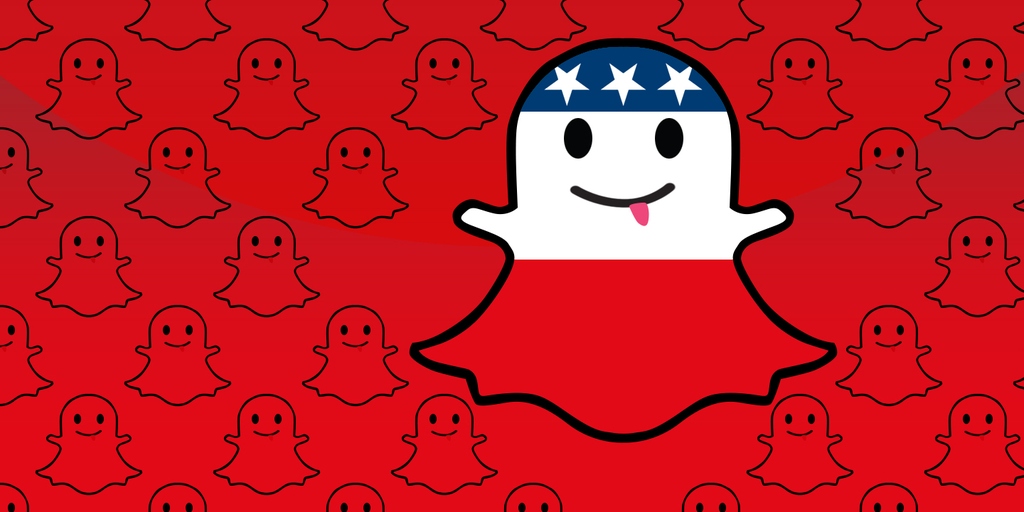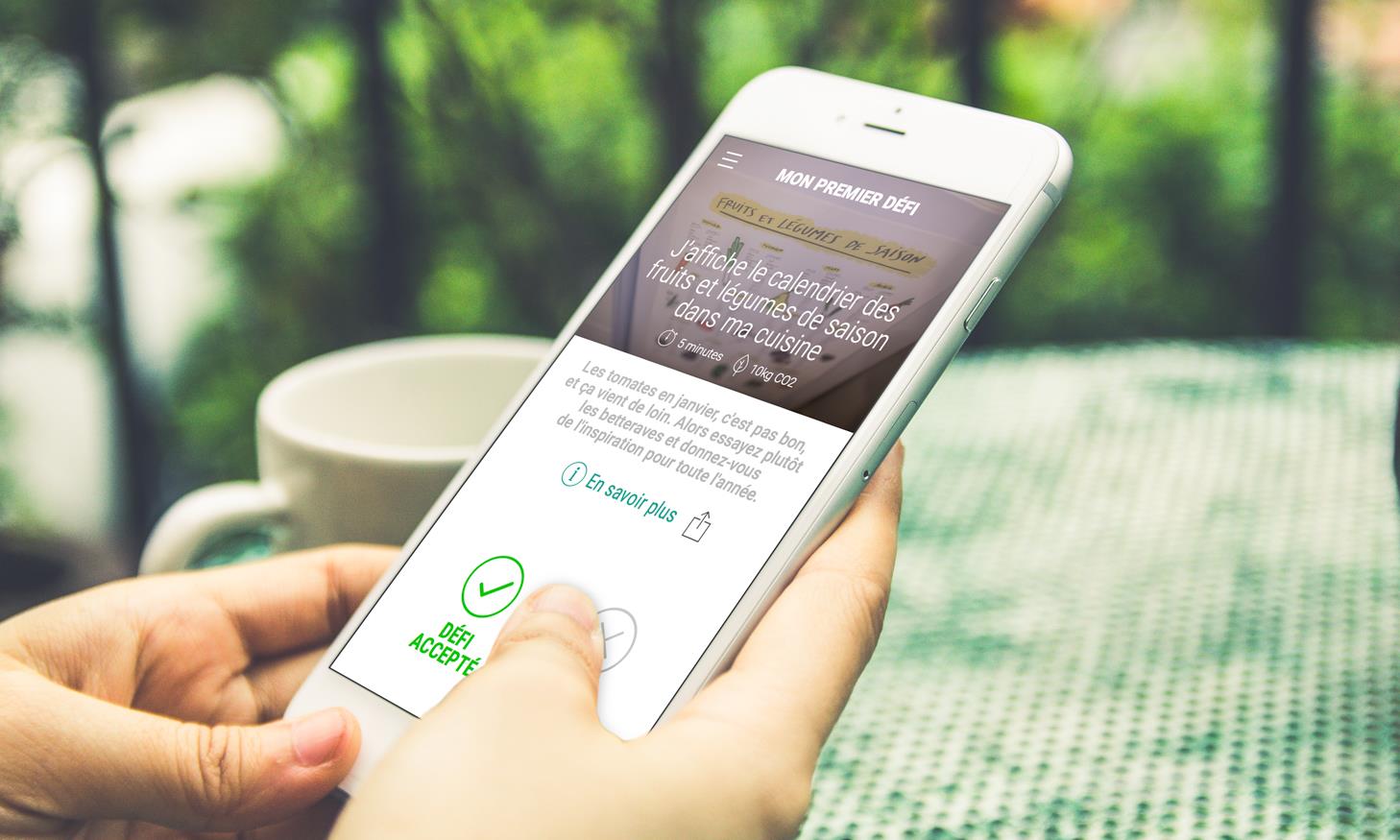Depuis le milieu des 2000, chaque campagne présidentielle américaine a eu son réseau social. Si en 2008 Barack Obama a pu accéder à la Maison Blanche, c’est notamment grâce à Facebook, avec son fameux filtre « Yes We Can » que l’on pouvait mettre sur son profil. Il semblerait que cette fois-ci la campagne présidentielle américaine sera celle de Snapchat. En effet le réseau social cartonne : il a passé en février dernier la barre des 7 milliards de vidéos vues par jour, talonnant Facebook qui en compte 8 milliards, et bien que le nombre de ses utilisateurs soit moindre (environ 200 millions contre 1,59 milliards pour Facebook), son poids auprès des jeunes est considérablement plus important que celui de la firme de Mark Zuckerberg.
Cet argument a fait mouche auprès des candidats à la présidence des États-Unis, qui aujourd’hui ont tous un compte sur Snapchat. Mais l’intérêt est partagé : le réseau social veut élargir ses fonctions en touchant au domaine de l’information. La création en janvier 2015 de Discover, service proposant des contenus interactifs d’actualité a marqué le début de sa conquête.
Cela met en lumière un double phénomène aux potentialités dangereuses. D’un côté l’ambition des médias sociaux de devenir des médias généralistes, englobants, et leur pouvoir d’attraction auprès des instances du pouvoir qui y voient une opportunité de toucher leurs cibles, n’est-elle pas en train de faire triompher le viral, l’éphémère – dont Snapchat est l’ultime forme – au détriment des idées ? De l’autre côté, cela ne dénature-t-il pas ce réseau social, basé sur le partage privé, de se faire en partie média d’information publique ? Retour sur une liaison dangereuse.
Snapchat à la conquête de la politique
En janvier 2015, Snapchat annonce l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité à son réseau social : Discover. En partenariat avec onze médias dont CNN, le Daily Mail, National Geographic, ou Vice, cette extension permet aux utilisateurs de passer de leurs partages personnels vers des contenus interactifs d’actualité ou de divertissement. Le réseau social, utilisé par plus de 60% des 18-34 ans ayant un smartphone tire ainsi profit d’une information soulignée par une étude de Sky News menée en 2015 : seuls 18% des 16-24 ans utilisent les médias traditionnels (télévision, presse papier, radio) pour s’informer – les réseaux sociaux sont leur première source d’information. Mais cela ne fait que marquer le début d’une véritable conquête du monde de l’information par Snapchat, et particulièrement de la politique.
En effet quatre mois plus tard, le journaliste politique star de CNN, Peter Hamby, devient le directeur de l’information du réseau social. Le 22 mai de la même année est publiée sur le site Greenhouse une offre d’emploi tout à fait singulière : sont recherchés des « passionnés de la politique » et « aficionados de l’actualité » avec une « expérience en journalisme » exigée, pour « raconter des histoires au sujet de la course à la présidentielle [américaine] 2016 ». La conquête du politique est plus qu’enclenchée – il ne reste qu’à séduire les candidats.
Les politiques épris de Snapchat
Pour ce faire, Snapchat dispose d’un argument de taille : elle est le réseau social favori des personnes âgées entre 15 et 30 ans. Sur l’ensemble de ses utilisateurs aux États-Unis, 40% ont entre 18 et 29 ans. Cela n’est pas négligeable lorsque l’on sait que ces jeunes représentent 36% des électeurs du pays, comme le rappelle une récente étude du Harvard’s Institute of Politics. Avec Snapchat, les politiques veulent atteindre les primo-votants, qui d’après une étude du site Fusion sont « fortement enclins à voter » en 2016 à 77%.
C’est ainsi que l’ensemble de la classe politique américaine a envahi le réseau social. Le 11 janvier 2016, la Maison Blanche a ouvert un compte sur Snapchat, avec pour objectif de « communiquer avec ce vaste segment de la population [les utilisateurs de Snapchat] de façon nouvelle et créative ». Avec un président mis à mal dans les sondages, il est surtout primordial pour l’exécutif de renouer le lien avec les jeunes Américains.
De même, tous les candidats aux primaires des partis Républicain et Démocrate ont créé leur compte, chacun avec des enjeux différents. Pour Hillary Clinton, qui a lancé son compte en avril 2015, l’objectif est de conjurer 2008. Ce sont en effet les jeunes qui avaient départagé Obama et Clinton aux primaires démocrates, notamment en Iowa. Il lui faut par conséquent avoir cette jeunesse derrière elle. Cela est d’autant plus important que 56% des personnes âgées entre 18 et 29 ans veulent un président Démocrate, et 36% un président Républicain. Son premier « snap », une photo de l’intéressée durant ses jeunes années, illustre parfaitement cet enjeu.
Mais Hillary Clinton, si elle est première dans les sondages, est moins populaire que Bernie Sanders auprès des jeunes : elle reçoit le soutien de 35% des primo-votants à la primaire démocrate, contre 41% pour le sénateur du Vermont, qui a rejoint Snapchat en novembre 2015. Elle a par conséquent décidé de jouer la carte Snapchat à fond, prenant même des « snaps » chez l’animateur vedette Jimmy Fallon.
Côté Républicain, l’objectif des candidats en se créant un compte Snapchat, outre leur autopromotion, est de contrer Donald Trump. Ce dernier est effectivement hyperactif sur Twitter, Instagram et Periscope, mais n’a pas de compte sur l’application au logo fantôme. Ted Cruz a par exemple lancé un filtre géolocalisé intitulé « Ducking Donald » – subtile parallèle entre le prénom de son meilleur ennemi et le héros de Disney – pour se moquer de la politique de la chaise vide de Donald Trump : plusieurs photos montrant des meetings où il est absent sont annotées de la question « Where is Ducking Donald ? ». Les Démocrates ont quant à eux lancé le filtre « Deport Trump » lors d’un débat au Nevada, État à la forte population hispano-américaine, en référence au plan de « déportation » (le terme n’ayant pas exactement la même connotation qu’en Français) de onze millions de sans-papiers du territoire américain.
Cette année, la politique compte sur Snapchat et inversement. Mais cela n’est-il pas risqué ?
Une liaison dangereuse des deux côtés
Cette irruption de Snapchat dans la politique américaine est problématique. Elle provoque en effet leur appauvrissement mutuel : le réseau social perd en identité, et la politique perd en pertinence.
Le réseau social, en introduisant d’abord l’actualité avec Discover puis en faisant un appel du pied aux politiques, notamment en engageant des journalistes pour couvrir la campagne, va à l’encontre de sa propre nature. L’application est au départ le vecteur de conversations privées entre amis et entre proches. Ce caractère privé se double d’une garantie de secret, symbolisée par le logo fantôme, car chaque « snap » est éphémère. En incluant du contenu informationnel et public, elle trahit l’ambition d’une application valorisée à plus de 10 milliards de dollars de devenir un média englobant, qui risque de perdre ses utilisateurs venus pour la promesse de liberté.
La politique, elle, perd avec Snapchat en pertinence. A la confrontation des idées a succédé la bataille – déjà enclenchée mais ici poussée à l’extrême – du viral, de la brièveté, et donc de l’efficace, non de l’intelligent. Preuve en est l’intense réflexion qu’il y a derrière le filtre de Ted Cruz mentionné précédemment, comparant Donald Trump à un canard en vareuse (même s’il est vrai que ce dernier ne semble pas capable non plus d’une grande hauteur de débat). Si le racolage, la séduction des « masses » par les politiques ne datent pas d’hier, ils sont avec des réseaux sociaux comme Snapchat banalisés et normalisés.
En 2016, la liaison entre Snapchat et la politique est devenue officielle. Espérons que ce ne soit pas pour le pire.
Clément Mellouet
Sources
– Soumitra Dutta & Matthew Fraser, US News, « Barack Obama and the Facebook Election”
http://www.usnews.com/opinion/articles/2008/11/19/barack-obama-and-the-facebook-election
– Harvard’s Institute of Politics, Survey of Young Americans’ Attitudes toward Politics and Public Service (2015)
http://www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new/pictures/151208_Harvard_IOP_Fall_2015_Topline.pdf
– Marion Degeorges, Les Echos, « Etats-Unis : 2016 sera la présidentielle Snapchat »
http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=021223537962&fw=1
– L’Express, « Snapchat embauche des journalistes pour couvrir les présidentielles U.S. »
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/snapchat-embauche-des-journalistes-pour-couvrir-les-presidentielles-u-s_1683379.html
– Alice Maruani, Rue89, « Le vote des jeunes Américains tient-il à une blague de cul sur Snapchat ? »
http://rue89.nouvelobs.com/2016/02/02/vote-jeunes-americains-tient-a-blague-cul-snapchat-263046
– Alice Rivoire, FastNCurious, « Snapchat lance Discover (et sa monétisation ?) »
http://fastncurious.fr/irreverences/snapchat-lance-discover-et-sa-monetisation.html/
Crédits images :
dailydot.com
thesocialclinic.com
nytimes.com
techradar.com
msnbc.com
twitter.com