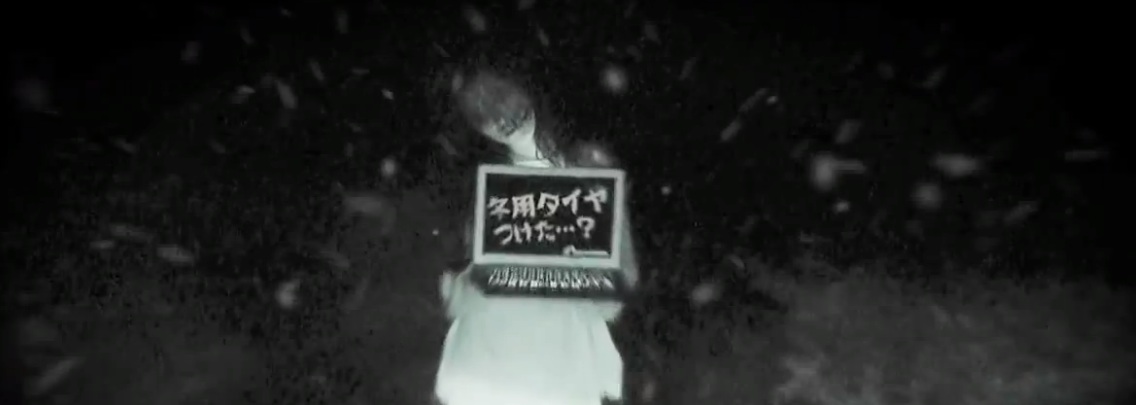L’objet Google
Depuis le début des années 2000, Google n’a cessé d’acheter des entreprises dans le but d’améliorer ou de développer ses services. Ces nombreuses acquisitions ont permis au géant américain d’être présent dans de nombreux domaines en rapport avec internet et son application web au sens large. Google est à présent un acteur majeur du monde numérique. Néanmoins, depuis quelques temps, l’esprit de Google est au réel. Le moteur de recherche veut désormais élargir son niveau de compétence en dehors du logiciel et produire de l’objet. En cela, l’achat de Nest Labs mi-janvier, troisième plus gros investissement jamais fait par Google, n’est pas anodin.
Pour le comprendre, il faut se pencher sur ce qu’est Nest Labs et saisir en quoi cette entreprise symbolise les volontés nouvelles de son acquéreur.
Nest Labs est une jeune entreprise fondée en 2010 spécialisée dans la domotique ou “maison intelligente”. Créée par deux anciens employés d’Apple, Tony Fadell et Matt Rogers, la société californienne fabrique des thermostats et détecteurs de fumée connectés qui apprennent des habitudes de leurs utilisateurs. Mais pourquoi payer 3,2 milliards de dollars pour, si l’on empreinte la formule à un lecteur du Monde, “un thermostat et une puce wifi”?
Trois raisons à cela :
1- Nest Labs est une société en expansion, dont les produits sont achetés en grande quantité dans le marché nord-américain (plus d’un million de thermostats déjà vendus selon Tony Fadell). La force de Google rendrait possible une croissance nationale et internationale facilitée ce qui permettrait à son investissement d’être tout à fait rentable à moyen terme.
2- L’équipe de Nest Labs est composée de nombreux ex-employés d’Apple. Google a acheté des compétences. Sa volonté à devenir global passe obligatoirement par la capacité à créer des objets sans avoir besoin de lier des partenariats. C’est encore le défaut de Google actuellement : la firme a du mal à produire des objets attrayants, aussi intéressante qu’en soit la technologie. Les Google Glass en sont un exemple parlant. Google a besoin de penser design, et ses dirigeants en sont conscients.
3- C’est le point le plus important : on comprend très bien l’intérêt de Google à entrer sur le marché de la domotique et à plus grande échelle dans celui des objets connectés (même si c’est déjà en partie le cas avec les Google Glass). L’objectif principal étant évidemment de ne pas rater la prochaine vague technologique, voire de devancer ses concurrents directs. On pensera par exemple à Apple qui, avec l’IPhone et IOS, avait forcé Google à jouer les rattrapages et à proposer Androïd gratuitement. Ici, Google veut se placer en premier sur le marché. Le but étant, on le devine, de fournir un système complet, de relier tous ses anciens services et terminaux aux nouveaux afin de maximiser l’écosystème Google auprès de l’utilisateur.
Car c’est là tout l’enjeu de ce nouveau marché pour les entreprises de services web. Si l’utopie des objets connectés parlant directement entre eux a peu à peu été abandonnée, la capacité des objets parlants entre eux par l’intermédiaire d’un opérateur web devient bien réelle. Et c’est là que Google pourrait tirer remarquablement son épingle du jeu. Dans l’hypothèse non pas d’un internet des objets mais d’un web des objets, Google a ainsi la possibilité de créer un système complet (voir fermé), regroupant par exemple équipements de domotique, wearable technology (objets connectés portables sur soi comme une montre ou une paire de lunettes), smartphones, tablettes et ordinateurs, tous utilisables à partir d’un compte Google et tous connectés entre eux. Cette possibilité explique le peu d’énergie déployée par Google et par les autres entreprises impliquées dans les objets connectés à essayer d’en réduire le nombre.
On comprend dès lors mieux le nouveau leitmotiv de l’entreprise californienne, “Computing everywhere”, mettre des ordinateurs partout.
Recueillir, proposer et classer les informations, fondements de l’activité du moteur de recherche, ne pourraient plus se penser dans l’avenir sans ce “web augmenté”. “Web augmenté” qui par ailleurs ouvrirait tout un nouveau champ de possibilités en termes d’interactions, d’usages, de marketing et de publicité. Google ne perdrait donc quand même pas de vue sa principale source de revenus, la publicité.
Thomas Luck
Sources :
Nouvelobs.com
Lemonde.fr
Wired.com
Crédit photo :
Gizmodo